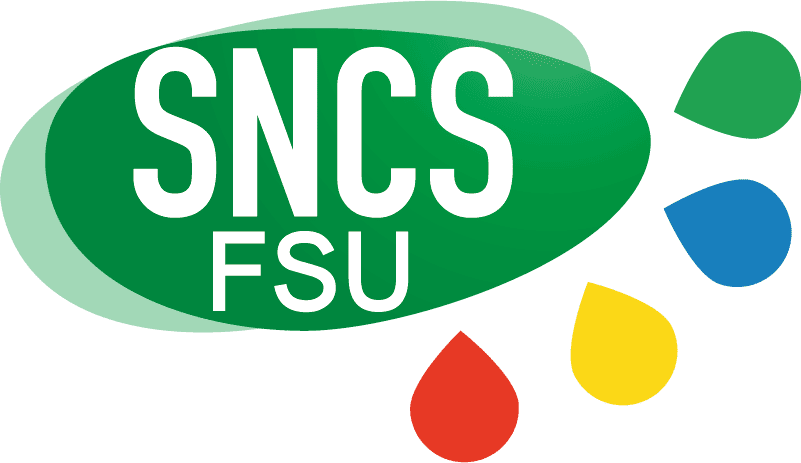Shanghai et l’évaluation technocratique tuent la recherche biomédicale ! Lemonde.fr (16/12/2011)
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/16/shanghai-et-l-evaluation-technocratique-tuent-la-recherche-biomedicale_1619588_3232.html
par Yehezkel Ben-Ari, neurobiologiste, fondateur et directeur honoraire de l’Inmed
La recherche est un bien public essentiel pour comprendre l’univers dans lequel nous vivons et améliorer notre espérance de vie tout en nous permettant de vivre mieux. Or, la recherche va mal en France, en bute à la fascination du chiffre, la stagnation des moyens, l’excès d’évaluation, le pilotage technocratique et une bureaucratie absurde. Cet ensemble est censé privilégier les éléments excellents qui vont effacer le rang infâme de la France dans le classement de Shanghai. Les prix Nobel vont affluer rendant la parole de la France audible.
L’évaluation des chercheurs est le nœud gordien du problème. Notre métier est parmi les plus évalués qui soient avec un contrôle continu du recrutement jusqu’à la retraite. Sous l’influence de la mode du chiffrage tous azimut, nos technocrates ont fabriqué une tour de Babel avec couches, sigles et administrations. Ainsi, un laboratoire est jugé en première instance par un organisme fourre tout – l’AERES – qui juge tout le monde de la physique des particules à la sociologie et donne en quelques heures à un institut une note – A+, A-, B ou C comme chez Standard and Poor. Il y a ensuite les commissions internes des organismes (Inserm, CNRS, universités, etc.) puis, vient cet ovni qu’est l’Agence nationale de la recherche dont le coût de fonctionnement a été épinglé par la Cour des comptes qui va sélectionner les projets « porteurs » pour financement. On peut être évalués excellents par l’Aeres mais rejetés par l’ANR et condamnés à végéter. Là-dessus se greffent les Labex, Equipex et autres ex qui vont sélectionner et concentrer les moyens dans les triples A.
Cette hyper-concentration entraîne la création d’une nouvelle race de chercheurs-banquiers-politiques-communicants qui ont comme souci principal le financement de leurs équipes. Pourtant, les sauts importants en recherche biomédicale résultent de la convergence de travaux effectués par « des chercheurs de base » et d’autres plus intuitifs qui partant de ce socle font ouvrir de nouvelles portes. On oublie combien les découvertes importantes ne sont pas visibles par ces évaluations chiffrées incapables d’évaluer la prise de risques consubstantielle à l’innovation. Le plus cocasse est que toutes ces évaluations in fine se basent sur les publications dans des journaux dits d’excellence (Nature, Science, etc.) qui sont les équivalents de S&P ou Moodys dotés du pouvoir de vie ou de mort sur des pans entiers de la recherche biomédicale.
Pourquoi ne pas faire des économies d’échelle en confiant aux journalistes de ces revues de sélectionner directement les équipes d’excellence qui seront financées ? Peu importe qu’il s’agisse souvent de scientifiques qui ont décroché de longue date et ont la tâche redoutable d’éliminer 90 % des articles soumis en quelques minutes. Peu importe que le pourcentage de fraudes dans ces revues soit en croissance exponentielle et que la politique anglo-saxonne y donne le la comme dans nos chères agences de notation. De plus, les Européens ont poussé ce mode d’évaluation absurde bien plus loin que les Américains, chez lesquels les papiers dans Nature et Science sont moins synonymes de succès et de financement garanti.
Les réformes en cours en France se traduisent aussi par le démantèlement des établissements publics de recherche (CNRS, Inserm, etc.) qui depuis des décennies ont formé des générations de chercheurs et n’ont pas démérité malgré les disparités de moyens : l’Inserm a un budget 40 fois inférieur à celui de Harvard et 4 fois au coût de la baisse de la TVA des restaurateurs… Certes, il avait été promis un financement « comme la France n’en n’a jamais fait depuis la création de la cinquième République avec tous les ans 1,8 milliard d’euros (Md€) supplémentaires (soit 27 Md€ en 5 ans) », or le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, astuces de présentation mises à part, a tout juste suivi l’inflation. Or même ces instituts et universités censés représenter la quintessence de « l’excellence » n’ont pas vu venir grand-chose.
La France est tombée à la quinzième position mondiale pour la dépense intérieure de recherche versus le PIB, d’après l’OCDE, et en vingt-sixième position (sur 32 classés) pour le budget civil de la recherche. Par contre, la France est en première position en termes d’aide à la recherche privée qui pourtant ne décolle pas : les dépenses des entreprises en France sont deux fois moindres, versus le PIB, que celles de Finlande, de Corée ou du Japon. Cette politique s’accompagne de l’assèchement des postes d’universitaires, de chercheurs et de techniciens, du recours systématique aux CDD (15 000 CDD payés par l’ANR), entraînant la perte d’attractivité des métiers de recherche et de la « mémoire » des laboratoires. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que nos meilleurs éléments partent à l’étranger là ou ils sont appréciés, car bien formés, et… mieux payés. Comme pour les médecins et d’autres métiers, le non remplacement d’un chercheur sur deux est une erreur.
Pour couronner le tout, la bureaucratie veille à réduire toute velléité d’originalité. Nous devons d’emblée dire ce que nous allons découvrir : ce n’est plus de la recherche, c’est du retour sur investissement. Nul n’est autorisé à faire une découverte qui pourrait l’amener à changer son programme afin d’acquérir un équipement qui n’était pas prévu au départ. Libérer les chercheurs des carcans administratifs augmenterait leur productivité de façon significative sans rien coûter et libérerait des postes qui nous manquent à la paillasse.
Pour sauver ce qui peut encore l’être, il faut redonner des couleurs aux Etablissements scientifiques en leur re-transférant les moyens qui leur avaient été prélevés au profit de l’ANR. Celle-ci doit rester une source de financement supplémentaire pour des projets particuliers type valorisation, permettre aux jeunes une autonomie, rapatrier nos chercheurs de l’étranger comme le font avec succès les canadiens ou les chinois (opérations ATIPE, Avenir, etc.). Les évaluations doivent être faites par des commissions et non par des experts externes anonymes avec comme conséquence des transferts de nos projets à nos compétiteurs. Elles doivent se baser sur la productivité réelle des équipes, leur force d’attraction, leur renommée internationale et leur degré d’innovation. Donner des moyens aux universités autonomes, faire travailler ensemble universités et organismes de recherche, tout en sachant que ce mariage prendra du temps. Faire de la recherche une priorité sachant que cet investissement est le plus rentable. Enfin ne pas prendre des virages à 180° en passant d’un saupoudrage inefficace à un pilotage géographique et thématique tout aussi improductif.
La rigueur à la triple A et l’évaluation Shanghaienne à la Prévert avec la poésie en moins va ici comme à l’hôpital ou à l’école se traduire par la perte d’indépendance et le handicap sévère des générations futures. Le parallélisme avec les méfaits de la financiarisation de l’économie (Cf A Orléan, Le Monde 6 décembre) est évident. Ici comme là-bas on donne une valeur absolue et on se projette dans le futur à partir d’une estimation fictive fortement dépendante des modes momentanées incompatibles avec le tempo de la science.