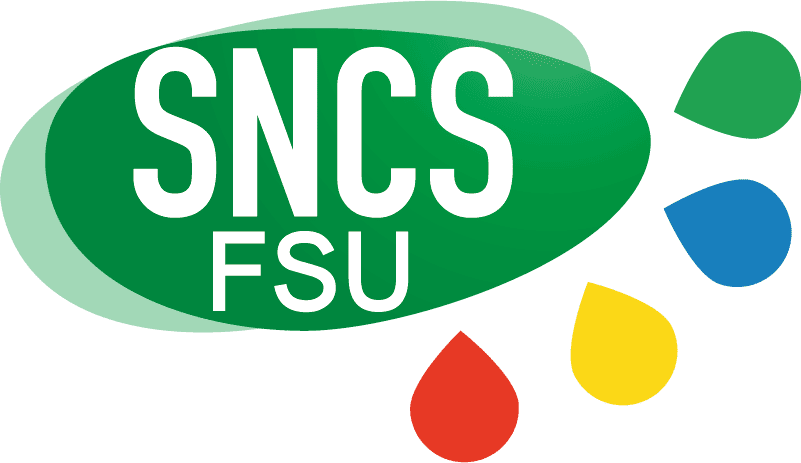Compte-rendu des élus du Conseil scientifique du CNRS du 7 mars 2011 (10/03/2011)
Le conseil scientifique (CS) du 7 mars a travaillé sur deux questions principales :
1) La question de l’interdisciplinarité au CNRS et des relations entre les différents Instituts du CNRS ;
2) Le projet de redécoupage des sections de l’Institut des sciences biologiques (INSB), en vue d’une harmonisation avec les commissions scientifiques spécialisées (CSS) de l’INSERM.
Interdisciplinarité au sein du CNRS
La direction a mis en place une commission de réflexion sur l’interdisciplinarité. Un point d’étape de leurs travaux a été présenté au CS. Une des questions abordées a été celle de l’évaluation des chercheurs à la frontière entre différents domaines, qui souvent se trouvent pénalisés du fait de ne pas être « au cœur » d’un champ disciplinaire.
On notera que la question des ITA (qui sont des acteurs de l’interdisciplinarité) n’a pas été prise en compte par la commission. Ceci permet de rappeler l’importance d’avoir des élus de toutes les catégories de personnels dans les conseils scientifiques du CNRS.
Le fonctionnement en « tuyaux d’orgue » des Instituts ne facilite pas l’interdisciplinarité, et a posé des problèmes lors de certaines affectations d’ITA. C’est ce qu’Alain Fuchs a reconnu en disant que dans certains cas, l’existence de dix Instituts pouvait constituer un frein à l’interdisciplinarité. Pour autant, il ne souhaite pas remettre sur le chantier le découpage en Instituts du CNRS et a affirmé : « Je ne veux pas que l’on change le nombre d’Instituts. Nous avons mieux à faire. »
Une contradiction a été soulignée, entre le soutien officiel mais de principe à l’interdisciplinarité, et le faible soutien concret en termes de postes ou de crédits de fonctionnement. Certains de ces crédits ont été fortement diminués cette année (jusqu’à 60 % pour certains GdR), sans explication. Sans doute est-ce la conséquence de difficultés budgétaires, la partie interdisciplinaire constituant une des variables d’ajustement qui restent possibles.
Une présentation commune des politiques de l’INEE (écologie et environnement), l’INSHS (sciences humaines et sociales) et l’INSU (sciences de l’Univers) a été faite par leurs président(e)s, François Gaill, Patrice Bourdelais et Jean-François Stephan. Ils sont tous convaincus de la nécessité de travailler en bonne intelligence, dans la mesure où de nombreux domaines de recherche relèvent de plusieurs Instituts, ce qui n’empêche pas les problèmes, par exemple pour la constitution des OSU (Observatoires pour les Sciences de l’Univers), comme l’a souligné un membre du CS.
Une autre présentation commune a été faite par les présidents de l’INSII (sciences informatiques et de leurs interactions) et de l’INSIS (sciences de l’ingénierie et des systèmes), Philippe Baptiste et Pierre Guillon. À cette occasion a été discuté le problème de disciplines en développement rapide et du périmètre de chacune d’entre elles. Rappelons que la création de l’INSIS a été imposée par la ministre contre l’avis du CS précédent. Le Président du CNRS a insisté sur l’idée qu’il fallait partir de l’existant, même si le contour actuel de l’INSIS n’était pas totalement satisfaisant. Le cas de la section 7 a été discuté. Cette section (Sciences et technologies de l’information : informatique, automatique, signal et communication) a la double particularité de relever de deux Instituts (INSII et INSIS), et de regrouper un très grand nombre de chercheurs, ce qui correspond à une cohérence scientifique, mais ne facilite pas son fonctionnement. Le débat sur la question de son maintien en l’état ou de sa division en deux est ouvert.
Projet de redécoupage des sections de l’INSB
Le CS ayant été alerté de l’existence du comité Egly-Méchali, nommé par les présidents du CNRS et de l’INSERM pour faire des propositions relatives à des modifications dans l’organisation du recrutement des chercheurs dans les deux organismes, a obtenu que la lettre de mission des présidents de ce comité lui soit communiquée (ci-jointe). L’objectif de ce comité est de faire des propositions visant à harmoniser les recrutements des chercheurs et les politiques scientifiques des deux organismes. Plusieurs membres du CS ont souligné, exemples à l’appui, en quoi le CNRS avait un rôle irremplaçable à jouer pour la recherche à la frontière entre la biologie et de nombreuses autres disciplines. Sur ces questions, le CS a adopté deux recommandations, une concernant la biologie, l’autre plus générale.
Auditions communes aux concours de recrutement au CNRS et à l’INSERM
Sans consultation ni même information des Conseils Scientifiques concernés, les directions de l’INSERM et du CNRS viennent de mettre en place une commission qui doit préparer la redéfinition des périmètres des commissions de l’INSB CNRS et des CSS INSERM. L’objectif serait de combiner des jurys d’audition communs INSERM-CNRS, afin de simplifier et d’améliorer le processus d’évaluation et de recrutement des candidats à des postes de chercheurs en biologie dans ces deux EPST. Un découpage similaire pour les deux EPST serait un préalable indispensable à de telles auditions communes. Il est de la compétence et de la responsabilité des Conseils Scientifiques des organismes concernés de donner un avis sur une question de cette importance après en avoir soigneusement étudié toutes les conséquences. Une justification avancée à ce projet de jurys combinés serait de limiter le nombre de voyages à Paris que devraient effectuer des candidats postulant à des concours CNRS et INSERM. La solution simple et efficace à ce problème consiste à préparer en concertation entre le CNRS et l’INSERM un calendrier intelligent des différents concours, qui permettra aux candidats de regrouper plusieurs auditions sur une courte période.
Des jurys d’audition communs sont-ils en mesure de simplifier le travail d’évaluation ? On voit mal quelle amélioration significative pourrait découler d’auditions communes suivies de concours séparés, menés par des jurys distincts. Cela mobiliserait le même nombre d’experts qu’actuellement, et l’audition devant un jury plus important ne faciliterait ni l’évaluation ni le dialogue avec les candidats. Seuls des concours entièrement communs seraient de nature à réduire le nombre d’experts requis, mais cette simplification aurait un prix qu’il importe d’évaluer. Dans la mesure où les recrutements constituent un outil essentiel de la politique scientifique des organismes de recherche, un concours unique impliquerait de facto que les priorités et les politiques scientifiques du CNRS et de l’INSERM devraient devenir très similaires. Or, la mission de l’INSERM est de faire de la recherche biomédicale, y compris dans ses aspects fondamentaux, tandis que celle du CNRS est de couvrir tous les champs scientifiques fondamentaux et de faciliter ainsi l’émergence rapide de thématiques nouvelles qui impliquent, souvent, de larges échanges interdisciplinaires. Le centrage de toute la biologie sur le biomédical ne répond pas à cette mission du CNRS.
Si certains secteurs sont couverts à la fois par l’INSERM et le CNRS (bien qu’avec des optiques parfois différentes), d’autres, comme la biologie végétale, certains aspects de la biologie structurale, la génomique fondamentale ou la microbiologie d’organismes non associés à des pathologies humaines, sont étudiés exclusivement au CNRS. Sans compter les interfaces entre la biologie et plusieurs domaines comme l’informatique, la chimie, les nanotechnologies, interfaces prometteuses pour lesquelles le CNRS constitue un espace d’épanouissement très favorable. Au motif de supprimer la frontière entre CNRS et INSERM, il faudrait, pour dessiner ce nouvel ensemble créer, au sein du CNRS, une nouvelle frontière entre la biologie biomédicale et celle, très importante, qui ne l’est pas.
La diversité et les complémentarités qui existent au sein du CNRS et entre le CNRS et l’INSERM sont précieuses et fécondes pour la recherche dans notre pays, qu’elle soit fondamentale ou plus tournée vers des applications. Le CS donne un avis nettement défavorable à des modifications d’organisation qui auraient pour conséquence à court ou moyen terme une uniformisation réductrice des politiques scientifiques de l’INSERM et du CNRS.
Périmètre des sections et Instituts
Le Conseil scientifique souhaite continuer à être associé à la réflexion sur le périmètre des sections et Instituts du CNRS. Le Conseil scientifique rappelle que cette réflexion relève des missions du Comité national dont le Conseil scientifique du CNRS fait partie, et non de comités ad hoc.
Une troisième recommandation a été adoptée à l’unanimité des 20 votants :
Interdisciplinarité
Le Conseil scientifique doit être associé à l’avancement des travaux portant sur l’interdisciplinarité au CNRS. À ce titre, il demande à interagir régulièrement avec la mission interdisciplinaire.