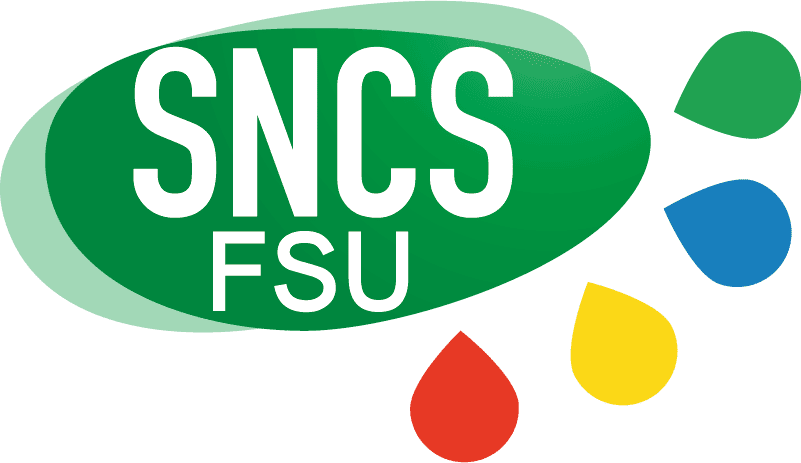Industrie pharmaceutique : un dossier remarquable de La Marseillaise du 26/10/09
Industrie pharmaceutique. Reçus aujourd’hui 26 octobre 2009 à l’Elysée, les grands groupes de ce secteur réclament une part de gâteau plus importante.
La recherche sacrifiée sur l’autel du profit
Aujourd’hui à 16 heures, le Conseil stratégique des industries de santé (Csis) – qui réunit les dirigeants des principaux groupes pharmaceutiques français – va être reçu par le Président de la République à L’Elysée. Selon les membres du G5 (Sanofi-Aventis, Pierre Fabre, Servier, Ipsen et le Laboratoire de fractionnement des biotechnologiques) cette réunion « marquera une étape clé dans la reconnaissance des industries de la santé comme secteur stratégique. »
Parmi les axes de réflexion proposés par le G5 (1) : Utiliser les fonds du Grand emprunt pour que les équipes de recherche françaises de rang international soient orientées vers des priorités stratégiques thérapeutiques nationales ; supprimer tout ou partie des taxes payées par l’industrie pharmaceutique pour les entreprises qui s’engagent à consacrer des montants équivalents au financement de projets de recherche en France. Enfin le G5 se prononce pour que l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé, créée en avril dernier devienne « une agence de financement par projet pour pérenniser et accroître à long terme l’aide de l’Etat afin d’éviter de couper la dynamique naissante. »
Applications rentables
Bien sur, il faut décoder ce discours officiel. Dans un communiqué, la Cgt recherche publique et la Cgt Sanofi soulignent : « Cette politique s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation (Snri) que vient de lancer le gouvernement en mettant en avant un nombre limité de grandes priorités scientifiques essentiellement tournées vers des applications à court terme (…) Les axes de recherche développés par l’industrie pharmaceutique correspondent essentiellement aux pathologies représentant un marché important, délaissant nombre de pathologies affectant les pays en voies de développement. »
Ce communiqué signale également que « Du côté de l’Inserm, un plan stratégique est actuellement en préparation, qui devrait être voté par le Conseil d’Administration du 3 décembre 2009. Ce plan reproduit le même discours que les dirigeants de Sanofi-Aventis (…) Autrement dit, l’Inserm se prépare à faire les premières étapes du développement du médicament dans le cadre des futurs Instituts Hospitalo-Universitaires, se substituant ainsi aux industries pharmaceutiques.
C’est donc l’argent public qui va encore financer le risque de la démonstration de l’efficacité du produit et les futurs profits resteront au bénéfice des industriels et de leurs actionnaires. »
Sur le dos des contribuables
Selon les scientifiques de Sauvons la recherche (Slr), les licenciements qui se préparent chez Sanofi sont ainsi justifiés (en interne) par le directeur de la Recherche : « Pourquoi voudriez-vous qu’on continue à financer 100% de notre recherche interne alors qu’à l’extérieur l’innovation existe dans les organismes de recherche publique, les biotechs, les universités qui sont financés en tout ou partie par l’Etat et/ou les collectivités territoriales ». Et Slr ajoute : « Il y a en général consensus sur l’utilité d’un développement des partenariats entre public et privé. Mais l’objet de la réunion du 26 octobre 2009 n’est absolument pas un tel développement. ce sera une étape supplémentaire dans la mise en place d’une politique doublement malsaine, où l’étranglement financier par l’Etat des laboratoires publics force ces derniers à des partenariats négociés en position de faiblesse avec le secteur privé, lequel peut simultanément réduire d’autant son propre effort, afin de satisfaire ses actionnaires. Le tout sur le dos des contribuables actuels et futurs (via l’accroissement de la dette). La pièce est bien réglée et mise en scène, pour que sa signification réelle reste cachée. »
(1) www.g5.asso.fr
(2) L’Alliance regroupe le Cea, le Cnrs, l’Inra, l’Inria, l’Inserm, l’Ird, l’Institut Pasteur et la Conférence des Présidents d’Université
Repères
2,02% Telle est la part du PIB consacrée en 2008 par la France à la recherche. Un chiffre qui marque une nouvelle chute et confirme une décroissance constante depuis 2002 (2,24% du PIB).
4 milliards d’euros : c’est le montant accordé chaque année par le gouvernement pour le Crédit d’impôt recherche, sans évaluation de son efficacité en terme de développement de la recherche.
20% des effectifs de la Recherche et Développement (R&D) en France de Sanofi-Aventis, soit 1 200 postes, doivent être supprimés. Dans le même temps, le groupe a vu ses profits augmenter de plus de 22% au premier semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008.
Précarité
Les organisations syndicales de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que les associations Slr (Sauvons la recherche) et Slu (Sauvons l’université) ont présenté à la presse l’enquête sur la précarité dans les universités et les organismes de recherche qu’ils viennent de lancer de façon conjointe.Selon eux, il y aurait au moins 6000 CDD financés par l’Agence nationale de la recherche. A l’Inserm notamment, les précaires seraient passés de 497 en 2005 à 1459 en 2008.
Billet : Marchés juteux
Offres de soins, hôpitaux publics, recherche… Des domaines qui concernent la santé, la vie humaine. Qui ne devraient pas être marchandisés, soumis au profit, et qui le sont de plus en plus. Parce que des prédateurs les convoitent. Et qu’une même logique prévaut. Malgré ses efforts pour donner le change, Nicolas Sarkozy ne peut pas empêcher son dogmatisme ultralibéral de s’exprimer : avant l’annonce du projet de loi Bachelot, dans ses discours tenus à Bordeaux en 2007, puis à Bletterans en 2008, n’a-t-il pas stigmatisé l’organisation et les difficultés financières de l’hôpital et vanté la gestion économique du privé, sans tenir compte des spécificités de chacun ?
Au mois de juin dernier, devant les patrons des laboratoires internationaux de recherche pharmaceutique, le président a remis ça : « Si j’ai voulu vous recevoir, leur a-t-il dit, c’est que j’apprécie votre pragmatisme, votre audace, votre esprit d’entreprise », et d’évoquer plus loin « la recherche publique, aux pesanteurs légendaires, et l’industrie pharmaceutique prospère et dynamique. »
Comme les groupes de cliniques commerciales cotées en bourse se sont emparées du « marché de l’offre de soins », les industries pharmaceutiques souhaitent capter encore davantage le « marché de la recherche ». Parce que lui aussi est juteux. Juteux à condition de s’intéresser à ce qui est rentable et de laisser tomber le reste. Pire, en utilisant les laboratoires publics pour « sous-traiter » ces recherches sélectives. Pourtant, les dividendes de ces groupes se portent déjà bien. Pour la recherche publique au service de l’intérêt général, c’est une autre affaire.
Un refus de soumission aux intérêts privés
Dans un contexte de pénurie pour la recherche publique, les chercheurs, et notamment l’association Sauvons la recherche, s’inquiètent et se remobilisent. La « stratégie » des groupes pharmaceutiques du G5 n’est pas là pour les rassurer.
Témoignages
Jacqueline De Grandmaison
Au Laboratoire de recherche en cancérologie de l’Inserm à Marseille, François Coulier, membre de l’association Sauvons la recherche ne cache pas son inquiétude : « Même si Valérie Pécresse prétend le contraire, sur le terrain on voit bien que les budgets de la recherche publique sont en baisse. Il y a de moins en moins de postes permanents, de plus en plus de contrats à durée déterminée (Cdd). Cela induit d’énormes problèmes à la fois pour ce personnel confronté à la précarité, et pour les laboratoires car les personnes qui sont là transitoirement ne s’impliquent pas de la même façon dans la vie du labo. »
Cette inquiétude des scientifiques du secteur public ne date pas de cette année. En 2004, une partie des directeurs de laboratoire avait démissionné symboliquement pour protester contre les politiques en matière de recherche, et le mouvement Sauvons la recherche (Slr) a été créé dans le cadre de cette mobilisation. Mais aujourd’hui, les menaces sur la recherche publique s’accélèrent.
« Seulement 10% des projets présentés par les labos sont retenus, et il n’est pas vrai que 90% d’entre eux ne soient pas intéressants, souligne François Coulier. Mais il est actuellement plus facile d’obtenir un financement pour un thème porteur, rentable ou à la mode comme les nanotechnologies. C’est à mon sens néfaste car des recherches fondamentales peuvent aboutir à des découvertes importantes. »
Des propos étayés par de nombreux exemples que connaît bien Pierre Aucouturier, Pu-Ph*, responsable du laboratoire d’immunologie à l’Université Pierre et Marie Curie/Inserm à Paris. Parmi eux, il cite le cas de la maladie à prions ou « maladie de la vache folle » : « Au milieu des années 90, face aux risques de transmission à l’homme, il y a eu d’énormes efforts pour financer les recherches fondamentales sur ces maladies pour lesquelles on ne disposait d’aucune thérapeutique efficace. Ces recherches ont été réalisées par des laboratoires, essentiellement publics – Inra, Inserm, Cnrs -, parce que c’est là que se trouvent les outils, les savoir-faire, les expertises scientifiques. Quatre ou cinq ans plus tard, alors qu’on s’apercevait que l’épidémie allait être faible, on a arrêté les financements alors qu’on avait avancé mais qu’il fallait travailler encore et qu’on n’est pas à l’abri d’un nouvel événement comme dans ces années 90. ».
Autre exemple : la maladie d’Alzheimer. Entre 1999 et 2000, des groupes pharmaceutiques américains ont réalisé des essais de vaccin sur des souris, qui ont montré que ce vaccin pouvait entraîner la réversion des déficits de la mémoire. « Cela a fait du bruit et très rapidement, rappelle M.Aucouturier, ces groupes ont obtenu l’autorisation de faire des essais sur l’homme, sans un certain nombre d’études préliminaires. Or, on le sait, la vaccination peut entraîner des effets secondaires. Sur les 300 patients vaccinés, 18 ont développé une maladie inflammatoire du cerveau grave. L’essai a été arrêté, mais on n’a pas recherché la cause de cette réaction qui pourrait être d’ordre immunitaire. » Immunologiste, Pierre Aucoutuirer qui travaille actuellement sur Alzheimer, s’intéresse à la question et essaie de récupérer auprès des labos ayant effectué ces essais des données concernant les malades ayant développé des complications. Sans succès.
« Aujourd’hui, indique-t-il, ces firmes ont lancé de nouveaux essais vaccinaux contre Alzheimer selon un concept différent, sans chercher à comprendre ce qui s’était passé. Ils préfèrent développer rapidement quelque chose, au risque que cela ne donne pas de très bons résultats. Pendant ce temps, nous essayons de décortiquer sur la souris les mécanismes qui font que dans une approche vaccinale contre Alzheimer on ne va pas développer une réponse de type inflammatoire du cerveau. Evidemment, cela demande plus de temps. Dans la recherche fondamentale, on n’a pas la même logique que dans la recherche privée, qui a des impératifs économiques et doit répondre aux exigences de ses actionnaires. La recherche appliquée est nécessaire mais ne marche qu’à condition qu’elle s’appuie sur la recherche fondamentale. On oublie que le diagnostic du Sida a été rendu possible par une technique moléculaire mise au point grâce à des gens qui travaillaient sur des algues microscopiques. Alors, voir la stratégie scientifique de notre pays guidée par des industriels me paraît extrêmement dangereux. Qu’il y ait des partenariats entre le public et le privé, c’est bien, mais à condition que cela ne consiste pas à mettre la recherche fondamentale au service des objectifs des groupes privés. »
Dans ce contexte, le « Grand emprunt » destiné à financer la recherche est jugé sévèrement par les chercheurs du secteur public. Henri Audier, directeur de recherche Cnrs émérite, membre du CA de Sauvons la recherche s’insurge : « On se moque de nous. La recherche et l’enseignement supérieur, auxquels on a serré la vis depuis 2002, vont servir de justification à cet emprunt. Or, cela ne peut qu’être un échec complet, tout simplement parce qu’on n’a pas le potentiel humain pour faire face. On ne forme pas assez de doctorants (10 000 par an au lieu de 25 000 en Allemagne) et leur nombre va baisser de 30% sur les dix ans à venir, selon les statistiques du ministère. Il n’y a aucun sens à un plan de relance si on ne commence pas par relancer l’emploi scientifique et donc à former des docteurs et, pour attirer les jeunes, leur donner des débouchés, des perspectives d’avenir. Il faudrait créer 6 000 emplois par an dans la recherche publique. »
Comme ses collègues, Henri Audier se défend pourtant de ne pas être favorable à des coopérations entre le public et le privé, mais à certaines conditions : « Si on finance le privé, cela doit être dans le cadre d’une utilité sociale, d’un contrôle, d’une évaluation. Ce n’est qu’à cette condition que les rapports public-privé peuvent être de coopération et non de subordination. Il est nécessaire que les labos aient des crédits de base suffisants, pour avoir la liberté de choisir leurs partenaires sans être à la remorque du privé. Coopérer oui, mais d’égal à égal et pas en mettant comme on le fait actuellement le public à genoux, en l’obligeant soit à chercher du fric à partir de thèmes de recherche finalisés par l’ANR, soit à prendre n’importe quel contrat avec le privé. »
Interview
Thierry Bodin, statisticien, délégué syndical central Cgt du groupe Sanofi-Aventis.
« Les industries de santé veulent asseoir leur rentabilité »
– Quel est votre sentiment sur la réunion du Conseil stratégique des industries de santé de ce 26 octobre ?
Cette réunion est importante car elle aura des conséquences non négligeables sur le budget de la nation. Certes, l’industrie pharmaceutique joue un rôle stratégique dans le pays, mais dans le cadre de cette réunion, il est à craindre que les besoins en matière de recherche et de santé publique soient moins au cœur du débat que les besoins pour les industries de santé d’asseoir leur rentabilité. Cette réunion devrait permettre à ces grands groupes pharmaceutiques français d’aller vers une limitation de leurs efforts de recherche, tout en affirmant le contraire, et elle constitue une illustration claire du mode de fonctionnement de ceux qui nous gouvernent.
– Pourtant, l’objectif affiché est de « faire des sciences de la vie une priorité nationale de premier ordre » ?
En réalité, ces groupes pharmaceutiques réunis en G5 voudraient obtenir des financements publics pour un certain nombre de choses. Le groupe Sanofi-Aventis illustre clairement la démarche : depuis plus d’un an, son centre de recherche de Vitry a annoncé un investissement majeur dans les biotechnologies. Or, la direction générale n’a toujours pas signé d’engagement de dépenses et on se pose la question : comme le G5 estime qu’il serait bon que le « grand emprunt » participe au financement de recherches dans ce domaine, des pressions ne sont-elles pas exercées sur les pouvoirs publics afin qu’ils mettent la main à la poche ?
Au niveau de la Cgt, on trouve particulièrement scandaleux de demander à l’Etat de financer cet investissement, alors que Sanofi a réalisé 7,2 milliards de profits en 2008 et que pour le premier semestre 2009, ces profits montrent une augmentation de 22% par rapport à 2008. D’ici la fin de ce mois, les résultats du 3ème trimestre vont être annoncés et, avec notamment l’argent gagné avec le vaccin pour la grippe H1N1, ces résultats ne devraient pas diminuer. Par ailleurs, le groupe a bénéficié en 2008 de 25 millions d’euros d’exonérations fiscales au titre du Crédit Impôts Recherche.
Dans le même temps, Sanofi restructure de façon très conséquente ses activités, justement de recherche et développement (R&D), et a annoncé cet été un plan de 1200 suppressions de postes en France, soit 20%. Même s’il s’agit de départs non remplacés, ce seront des postes en moins et donc des capacités scientifiques diminuées d’autant. Pour nous, il est inacceptable qu’une entreprise puisse générer autant de bénéfices dans un domaine aussi vital que la santé, et qu’en plus elle diminue son secteur de recherche et demande de l’argent public.
– Peut-on au moins espérer que les collaborations avec le public, souhaitées par le G5, puissent être bénéfiques à l’intérêt général ?
Malheureusement, avec l’orientation actuelle donnée par le gouvernement à la recherche publique, avec la mise en place des agences nationales de la recherche (Anr), des pôles de compétitivité, des structures qui permettent une implication importante des entreprises privées dans les programmes de recherche publique, ces entreprises ont la volonté d’utiliser le public sous forme de sous-traitance afin de diminuer leurs coûts internes, d’externaliser le risque en quelque sorte. La Direction de Sanofi-Aventis sabre sa propre recherche en clamant qu’elle va renforcer ses liens avec la recherche publique.
Nous serions favorables à des collaborations afin de répondre à des problèmes majeurs de santé publique, avec la volonté de développer en commun le potentiel scientifique, de partager des connaissances, mais pas d’assujettir la recherche publique aux choix du privé. Ces choix, on le sait, s’ils peuvent se faire sur de nouvelles thérapeutiques utiles, doivent aussi concerner des maladies qui peuvent leur rapporter beaucoup d’argent. Or, il est indispensable de conserver des programmes libres de recherches qui ne soient pas forcément liées à un besoin immédiat, mais pourront faire faire un bond en avant sur la prise en charge de fléaux sanitaires d’actualité.
Propos recueillis par JDG