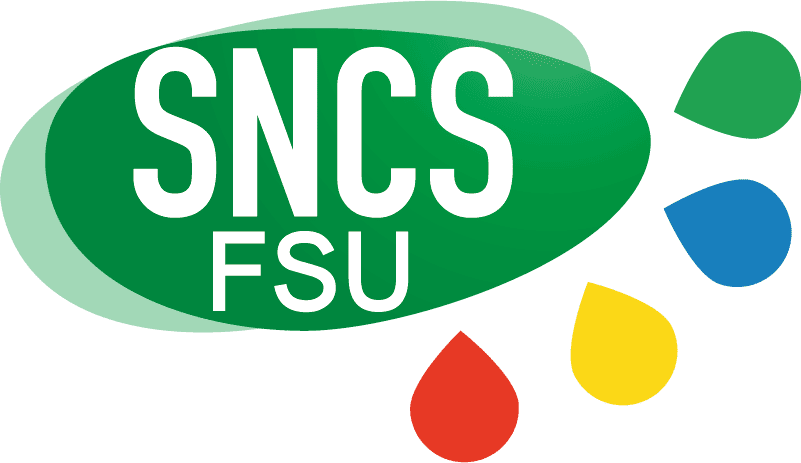L’objectivité des critères objectifs, Jacques Ninio, article de la VRS, avril 1978 – Mis en ligne le 11 juillet 2008
Cet article est paru dans La vie de la Recherche Scientifique d’avril 1978, pages 26-28.
Il est intéressant:
(1) de retrouver dans ce texte toutes les dérives déja décelables il y a trente ans, et qui se sont amplifiées.
(2) de voir comment certains comportements dénoncés il y a trente ans se retrouvent aujourd’hui incarnés dans de nouvelles pratiques.
(3) de s’interroger sur les parties « périmées » du texte, et analyser ce qui a réellement changé de ce côté.
Vos commentaires seront appréciés.
L’OBJECTIVITE DES CRITERES OBJECTIFS
Contribution de Jacques Ninio
VRS, Vie de la Recherche Scientifique, avril 1978, pages 26-28
Les administrateurs de la science entendent de plus en plus nous juger selon des “critères objectifs”: nombre d’articles publiés, caractère international ou non de la revue, nombre de fois où l’article publié a été cité par d’autres auteurs (“indice de citations”). Ces critères, et surtout l’indice des citations sont de plus en plus appliqués aux Etats-Unis pour décider des promotions et des octrois de crédit (1). Les classements d’entrée à l’INSERM tiennent compte des “critères objectifs” , et le CNRS a pensé un temps les utiliser. A la tête de la croisade pour accréditer l’idée que la valeur d’un travail scientifique peut être mesurée selon des critères objectifs, on trouve Eugène Garfield.
Garfield est l’inventeur du “Science Citation Index”, instrument de recherche bibliographique irremplaçable, que l’on trouve rarement dans les bibliothèques françaises, faute de crédits. Supposons que je m’intéresse à un sujet particulier qui a été abordé dans les articles X, Y, Z connus de moi. Il y a des chances sérieuses pour que des articles ultérieurs traitant du même sujet feront référence à X, Y ou Z. J’ouvre alors le “Science Citation Index” à la référence X et j’y trouve, année par année, les références de tous les articles qui citent X. De proche en proche, en choisissant astucieusement les articles pilotes, je peux faire une bibliographie assez complète du sujet. S’appuyant sur le critère des citations, Garfield (2) met directement en cause la qualité de la recherche scientifique française. Les revues scientifiques françaises seraient de qualité médiocre: les articles qui y sont publiés sont moins cités que les articles paraissant dans les revues anglo-américaines; les auteurs français citent trop complaisamment leurs propres travaux ou ceux de leurs compatriotes. Ceci témoignerait du déclin de la recherche scientifique française, déclin attribuable en grande part selon Garfield – il faut lui rendre cette justice – à l’asphyxie budgétaire dont le secteur de recherche est victime depuis 1969.
Or, les “critères objectifs” sont extrêmement dangereux. Loin de refléter la qualité du travail scientifique, ils ne font qu’indiquer les rapports de domination entre les courants de recherche, les rapports de puissance entre les laboratoires. Leur emploi va dans le sens du renforcement des positions de ceux qui ont déjà le pouvoir, et par conséquent joue dans un sens conservateur, contrairement à ce que prétendent leurs partisans, qui les présentent comme des détecteurs de nouveauté.
Je vais développer mon argumentation selon trois axes:
1- On incite le chercheur à être compétitif, avec en arrière-plan l’idéologie de la libre concurrence: si un produit est bon, il s’impose sur le marché. Les bénéfices d’une entreprise témoignent de la qualité de ses produits. Or, non seulement la relation entre la qualité d’un produit et son succès commercial est contestable, mais le concept de chercheur concurrentiel est vicié car de plus en plus la recherche est organisée d’une manière qui exclut la libre concurrence.
2- Les “critères objectifs” permettent au mieux d’évaluer un travail une fois que son intérêt a été reconnu par la communauté scientifique, donc quand le travail a perdu de sa nouveauté. Pour décider des promotions, faire des choix entre plusieurs voies de recherche, le critère devrait être celui des perspectives ouvertes par l’approche qui est proposée, son ouverture sur l’avenir, plutôt que sa conformité aux conceptions passées. Or, la communauté scientifique internationale réagit avec inertie à la nouveauté: les tenants d’une ancienne théorie, dépassés, ne se rallient pas de gaieté de coeur aux nouvelles conceptions et le plus souvent les ignorent jusqu’à leur mort. Le vrai et le faux en science ne peuvent se déterminer par sondage d’opinion. L’emploi des “critères objectifs”, en pénalisant lourdement les recherches “marginales” conduit à tarir la nouveauté à sa source.
3- Ne plus publier qu’en Anglais, dans les revues de langue anglaise, c’est laisser aux scientifiques étrangers le privilège de trier, dans la recherche française, le bon du mauvais selon leurs propres critères de jugement. Avec ces critères, on dévalorise tout ce qui n’est pas conforme au moule de la pensée anglo-saxonne, à ses conceptions parfois justes mais parfois erronées: c’est donc placer délibérément la science française à la remorque des sciences britanniques et américaines.
Compétitivité et monopole
Outre les pratiques anciennes bien connues par lesquelles se créent des “domaines réservés”, je citerai trois phénomènes récents, qui indiquent une tendance au renforcement des pratiques monopolistes au sein de la recherche.
On assiste à une multiplication des colloques “fermés”: la liste des conférenciers est arrêtée en secret par les organisateurs et ceux qui n’étaient pas dans leur faveur ne peuvent quémander que des strapontins. Mieux encore, certains colloques organisés sur fonds publics sont clandestins: le lieu et la date ne sont connus que des participants. C’est le cas du colloque annuel de biochimie organisé par la commission franco-poldève destinée à promouvoir les échanges scientifiques entre la France et la Poldavie. Certains chercheurs français qui auraient souhaité rencontrer leurs collègues, même hors colloque ne peuvent le faire, tant le secret de leur visite est bien gardé. Le débat sur les manipulations génétiques qui s’est développé au cours des quatre dernières années, tout en sensibilisant à juste titre l’opinion publique aux questions de sécurité a néanmoins occulté un aspect important de l’opération. Quand des biologistes hautement estimés tirent, en 1973, la sonnette d’alarme, le message ne passe pas inaperçu. Sachant que ce sont ces mêmes biologistes qui sont les plus engagés dans les manipulations génétiques, on peut affirmer que sur le plan publicitaire, l’opération n’était pas mauvaise: tout le monde parle de leur travail. On pense à ceux qui, travaillant sur des lasers, laisseraient échapper des allusions au Rayon de la Mort. Dans un deuxième temps, quand les échelles de risque et les normes de sécurité sont définies, on aboutit à une situation où seuls quelques laboratoires suréquipés pourront effectuer les expériences à haut risque, donc de haut prestige.
Les revues scientifiques naissent ou meurent à un rythme accéléré. On peut s’en réjouir et dire que c’est signe que la science évolue. Mais pourquoi donc les revues ne peuvent-elles pas évoluer en s’adaptant? En fait, le contrôle direct de la presse scientifique par les chercheurs leur paraît de plus en plus vital. Les scientifiques se groupent et fondent leur revue, moyen efficace pour assurer un débouché à leurs travaux et décourager les concurrents. L’auteur qui soumet un article et n’a pas de protecteur dans le clan qui contrôle la revue peut essuyer un refus avec un argument du genre: “nous n’avons aucun reproche spécifique à faire à votre travail, bien au contraire nous le trouvons même intéressant: mais nous pensons qu’il aurait mieux sa place dans une autre revue que la nôtre”.
Une anecdote. Ayant un jour attaqué sur le fond, lors d’un colloque, les positions de l’Ecole de Cambridge, il m’est demandé fermement de mettre un terme à mes attaques, faute de quoi je ne pourrai plus publier dans les journaux de langue anglaise. Aucun participant français n’a jugé bon de protester contre le chantage.
Pour qu’un travail soit cité, encore faut-il qu’il soit publié et diffusé. A travail égal, l’élévation du coût (en temps et en argent) de la publication favorise le gros laboratoire. Le laboratoire riche peut présenter des manuscrits soignés: frappe et illustrations, dans un Anglais correct. La présentation influe sur la décision qui est prise par la revue, d’accepter ou rejeter le manuscrit – a fortiori quand il s’agit d’une revue qui reproduit photographiquement les manuscrits. Un laboratoire riche a les moyens, après la publication d’un travail, de le faire connaître en diffusant massivement des tirages à part, ou en envoyant les chercheurs à des congrès. Les restrictions budgétaires qui affectent principalement les petits laboratoires en viennent à rendre difficile la publication et la publicisation du travail, donc la manière dont il sera reconnu, par les “critères objectifs”. Ce n’est pas tout de fabriquer “Concorde”, encore faut-il le vendre. Mais si les acheteurs potentiels, en face, n’en veulent pas, est-ce vraiment parce qu’ils font mieux? Ou plutôt parce que nos produits n’ont pas le soutien politique et publicitaire qu’ils méritent?
Inertie de la science
Pour nous persuader que le nombre de citations reçues par un article est une bonne mesure de sa valeur scientifique, Garfield avance deux arguments. D’abord, l’indice des citations est bien corrélé avec les jugements de valeur portés par les scientifiques compétents. Ensuite, il est bien corrélé avec le jugement a posteriori de la communauté scientifique tel qu’il se manifeste dans l’attribution du prix Nobel. Je ne m’attarderai pas sur le second argument:il suffit de consulter la liste des récompensés depuis les origines du prix pour s’apercevoir que les académiciens scientifiques de Stockholm sont rarement plus futés que les jurés du prix Goncourt en littérature, et pas moins qu’eux soumis aux pressions des groupes d’influence (Cf. Nature 264, 109). Quant à l’accord entre l’indice des citations et le jugement des pairs (“peer review”) il confirme simplement le fait qu’à un moment donné en science, il y a un point de vue dominant. Ceux qui se situent à l’intérieur du paradigme dominant sont appréciés de leurs collègues, recueillent les citations et reçoivent les médailles aux distributions de prix. Sans contester la valeur et l’importance de cette “science normale”, on ne peut pas ignorer que les révolutions scientifiques dans lesquelles on change de problématique, rencontrent presque toujours une très grande résistance de la part de ceux qui sont engagés dans la science normale. Il me semble que pour un pays en voie de sous-développement comme la France, il est préférable de chercher le “créneau” pour briller scientifiquement, plutôt que de tout miser sur la science normale où on ne peut que jouer les second rôles.
Il faut rappeler que les idées révolutionnaires en science peuvent être rejetées non seulement par ceux qui occupent des positions dominantes (académiciens, titulaires de chaires importantes, etc.) sans être des personnalités de premier plan, mais aussi – et cela est beaucoup plus inquiétant – par ceux-là même que la postérité retient comme ayant été les grands scientifiques de leur temps. Ainsi Mendel n’était pas un humble moine reclus dans un monastère de Tchécoslovaquie. Il avait eu l’occasion d’exposer ses résultats devant les meilleurs biologistes de l’époque qui l’avaient écouté avec une attention polie et l’ignorèrent en toute connaissance de cause (Cf . “La Logique du Vivant”, p.4). Evariste Galois ne s’était pas fait recaler que par l’examinateur de l’Ecole Polytechnique: il avait soumis ses manuscrits aux plus grands mathématiciens de son temps, Jacoby, Poisson, et même Gauss. Et pourtant, la marge d’appréciation personnelle en mathématique devrait être plus faible qu’en biologie. Le même Gauss, occupant une position dominante à son époque, avait construit une géométrie non-euclidienne mais n’osa jamais la publier (voir Imre Toth dans La Recherche: comment les géométries non-euclidiennes avaient rencontré une opposition quasi-unanime). De l’autocensure de Gauss on peut passer au suicide de Boltzmann, inventeur de la thermodynamique statistique, rencontrant une telle opposition qu’il finit par douter de sa propre théorie.
Le jeune chercheur a souvent une connaissance incomplète des faits expérimentaux ce qui lui permet éventuellement de se forger des conceptions qui ne sont pas trop marquées par le savoir du moment. De telles conceptions sont immédiatement réfutées par les scientifiques de rang plus élevé qui n’ont aucun mal à évoquer des expériences dont le résultat paraît inconciliable avec l’idée du jeune chercheur. En bonne logique Poppérienne, l’idée ayant été falsifiée par l’expérience, elle doit être condamnée, et le jeune chercheur se sent alors coupable de n’avoir pas bien fait sa bibliographie, et s’incline devant le savoir supérieur de ses aînés. Or, les faits expérimentaux construits par la science sont marqués par les conceptions qui leur ont donné naissance. Derrière chaque expérience, il y a des présupposés théoriques que l’expérience, par construction, saurait difficilement invalider. Les conceptions théoriques dominantes sont utilisées pour classer les faits expérimentaux en “hard facts” – les faits réels – et “artefacts”- les faits qui n’ont pas le droit d’exister. Quand on soumet un article expérimental dont les conclusions sont contraires aux conceptions dominantes, le travail du rapporteur consiste à détecter toutes les sources possibles d’artefacts, et demander aux auteurs d’effectuer les contrôles correspondants. Les mêmes normes de rigueur ne sont pas requises pour les articles orthodoxes. Par conséquent, les “hard facts” sont le plus souvent présentés sans contrôle sérieux et peuvent bien être des artefacts. Les jeunes chercheurs ont vite fait de comprendre que s’ils veulent être appréciés selon les critères objectifs – publier, être cité, être invité – et cela devient vital pour obtenir un poste, ils ont intérêt à se cantonner à la plus stricte orthodoxie. Ce qui me paraît le plus grave dans cette situation est que le jeune chercheur peut être pris au piège: la nécessité devient vertu, ils finissent par croire à l’orthodoxie. J’ai vu autour de moi plusieurs intelligences s’éteindre ainsi.
Thomas Jukes s’est fait le défenseur du système actuel dans la revue “Nature” (265, 203, 1977) où il tient une chronique bimensuelle. Ses arguments ne manquent pas de saveur, quand on les replace dans leur contexte.
“La science -dit Jukes- est essentiellement hiérarchique: son progrès et son intégrité dépendent d’un “establishment”, et sur le rejet des résultats expérimentaux non contrôlés ou non répétables. Il y a des objecteurs qui disent qu’une telle rigidité empêche certaines innovations valables de voir le jour. On peut y répondre par une analogie darwinienne: de telles innovations sont pareilles aux classes de mutations extrêmement rares qui sont bénéfiques à l’espèce et par conséquent surmontent toutes les probabilités défavorables à leur survie et leur diffusion (… and hence overcome all odds against their survival and spread)”.
Jukes cite alors l’exemple suivant: le jeune Bohr, inventeur d’un nouveau modèle de l’atome avait soumis son idée à une revue qui la rejeta, après le rapport négatif de Rutherford. Mais le jeune génie, nous dit Jukes fit le voyage de Danemark en Angleterre, se confronta à Rutherford, et marqua son point: l’article fameux fut publié.
Ce recours à l’analogie darwinienne pour justifier le système actuel est plutôt cocasse. D’abord cette vision de l’évolution où le bon caractère triomphe en dépit des probabilités défavorables est plus proche de Lyssenko que de Darwin. Ensuite, Jukes est justement un « spécialiste » de l’évolution, que l’on trouve aux postes de responsabilité dans tous les journaux qui traitent d’évolution moléculaire. Il est un des principaux censeurs de la discipline. C’est le Guy Lux de l’évolution moléculaire qui doit sa gloire au talent avec lequel il propage les platitudes et les idées creuses.
L’anecdote relative à Bohr n’est pas moins intéressante. Il est très significatif que l’auteur d’une nouvelle théorie de l’atome soit obligé, pour publier, de passer par l’auteur de l’ancienne théorie qu’il veut combattre. Et si Rutherford ne s’était pas laissé convaincre? Et si Bohr n’avait pas eu les moyens de faire le voyage?
Mais le véritable intérêt de l’histoire est son origine. Jukes nous dit l’avoir empruntée à une conférence donnée par Emilio Segré. Or, Segré ne doit-il pas son prix Nobel de physique à un vol qualifié suivi de menaces pour contraindre au silence celui dont il avait piqué l’idée (Cf. La Recherche, sept. 72)? Comme quoi il n’est guère surprenant que l’idéologie secrétée par l’establishment scientifique soit tout à fait conforme aux intérêts dudit establishment.
Une science française?
Quand nous soumettons notre travail au jugement du comité de rédaction d’une revue américaine ou britannique, nous offrons aux scientifiques de langue anglaise le privilège de nous juger, donc d’influencer en retour la recherche qui se fait en France. Or, il existe des traits particuliers à la culture et la pensée française qui permettent justement de donner une coloration originale à nos travaux. Mis à part quelques rares exceptions, le référé anglo-saxon juge par rapport à ses conceptions, auxquelles il donne une valeur normative. Tout ce qui n’est pas compris ou admis par lui est considéré comme faux.
La distinction traditionnelle entre le courant « hypothético-déductif » pratiqué par les latins et le courant « inductif » des Anglo-Saxons est réelle. Il m’est généralement impossible de suivre un raisonnement anglo-saxon dans sa forme originale: il me faut reprendre les hypothèses et les arguments et les ordonner différemment, de manière à rétablir, du point de vue de ma logique française le point de départ et le chemin de l’auteur. Réciproquement, quand j’écris un article théorique avec ma logique déductive en étant aussi rigoureux que possible, le référé anglo-saxon n’y voit qu’un discours incohérent, un conglomérat de spéculations vagues. Pour publier dans des revues « internationales », je suis donc contraint de falsifier ma propre pensée pour la rendre plus conforme aux normes de la logique inductive pratiquée par les Anglo-Saxons. Et je ne suis pas le seul. Lisons Darwin:
« Me trouvant en qualité de naturaliste à bord du vaisseau de Sa Majesté Le Beagle, divers faits (…) m’ont particulièrement frappé. Ces faits (…) m’ont paru jeter quelque lumière sur l’origine de l’espèce (…). Revenu de mon voyage, en 1937, il me parut qu’en accumulant avec patience et en méditant sur les faits de toute nature qui se rattachent à la question, quelques pas vers la solution pourraient être faits. Après cinq années de recherches (…), je les développai, en 1844, sous la forme d’une esquisse des conclusions qui me parurent alors probables (…). (L’Origine des Espèces, traduction J.-J. Mouliné aux éditions Marabout).
Il faut une bonne dose de naïveté pour croire à cette version du cheminement de Darwin selon laquelle il aurait d’abord accumulé avec patience pendant cinq ans des faits se rattachant à l’origine des espèces pour dégager en fin de compte les conclusions qui lui parurent alors probables.
L’idéologie anglo-saxonne à laquelle nos sommes tous tenus de nous soumettre n’est pas toujours perçue par le chercheur français, pour une bonne raison: dans une large mesure, l’élite scientifique française est déjà le résultat de la sélection effectuée dans nos rangs par les Anglo-Saxons. Souvent donc le jeune chercheur est formé – par des Français – à l’école anglo-saxonne. Je n’ai pas la place ici de faire une analyse de l’idéologie dominante telle qu’elle nous est subtilement imposée dans les « instructions aux auteurs » des revues et les rapports de référés. Je me limiterai à un aspect, le culte du « hard fact ».
Il est remarquable que de nombreux journaux dans ma discipline (la biochimie) n’acceptent que les articles expérimentaux, ou privilégient fortement ceux-ci. En d’autres termes, si M. X… publie ses résultats dans un de ces journaux, et les interprète de manière aberrante, en induisant en erreur la majorité des lecteurs du journal, M. Y… n’a pas le droit, dans le même journal de proposer une interprétation nouvelle des expériences de M. X… Ou alors, il lui faudra répéter les expériences de M. X… et acquérir ainsi un « droit d’interprétation ». Le lecteur choisira alors entre la théorie de M. X… et celle de M. Y… selon que les données expérimentales de l’un ou de l’autre paraîtront les plus solides. Les auteurs des articles qui contiennent suffisamment de « hard facts » ont le droit dans la section réservée à la discussion, de se défouler en proposant l’interprétation de leur choix, dont la cohérence importe peu. Mais si on veut avancer une explication contraire, on est obligé de payer un droit de péage, qui est la production de hard facts de qualité équivalente aux précédents. Le système actuel qui subordonne la diffusion des idées théoriques à la production de hard facts privilégie les gros laboratoires qui peuvent produire, même sans moyens intellectuels, les faits expérimentaux dont se nourrit le savoir, et dont ils se servent pour annexer les idées qui peuvent en résulter.
Enfin l’obligation de publier en langue anglaise nous conduit à dénaturer notre travail, non seulement pour les raisons idéologiques invoquées plus haut, mais aussi pour des raisons purement linguistiques (voir P. Routhier: « le français, langue scientifique: un combat à mener », La Recherche, juillet-août 77). Routhier dit notamment:
« Tissu de relations mouvantes et sans cesse en discussion, la science exige aussi de s’exprimer par des phrases, où chaque mot doit être soupesé (…). Dès lors, dans bien des circonstances, l’incapacité à trouver l’expression la plus juste en anglais peut devenir une véritable infirmité. Vaille que vaille, on sacrifie, on « équarrit », et on se retrouve avec un message scientifique à délivrer avec 500 à 600 mots de « basic English »: si encore ils étaient correctement et élégamment assemblés!… »
Quand nous avons une idée complexe à exprimer, elle prend la forme d’une phrase complexe de plusieurs lignes avec une proposition principale et trois ou quatre subordonnées. La même idée transcrite en anglais serait tronçonnée en quatre ou cinq petites phrases à la queue leu leu. Cette forme ne saurait pour nous refléter le tissu de notre pensée, et nous préférons être traduits en conservant la structure des phrases. Or, les facultés de compréhension grammaticale du référé anglo-saxon moyen ne lui permettent pas en général d’aller au-delà du quinzième mot dans une phrase.
Propositions
Il est possible d’agir selon deux axes: organiser des moyens de défense et de recours contre certaines pratiques scandaleuses, promouvoir en France une presse scientifique offrant de meilleures garanties que le système actuel.
Sur le plan défensif, il serait souhaitable de préparer des dossiers ou livres noirs qui mettent en lumière les pratiques inadmissibles de telle ou telle revue. En particulier, on pourrait collecter les rapports de référés et dégager ainsi les lignes majeures d’abus. Certains rapports sont aberrants, indépendamment du texte analysé. Par exemple, quand un référé écrit: « l’idée présentée par M. X… n’est pas neuve, et bien que je ne puisse indiquer aucune référence précise, je suis sûr d’en avoir eu communication – oralement du moins – de M. U. ou de M. V., à moins qu’il ne s’agisse de M. W. » – il est clair qu’il est prêt à toutes les malhonnêtetés. Une fois constitué le dossier noir, on pourrait dégager des lignes d’action plus offensives. Il nous faut d’abord surmonter l’obstacle de l’autocensure.
En ce qui concerne la presse française, je soumets deux propositions:
1- Il nous faut être normatifs, c’est à dire porter explicitement des appréciations sur les travaux qui se font en France et à l’étranger. L’importance de la revue « Nature » tient à mon avis à son caractère normatif: à la hiérarchie qui y est établie entre les articles et les lettres, à l’importance de la section News and Views où l’on dit tout haut quels sont les bons et les mauvais travaux. Les Français, semble-t-il, acceptent trop sereinement de se laisser juger par l’étranger sans se donner les moyens de porter des contre jugements. Il faut absolument arracher à « Nature » le monopole de fait qu’elle a sur l’appréciation de la science en cours, tout en évitant d sombrer comme elle dans le copinage. Le principe mis en oeuvre par La Recherche: séparer les nouvelles de France et celles de l’étranger me semble bon. Il nous faut des revues normatives françaises qui s’attachent à promouvoir les produits locaux tout en faisant une juste place aux produits étrangers.
2- On devrait accroître les garanties. Si un article est refusé, et que l’auteur n’est pas convaincu de la justesse de la décision, il doit pouvoir obtenir que le résumé de son texte paraisse quand même. La revue ferait paraître le résumé, accompagné d’appréciations succinctes des référés motivant le refus. En revanche, la revue pourrait devenir plus sélective, et exiger des textes plus courts.
Ce dernier point me paraît particulièrement important dans le contexte français. Aux Etats-Unis, le chercheur qui a une idée originale a une gamme énorme de possibilités pour laisser quelque part la trace de son idée, ce qui lui permet d’obtenir ou préserver la priorité. En France, trop souvent, un secteur est sous le contrôle de deux ou trois personnes au plus, et quand celles-ci font barrage, il n’y a plus d’espoir. J’ai constaté à plus d’une reprise, ayant eu des idées originales, que certains responsables préféraient qu’un étranger me dépouille de ces idées, plutôt que de m’aider à les publier, et ce faisant, risquer de déplaire aux collègues anglais ou américains dont ils sont les porte-parole en France. Il y a fort heureusement des exceptions, et j’ai aussi rencontré des Français qui se sont « mouillés » pour m’aider. Une mesure à étudier serait que tout article publié soit suivi de rapports succincts, signés. Cela forcerait les référés à faire une lecture pertinente et sérieuse des textes qui leur sont soumis. Les analphabètes qui pratiquent le contresens systématique seraient vite repérés. De plus, cela fournirait une formidable source de réflexions pour les épistémologues.
Pour mettre en place le système que je propose, on pourrait utiliser le principe du remplacement évolutif. Une revue pourrait fonctionner avec une double équipe rédactionnelle. L’équipe N°2 prendrait en charge la confection d’une partie, au départ réduite, des numéros de la revue, selon les principes que j’ai suggérés. Les auteurs auraient le droit de choisir l’équipe à laquelle ils confient leur manuscrit. Une telle opération peut être réalisée sans risque financier. Mon ambition à long terme est, en changeant les pratiques éditoriales, de modifier en retour, et en profondeur, le style même du travail scientifique.
Annexe: la pratique des citations
La proposition d’utiliser le nombre de citations que recueille un article comme critère de valeur de son contenu scientifique a fait l’objet de nombreuses critiques (voir ref. 3: liste non exhaustive). A celles-ci j’ajouterai quelques précisions et remarques personnelles.
Si on prend la liste des 50 articles les plus cités dans la période 1961-1962 (4) on remarque que presque tous ces articles sont purement techniques, décrivant des procédures expérimentales d’usage courant: méthode pour mesurer la concentration des protéines, pour isoler les lipides, pour teinter des échantillons avant analyse au microscope électronique, etc. Le premier article non technique occupe le rang 21 (la régulation: Jacob et Monod), le second article non technique occupe le rang 34 (la supraconductivité: Bardeen, Cooper et Schrieffer). Si dans la liste de ces 50 articles on fait le total des citations pour les articles techniques d’une part, et les articles conceptuels de l’autre, on trouve:
Articles techniques: 137.000
Articles conceptuels: 7.300
En s’appuyant sur ce genre de données, on arrive rapidement à la conclusion que les mises au point techniques sont plus importantes que les déterminations structurales qui font plus honneur à la science que les constructions de modèles lesquelles sont plus sérieuses que les approche conceptuelles et épistémologiques. Il n’est plus possible de douter qu’en psychologie, les behaviouristes détiennent la vérité contre les gestaltistes et les éthologistes. Garfield a été traité d’empiriste dans son propre pays, celui de l’empirisme (Science, 182, 1196, 1973). Les différences énormes qui existent entre les taux de citation des articles ne peuvent aucunement être corrélés avec le seul mérite scientifique. Voici un exemple emprunté à la biologie moléculaire. Je donne les citations recueillies par trois articles d’importance inégale, dans les années 65-69.
Lineweaver et Burk: JACS 56, 658 (1934) 1.675 citations
Watson et Crick: Nature, 171, 737 (1953) 195 citations
Dounce: Enzymologia 15, 251 (1952) 2 citations
Le premier de ces trois articles est d’une importance tout à fait négligeable. J’analyse plus bas les raisons de sa popularité. Dans le troisième article (2 citations en cinq ans) Dounce présentait, pour la première fois, l’idée centrale de toute la biologie moléculaire: le code génétique. Non seulement Dounce était arrivé au concept correct (avant même que ne soit connue la structure de l’ADN: Watson et Crick, 1953) mais il avait proposé dans cet article des idées sur la biosynthèse des protéines qui étaient d’au moins dix ans en avance sur le savoir de l’époque. La période 64-69 est justement celle de l’élucidation du code génétique. Pas un des articles expérimentaux qui ont fait avancer notre connaissance du code ne fait référence à Dounce. On peut d’ailleurs vérifier, en lisant les Instructions aux Auteurs des différentes revues que si les théoriciens sont tenus de charpenter solidement leurs arguments en s’appuyant sur les données expérimentales, il n’est jamais demandé aux expérimentateurs d’expliquer comment ils ont formé leurs concepts. La popularité de l’article de Watson et Crick – dérisoire si on le compare par ailleurs aux articles purement techniques – tient sans doute à la position dominante occupée par Crick à Cambridge autant qu’aux facteurs purement scientifiques.
Certains auteurs tentent de fournir des fondements théoriques à ce genre d’injustices. Ainsi Gunther Stent dans un article célèbre de « Scientific American » (dec. 1972) a introduit le concept de découverte scientifique prématurée. Autrefois, quand on était en avance, on était précoce. Au temps des critères objectifs, celui qui est en avance a tort, il devrait même avoir honte: sa découverte est prématurée. Comme le montre Stent, elle ne sert à rien.
LA CITATION-ALIBI
J’ai longtemps été intrigué par l’extraordinaire popularité de l’article qui occupe le rang 10 (plus de 3600 citations dans la période 61-72). Il s’agit d’un article de Lineweaver et Burk, paru en 1934. De quoi s’agit-il?
L’expérience la plus courante, en enzymologie consiste à mesurer la vitesse d’une réaction (v) en fonction de la concentration d’un des réactants (s). L’étude de la relation entre v et s renseigne sur le mécanisme de la réaction. Il se trouve que pour le « modèle minimal »: le mécanisme le plus simple auquel on puisse penser pour une réaction enzymatique, la loi v = f(s) a la forme d’une relation linéaire entre 1/v et 1/s. L’apport de Lineweaver et Burk a consisté à présenter, pour la première fois semble-t-il (mais il serait intéressant de s’en assurer) les résultats expérimentaux dans un graphique ayant 1/v en ordonnées et 1/s en abcisses. Il s’agit là d’une petite astuce que n’importe qui, à n’importe quel moment aurait pu trouver ou réinventer. Il paraît surprenant que cet article de portée minime soit cité 5 à 10 fois plus souvent que, par exemple, l’article de Watson et Crick sur la structure de l’ADN. En fait, ce n’est pas sans raison. Après avoir porté les points expérimentaux dans le système de coordonnées de LIneweaver et Burk, on peut déterminer deux constantes cinétiques, appelons-les V et K qui ont une signification précise dans les cas du modèle minimal. Or, il se trouve que bien des réactions qui se déroulent selon des schémas différents du modèle minimal donnent aussi des graphes où 1/v varie de façon quasi-linéaire en fonction de 1/s. La constante K que l’on tire alors du graphique n’a pratiquement plus aucun sens. Du point de vue de celui qui veut comprendre les choses, la représentation de Lineweaver et Burk est donc la plus mauvaise qui soit – d’autres l’ont dit avant moi – elle linéarise n’importe quoi et conduit ainsi à une constante phénoménologique qui ne veut à peu près rien dire. L’enzymologiste qui cite Lineweaver et Burk le fait donc pour se donner bonne conscience, évitant de poser la question de la signification réelle de ses résultats.
En tête des articles ou ouvrages les plus cités en mathématique, on trouve un groupement de travaux ou manuels de statistique, qui occupent les cinq premières places au palmarès 61-72. On pourrait donc en conclure, en suivant Garfield, que les statistiques sont plus importantes que la géométrie, la topologie, le calcul infinitésimal, etc. Les cinq ouvrages ou articles de statistique totalisent 10.000 citations, soit autant que les trente-trois articles ou ouvrages qui les suivent dans la liste. La popularité des articles de statistique relève à mon avis de la même explication que celle de l’article de Lineweaver et Burk. Bien que cela n’ait pas été voulu par ses fondateurs, la statistique est l’instrument du mensonge par excellence. On peut, à l’aide de tests statistiques, montrer que des résultats sont « significatifs », donc publiables, alors que l’analyse épistémologique et méthodologique montrerait aisément qu’ils n’ont aucun sens.
De manière générale, en dehors des cas rarissimes où un auteur cite pour indiquer la filiation de ses idées et de son travail, il me semble que la citation obéit à deux motivations essentielles:
motivation de politique: pour que l’article soit accepté, pour susciter des renvois d’ascenseur, etc. Cet aspect est bien connu, aussi n’en ai-je pas discuté en détail.
motivation de crédibilité: pour évacuer les discussions épineuses et nécessaires qui pourraient remettre en cause la validité de telle approche expérimentale ou de telle interprétation des résultats, on jette au lecteur une citation qui l’exorcise, destinée à dissiper les mauvaises tentations du scepticisme. C’est la citation alibi.
REFERENCES
(1) N. Wade. Trends in Biochemical Science 1, N322 (1976); Science 188, 429 (1975); voir aussi D. Shapley Science, 191, 54 (1976) et P.M. Boffey, Science, 191, 1031 (1976).
(2) E. Garfield, La Recherche, 70, 757 (1976); Current Contents 19 n°4 p. 5 (1976); n°22 p. 5 (1971); n°34, p. 4 (1970); n°40, p.5 (1973); n° 42, p. 5 (1972); voir aussi J. Margolis, Science 155, 1213 (1967).
(3) Dans Nature: D.L. Croom, 227, 1173 (1970); J. Friday, 243, 367 (1973); P.T.P. Oliver, 227, 870 (1970); D. Davies, 228, 1356 (1970); R. Over et S. Smallman, 228, 1357 (1970); M.M. Benarie, 265, 204 (1977); A. Comfort, 227, 1069 (1970); dans Science : N.C. Janke, 182, 1196 (1973) et 156, 882 (1967); R.W. Bide, 182, 1197 (1973); G. Kittel, 183, 703 (1974); K.O. May, 156, 891 (1967).
(4) E. Garfield, Current Contents, n°2, p. 5 (1974).