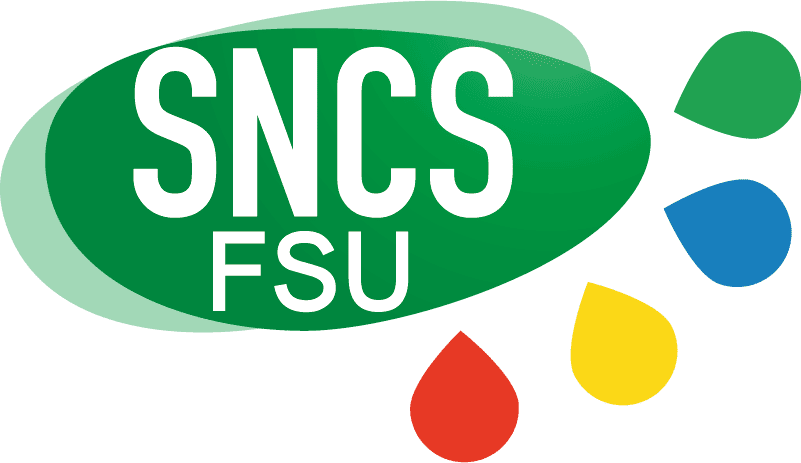Quel futur pour les jeunes chercheurs (et les chercheurs) ? : SNCS-HEBDO 07 n°16 du 12 juillet 2007
Le premier « chantier » ouvert par le ministère est celui des jeunes chercheurs. Cette question est effectivement un nœud stratégique : important pour l’attractivité actuelle des filières scientifiques, il définit les conditions futures d’exercice du métier d’enseignant-chercheur et de chercheur, et pas seulement celles des jeunes. Par son effet sur les modes de fonctionnement, en particulier par l’association avec les modifications structurelles issues du « pacte », il porte un potentiel d’altération profonde du système de recherche et d’enseignement supérieur public.
Denis Jouan, membre du bureau national du SNCS-FSU
Alors que les assises ont à peine démarré et que la loi sur l’autonomie des universités rencontre l’opposition d’une part importante de la communauté scientifique, le ministère lance de son côté une série de cinq chantiers. Après la réussite en licence et les conditions de vie des étudiants, ce troisième chantier concerne les jeunes chercheurs, c’est-à-dire les améliorations sur le statut et les conditions de travail des chercheurs et enseignants-chercheurs du début de la thèse jusqu’à l’installation « dans un emploi pérenne ». La première réunion a eu lieu le 9 juillet. Avec une volonté affichée d’aller vite, par étapes successives, dès qu’un « consensus suffisant est atteint ». Le groupe de travail annoncé ressemblait à une conférence : la ministre a tout d’abord prononcé un discours (cf. site du ministère), de courtes interventions ont été faites dans la salle, surtout émanant des syndicats, puis la ministre a donné quelques réponses. Des représentants d’établissements, d’agences et d’associations étaient aussi présents en nombre, ainsi que le Medef. À l’automne, les premières mesures seront mises en place : revalorisation de l’allocation de thèse, extension du monitorat, augmentation du nombre de thèses financées (2/3 actuellement), extinction des libéralités.
Pendant l’été, l’inspection générale va produire un rapport concernant l’application de la loi (avril 2006) sur les écoles doctorales, mais surtout le CSRT rendra un rapport prenant notamment en compte les remarques que les participants sont incités à transmettre rapidement. La deuxième étape de réflexion porte en particulier sur le métier de doctorant, la valorisation du diplôme dans le privé, l’insertion des docteurs dans le public (y compris administration) et le privé dans un contexte d’augmentation du nombre de thèses. Le Medef entrevoit des risques de blocage autour de la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives
Les premières mesures vont dans le sens de nos revendications (cf. congrès SNCS de 2003) concernant les conditions d’emploi avant ou juste après la thèse, notamment pour que cesse enfin la pratique des « libéralités » privant les jeunes chercheurs de droits sociaux. Il faut d’ailleurs aller plus loin et revaloriser l’ensemble des carrières. La période la plus critique pour le jeune chercheur se situe juste après la thèse, c’est aussi le point où nous pourrons juger des intentions réelles de la ministre qui affirme vouloir lutter contre la précarité qui pénalise peut-être un peu plus encore les femmes.
Quelles garanties que le modèle mis en place autour de la thèse ne s’étende pas à une période plus longue alors que les lois « pacte » et « autonomie » multiplient les sources d’emplois temporaires, et que la charte européenne du chercheur – qui paraît promouvoir la carrière de CDD hyper-mobile – tend à devenir pour certains DRH l’objectif standard, au lieu d’un minimum exigible dans les régions les moins avancées ?
Avec les RTRA, l’ANR et l’AERES, discussion et évaluation des politiques et activités scientifiques échappent aux instances représentatives des chercheurs. Il y a un risque de fonctionnement sur contrats précaires avec une gestion administrative de la recherche par projets, piloté par l’aval avec les pôles de compétitivité. La ministre a d’ailleurs évoqué des sujets de thèse permettant une « mission de conseil » auprès d’entreprises. Cela souligne la nécessité d’un service public qui a du sens et des moyens, pour ne pas être placé en situation de dépendance par rapport au privé.
C’est aussi une composante de l’attractivité des métiers scientifiques : il faut respecter l’intégrité du métier de chercheur. Plus de libertés, d’opportunité, de dynamisme oui, mais pas par un système de gestion anonyme et administratif qui impose ses choix à travers des contrats au mépris des démarches individuelles. L’arbitraire dans la fixation du temps de recherche dans le service des enseignants-chercheurs présente, entre autres, le danger d’en faire une variable d’ajustement.
Donner les moyens aux jeunes chercheurs passe par un recrutement jeune, sur statut de fonctionnaire : cela impose de restaurer une définition au grade de CR2. Une condition telle que « recrutement avant 6 ans après le début de thèse » (similaire dans son principe à une formulation de la charte européenne du chercheur) garantirait que 2/3 des recrutements dans les EPST s’effectuent peu après la thèse. Parallèlement, il faut mettre en place un plan d’intégration des CDD, réaliser un suivi détaillé de la précarité, et bien sûr créer des postes permanents : 5 000 postes supplémentaires par an pour l’enseignement supérieur et la recherche.SNCS-HEBDO 07 n°16