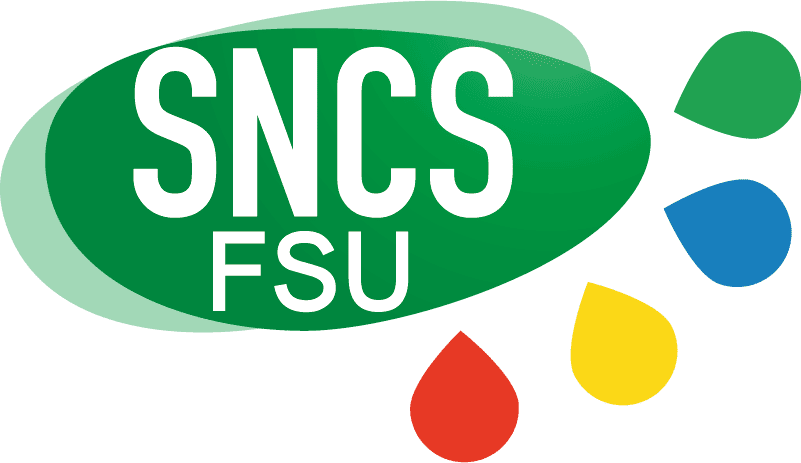Petits meurtres en coulisse : SNCS-HEBDO 07 n°10 du 30 mai 2007
Pendant que se prépare le vote à la hussarde d’une loi sur « l’autonomie » des universités, un petit meurtre se déroule en coulisse : celui des organismes. Depuis vingt ans, la droite a une obsession anti-organismes et a tenté de les réduire après chaque victoire. Ils sont trop « autonomes » se justifie-t-elle.
Henri-Edouard Audier, membre du bureau national du SNCS-FSU
Dès le retour de la droite au pouvoir en 1986, un projet de loi mort-né proposait simplement la suppression du CNRS, de l’INSERM et de l’INRA. En 1995, le CNRS ne garda que le tiers de ses unités mixtes avec l’université, les autres devenant des « unités propres de l’enseignement supérieur associées au CNRS », sans qu’il fût donné aux universités les moyens de les reprendre. C’est le gouvernement Jospin qui mit fin à l’hémorragie, même si Allègre prônait « une structuration péri-universitaire de la recherche ». En plein milieu de la crise de 2004, le directeur général, Bernard Larrouturou, proposait un CNRS rabougri, abandonnant « les équipes liées » aux universités.
Aujourd’hui, et ce n’est donc pas un problème de personne, la direction discute de réformes de structures repliant le CNRS sur quelques bastions recréant les instituts propres, ou regroupant son personnel dans des équipes au sein de labos universitaires ; le restant passant sous la seule tutelle universitaire. Pression du gouvernement et/ou anticipation de ses décisions pour sauver les meubles ? Prélude à la « transformation des organismes en agences de moyens », à la gestion par « les seules universités d’unités actuellement partagées avec les autres organismes nationaux », à la liberté des universités de « choisir leurs chercheurs permanents » ? Une politique de « désassociation » semble enclenchée. Directive a été donnée aux directeurs scientifiques de se débarrasser d’unités sans qu’il y ait eu demande du Comité national. Alerte pour tous les organismes.
Nul ne conteste l’impératif de redresser les universités et de créer des partenariats plus équilibrés entre universités et organismes. Mais cela ne peut se faire en faisant agoniser les organismes mais, au contraire, en renforçant les universités : encourager l’élaboration d’une politique, leur en donner les moyens, développer l’évaluation sur les principes du Comité national, favoriser les coopérations, rénover les structures, etc.
Nul ne conteste la nécessité d’autonomie des universités. Mais ce terme, véritable auberge espagnole, n’a de contenu qu’en définissant les objectifs de formation, la place des universités dans le système de recherche et la programmation de ses moyens. Pour parodier Molière : sans argent, l’autonomie n’est qu’une maladie. Celle proposée par le gouvernement n’est qu’un leurre dangereux.
En effet, les laboratoires universitaires vont devoir, plus encore, dépendre de structures aux mains du gouvernement, l’ANR et l’AERES : « l’État doit financer la recherche publique sur la base d’appels à projets et non sur la base de structures. […] L’ANR ne concerne que 6 % des crédits publics de la recherche » déplore Sarkozy.
Son autonomie ne vise pas à développer des coopérations équitables public-privé, mais à assurer la domination du secteur privé : il faut « associer directement l’entreprise à la gouvernance et au financement des universités ». C’est par « ce milieu plus ouvert » ayant perdu ses références publiques et nationales que Sarkozy veut assujettir au privé l’ensemble de la recherche publique.
Son autonomie, c’est la concurrence systématique entre universités, ne serait-ce qu’au travers des salaires puisque les universités pourront « rémunérer comme elles le souhaitent ». Il s’agit de miser sur quelques universités « d’élite » et quelques grandes écoles, sans pour autant rapprocher les deux systèmes. « Quant au rapprochement entre universités et grandes écoles, l’autonomie des universités est le meilleur gage de réussite ».
Pour les jeunes, pas de plan pluriannuel pour l’emploi. Sarkozy propose seulement un nouveau statut de CDD. « Pour renforcer l’attractivité de la recherche, je proposerai aux jeunes docteurs des contrats de cinq ans » répond Sarkozy. Quelle attractivité ! On ne pourra plus parler de « la France qui tombe ». Mais de la France qui coule.SNCS-HEBDO 07 n°10