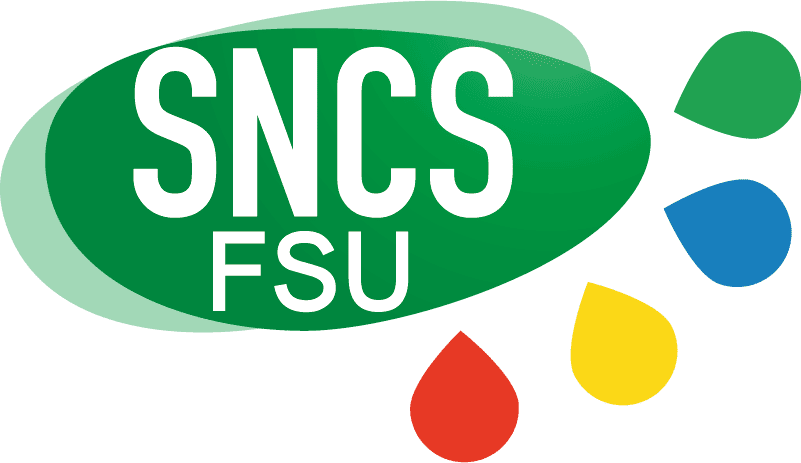SNCS-HEBDO 06 n°14 du 5 avril 2006
Conseil d’expertise collective : l’avis du bureau national Inserm du SNCS-FSU
Dans un contexte où la définition des choix scientifiques et technologiques, la gestion de leurs conséquences pour l’environnement et la santé occupait une place croissante dans le débat public, il apparaissait nécessaire de mieux définir les liens complexes entre l’état des connaissances scientifiques à un instant donné et la prise de décisions politiques.
L’expertise collective a donc été mise en place à l’Inserm, tout d’abord sous la forme d’un bureau de l’expertise collective en 1993, puis en 1995, sous la forme de service commun de l’Inserm. L’objectif était d’établir pour un sujet donné, la synthèse de l’état des connaissances scientifiques existantes, incluant une appréciation des doutes et une description circonstanciée des controverses pour permettre le débat public et mieux asseoir la décision politique.
Depuis 1994, 52 expertises collectives ont été réalisées à l’Inserm à la demande de ministères, notamment de la Santé, des Caisses d’assurance maladie, des mutuelles, de la Direction générale de la santé ou de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
La procédure d’expertise collective telle qu’elle fonctionne aujourd’hui à l’Inserm, comporte plusieurs étapes : constitution d’un groupe d’experts, recherche bibliographique à partir de mots-clés définis pour les différentes disciplines concernées et le thème de l’expertise, travail d’analyse des experts, synthèse et recommandations. Le choix des experts est fait par le service commun d’expertise collective après avis du directeur général de l’Inserm.
En 1995, le Conseil scientifique de l’Inserm avait particulièrement insisté sur la mise en place d’un comité d’orientation indépendant du groupe d’experts et du service commun, et demandé qu’il soit consulté de façon active aux différentes étapes de la procédure d’expertise collective.
Il soulignait également que dans le cadre d’une expertise collective :
1) le rôle de l’Inserm consistait à animer un groupe pluridisciplinaire d’experts s’efforçant de faire une synthèse de la littérature scientifique internationale, dégageant les lignes de force pertinentes et identifiant les domaines d’incertitudes ;
2) en revanche, c’est aux pouvoirs publics et aux autres acteurs sociaux de forger les procédures appropriées d’aide directe à la décision, sauf à entretenir l’illusion dangereuse d’un « gouvernement des scientifiques ».
Quand une procédure d’expertise est mise en place, quel que soit le domaine concerné, elle se développe dans un cadre marqué par l’absence de certitudes. Le travail du groupe d’experts va donc mettre en évidence des divergences d’appréciation qui seront d’autant plus importantes que les spécialités de chacun des membres seront plus éloignées.
Deux évolutions alors sont possibles : soit l’expertise va refléter la diversité des opinions, soit un consensus va être recherché pour présenter une vision unique intégrée.
Les expertises juridiques fonctionnent souvent selon la première modalité.
Les conférences de consensus, telles qu’elles se sont développées, en particulier en médecine, fonctionnent selon la seconde modalité.
Les expertises scientifiques ont également tendance à rechercher le consensus, notamment s’il se forge à l’intérieur du comité d’experts une tendance favorable à n’envisager qu’un des aspects de la problématique. Les conséquences de ce mode de fonctionnement sont généralement mal appréciées par les protagonistes.
Le choix du groupe d’experts est donc un moment crucial pour l’expertise collective ; de ce point de vue, celui qui a été fait pour l’expertise sur le trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent, révèle des carences sérieuses en termes de sélection des champs disciplinaires.
Les lacunes les plus évidentes concernent les disciplines et les champs de recherche qui portent sur la question des normes sociales (sociologues, philosophes, historiens, sciences de l’éducation, éthique) puisque les experts comportaient uniquement trois psychologues, deux neurobiologistes et sept pédopsychiatres.
Cette absence a eu pour conséquence majeure la non-remise en question de la définition du « trouble des conduites » alors que, comme le soulignent récemment le président du Comité d’éthique de l’Inserm et le président du Comité consultatif national d’éthique dans leur article du 23 mars 2006 (Le Monde), il s’agit de la définition d’un « trouble » dont les frontières médico-judiciaires sont profondément ambiguës.
Un autre point crucial est celui des choix bibliographiques. En effet, tous les domaines scientifiques n’ont pas la même pratique pour la publication de leurs résultats ; les références pertinentes ne sont pas identiques en biologie et en sciences humaines et sociales par exemple car il n’est pas évident que la recherche à l’aide des banques de données classiques soit suffisamment informative dans des domaines comme les sciences sociales ou l’épistémologie, où nombre de résultats sont publiés sous forme de chapitres ou d’ouvrages.
Un point majeur pour le déroulement de l’expertise est la formulation des questions par le commanditaire. Cette formulation devrait être précise et engager nettement le commanditaire sur les motivations de sa demande, ce qui permettrait au service commun d’expertises de décider si la demande entre dans le cadre des règles déontologiques qu’il s’est fixées.
Cela pose aussi le problème des recommandations. Alors que la synthèse de la littérature et l’identification des lignes de force et des domaines d’incertitudes sont d’ordre descriptif, analytique et synthétique, les recommandations appartiennent, elles, à un autre registre et devraient être formulées comme des pistes de réflexion à discuter et non sous forme prescriptive. L’expertise ne devrait-elle pas proposer une réflexion ouverte sur la signification, les implications et les incertitudes, voire suggérer des recherches portant sur les éventuelles conséquences de telle ou telle piste possible ? Le Comité d’éthique de l’Inserm avait déjà recommandé que les expertises collectives ne formulent pas de recommandations en dehors de l’urgence.
Se pose enfin le problème de l’utilisation qui sera faite de l’expertise collective. C’est à cette étape qu’apparaissent, en règle générale, les faiblesses de la démarche de l’expertise, surtout si elle n’a pas pris en compte toutes les facettes de la problématique et que des recommandations peuvent être interprétées sous une forme trop normative.
L’expertise peut alors être utilisée par les politiques pour légitimer une décision dont les motivations réelles peuvent être totalement indépendantes de son résultat. Tel est malheureusement le cas de la dernière expertise de l’Inserm pour laquelle il était pourtant difficile :
1) d’ignorer le contexte politique dans lequel elle se situait, notamment le projet de loi de l’UMP sur la prévention de la délinquance (cf. rapport Benisti à l’Assemblée nationale, dont la première version est parue en septembre 2005) ;
2) de ne pas anticiper son instrumentalisation dans le cadre du projet de loi sur la prévention de la délinquance pour faire avaliser la médicalisation, la surveillance et éventuellement la stigmatisation de certains enfants en réponse aux problèmes sociaux d’une société inégalitaire.
La demande de la société d’être partie prenante des choix scientifiques et technologiques ne peut que s’amplifier. Il est donc indispensable de réfléchir aux procédures permettant la médiation adéquate entre les connaissances scientifiques et les décisions politiques et de procéder à l’Inserm à une évaluation objective des 10 ans de fonctionnement du service commun d’expertise collective, d’autant plus que le CNRS vient de faire récemment des propositions pour la création d’un dispositif d’expertise en son sein. Un comité consultatif indépendant chargé d’examiner l’ensemble des opérations tout au cours de l’expertise collective devrait impérativement être mis en place.