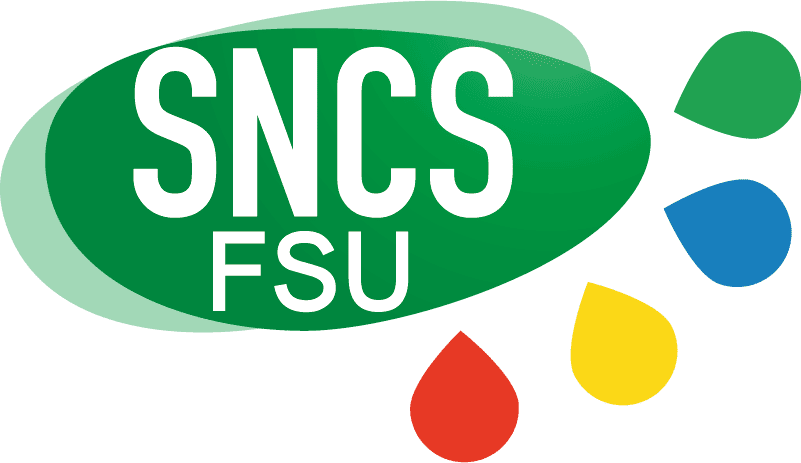Quand les sciences sont attaquées : désinformation, dénigrement, obstruction, invisibilisation…
- Parution
- 07/2025
- Numéro
- 441
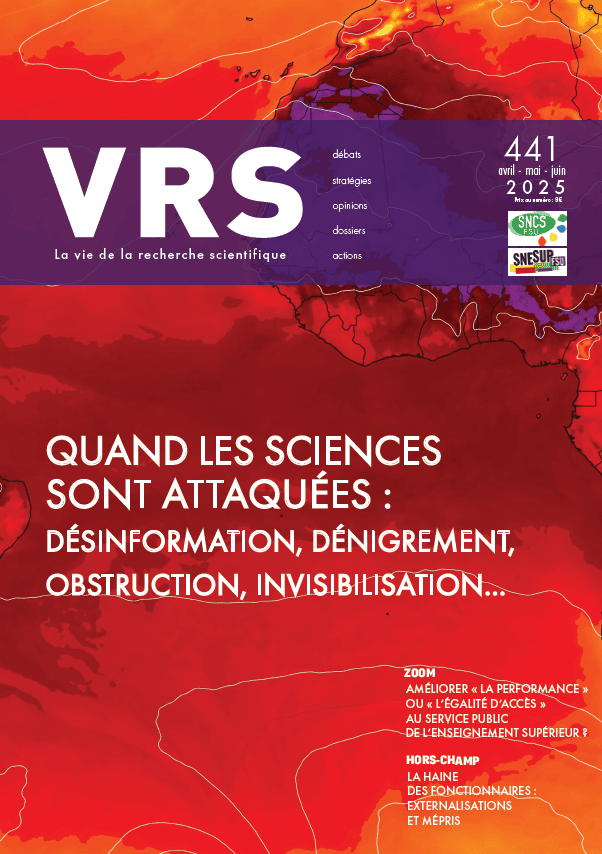
Edito par Hervé Christofol et Chantal Pacteau
Alors que les chercheurs et les ingénieurs manquent en France et que les étudiants se détournent des carrières de la recherche, nombre de médias et certains politiques ne cessent d’attaquer la parole des scientifiques. Alors que le budget de la recherche demeure une des variables d’ajustement de son budget, l’État repousse sine die l’objectif de 1 % du PIB consacré à la recherche publique. Alors que les effets du réchauffement climatique sont patents et confirment toutes les prévisions des modèles, les climatosceptiques ont table ouverte dans les chaînes d’information continue. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles défenses et quelles alternatives construire ?
Dans ce dossier, le philosophe Michel Blay développe les liens entre productivisme et sciences qui, dès le XVIIe siècle, ont objectifié la nature et piloté la recherche scientifique au profit d’un « progrès technique » qui conduit vers un « libertarisme technologique ». Les travaux de l’historien Christophe Bonneuil montrent comment les multinationales pétrolières ont excellé dans l’art de produire de l’ignorance et du doute face aux connaissances des sciences du climat au cours des cinquante dernières années. Quant au sociologue Olivier Alexandre, il analyse le monde académique face aux attaques et aux préjugés après vingt ans de désengagement progressif de l’État.
Le philosophe Mathias Girel, spécialiste de l’agnotologie, nous aide à distinguer les concepts de désinformation, production de l’ignorance, fake news, post-vérité ; concepts auxquels s’ajoute celui de « greenbacklash » que clarifie Jean-Michel Hupé, chercheur en écologie politique. Le mathématicien David Chavalarias témoigne, à partir de l’étude du traitement politico-médiatique de l’expérimentation HelloQuitteX, de stratégies de dénigrement des travaux des scientifiques, mises au point aux États-Unis qui semblent s’exporter en France.
Pourtant s’expérimentent aussi de nouvelles pratiques de production de savoirs qui rouvrent des possibilités d’agir autant qu’à faire progresser les connaissances, comme en témoignent les recherches transdisciplinaires rapportées ici par la sociologue Johanna Lees – en santé environnement – et, par l’équipe du CEARC, en sciences de la durabilité.
Ces approches réflexives nous invitent à penser à partir des communs pour nous émanciper du statu quo. C’est ce que propose le sociologue Christian Laval, pour sortir du paradigme capitaliste de l’accaparement des connaissances scientifiques et du pilotage de la recherche par les États : construire des communs de la connaissance.
Puisse notre communauté s’emparer de ces concepts pour défendre et promouvoir une recherche scientifique libre, au service de l’intérêt général et du bien commun..