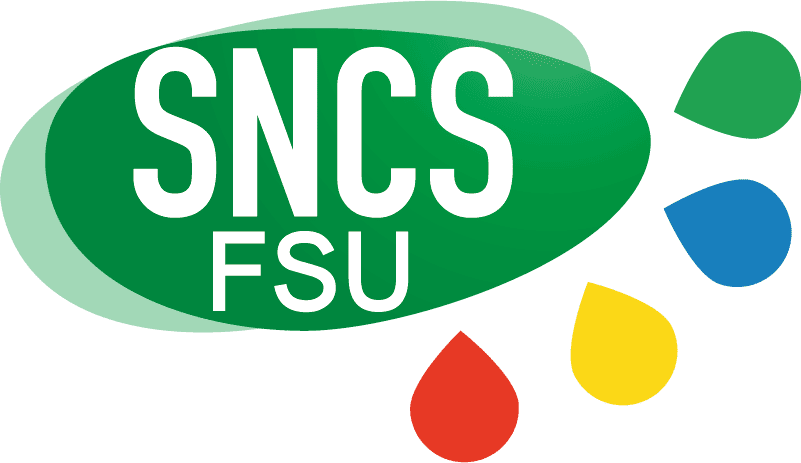Les temporalités handicapées : garantie de l’excellence scientifique
Comment penser l’excellence scientifique autrement que par la performance et la vitesse ? Les politiques actuelles de l’enseignement supérieur et de la recherche imposent une temporalité excluante – la chrono-normativité – qui pénalise, entre autres, les chercheurs et chercheuses handicapé-es et appauvrit la science elle-même. Le concept de crip time permet de reconnaître que la pluralité des rythmes de travail est non seulement une question de justice mais une condition de l’excellence scientifique.
Marion Ink
Sociologue
Chargée de recherche à l’INSERM
L’excellence scientifique, telle qu’elle est aujourd’hui définie, n’est pas neutre. Elle repose sur des rythmes et des conditions qui handicapent une partie de celles et ceux qui la font exister. Chaque année, un grand nombre de scientifiques reconnu-es par leurs pairs pour leurs avancées scientifiques originales, pour leurs engagements dans de nombreux projets collectifs, sont refusé-es à un recrutement, une promotion, voire même ne tentent pas d’y postuler. « Il manque de publications », « elle n’a pas fait de post-doctorat à l’étranger », « il n’a pas communiqué en anglais » sont les arguments avancés.
Les chercheurs et chercheuses que j’interroge et que je suis depuis 2019 sont en situation de handicap. Ils et elles sont malvoyant-es, aveugles, malentendant-es ou sourd-es, mais qu’est ce qui les handicape vraiment dans leur métier ? Qu’est ce qui les empêche d’être recruté-es ou promu-es ? C’est la question à laquelle cet article veut répondre. De surcroît, il montre que ce qui les handicape ici et maintenant exclut, d’une part, d’autres scientifiques « valides » et, d’autre part, empêche les conditions pour viser l’excellence scientifique.
LE CRIP TIME
Les recherches sur le handicap ont emprunté un concept d’abord militant : celui du « crip time », une temporalité propre aux personnes handicapées. Ce concept désigne une temporalité non linéaire, plus lente, souvent imprévisible, marquée par des contraintes extérieures : besoin d’aide, fatigue accrue, trajets allongés, démarches administratives complexes.
Dans mon enquête, j’ai vu comment le rapport au temps structure la vie professionnelle des scientifiques handicapé-es. Leurs journées ne sont pas linéaires. Pour une tâche comme lire un article, il faut parfois transformer le texte pour qu’il devienne accessible, ce qui suppose des logiciels, des aides humaines, du temps. Travailler en équipe ? Pour assurer un échange avec un collègue, il faut caler les horaires avec un-e interprète en langue des signes, s’assurer que la salle est accessible.
Bien que le crip time soit spécifique aux expériences des personnes handicapées, il vient pointer d’autres temporalités alternatives. Ce temps désynchronisé, ralenti ou haché, beaucoup d’universitaires le vivent sans le nommer : les mères de jeunes enfants, les personnes aidantes, les précaires cumulant plusieurs postes, les personnes en burn-out, les jeunes chercheurs et chercheuses obligé-es de déménager sans cesse. Toutes ces personnes doivent faire leur travail en jonglant avec des temps multiples, souvent incompatibles entre eux.
On demande à la communauté scientifique d’être toujours disponible, réactive, efficace. Mais qui peut vraiment l’être tout le temps ? Cette disponibilité n’est pas une qualité professionnelle, c’est un privilège social. C’est pourquoi les scientifiques en situation de handicap, parce qu’elles et ils doivent sans cesse négocier avec leur propre temps, rendent visible une réalité beaucoup plus large. Le crip time devient ainsi un outil critique puissant, une manière de questionner les fondements mêmes de l’organisation du travail.
LA CHRONO-NORMATIVITÉ : UNE HORLOGE EXCLUANTE
Ainsi, face au crip time et à toutes les temporalités alternatives, se dresse ce qu’on appelle la chrono-normativité. Ce mot un peu technique désigne une chose très simple : l’idée qu’il y aurait un bon rythme pour faire les choses. Une vitesse idéale, une progression de carrière « normale », des étapes à franchir dans un temps donné. C’est cette norme temporelle qui structure aujourd’hui les politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Aurélie Tricoire a bien montré comment les appels à projet structurent désormais le temps de la recherche, en imposant des durées arbitraires (trois ans, renouvelables), des évaluations rapides, des objectifs prédéfinis. Cette temporalité de projet exclut de nombreux chercheurs et chercheuses et, comme il le sera montré plus loin, entrave l’excellence scientifique.
En effet, ce système ne tolère que celles et ceux qui disposent des conditions les plus privilégiées, des conditions où il n’existe aucune entrave à leur disponibilité. Autrement dit, la chrono-normativité est pensée pour des hommes, cisgenre, valides, blancs, jeunes, issus des classes sociales les plus favorisées. Elle est aveugle aux réalités de la parentalité, de la maladie, du handicap, de la précarité. Elle fait de l’adaptation une charge individuelle et non une responsabilité collective.
Le problème ? Ce rythme ne correspond ni aux temporalités des scientifiques ni, plus grave encore, aux conditions nécessaires pour viser l’excellence scientifique.
TEMPS ENTRAVÉ, EXCELLENCE SCIENTIFIQUE EMPÊCHÉE
À force de croire que l’excellence se traduit intrinsèquement par de la performance, on exclut non seulement celles et ceux qui vivent un crip time mais on omet les conditions qui ont permis les plus grandes percées scientifiques : l’expérimentation lente, le travail en équipe, la construction de méthodes originales. Car, comme l’écrivent Petri Salo et Hannu Heikkinen, les approches collectives et engagées impliquent une temporalité non-pressée : Garfield a utilisé la découverte de l’ADN (acide désoxyribonucléique) à la fin des années 1940 comme exemple de science lente. Cette percée s’est appuyée sur un travail scientifique de longue haleine, intermittent et épuisant, dont le nombre de publications était initialement très faible. Lorsque les résultats ont finalement été complétés, l’ADN est devenu une percée scientifique. Des exemples similaires peuvent être tirés de l’histoire récente de la science, par exemple le développement des techniques analytiques ou l’amorçage en statistique. Les lauréats du prix Nobel sont rarement de jeunes missiles de carrière académique ; ce sont plutôt de vrais universitaires qui ont fait un travail persévérant et, dans la plupart des cas, ils ont pris leur retraite de leurs postes universitaires. C’est le cas par exemple de Peter Higgs, lauréat du prix Nobel en 2013, qui a présenté, avec ses collègues, le premier article sur le boson de Higgs au début des années 1960.
Dans la même veine, la sociologue Hélène Mialet a suivi pendant plusieurs mois Steven Hawking et son équipe. Elle a ainsi montré que ce sont les interactions multiples que le scientifique avait établi avec ses étudiant-es et ses auxiliaires de travail pour l’aménagement de son poste qui lui ont permis de signer en son nom propre les plus grandes avancées scientifiques du XXIe siècle.
On comprend alors pourquoi la chrono-normativité imposée par les nouvelles politiques publiques menace l’excellence scientifique elle-même. Comme l’a souligné Richard Münch, la montée d’un capitalisme académique pousse à produire vite, parfois au détriment de la qualité. Ce qu’il appelle la fast science est une science où le court terme prévaut, où l’innovation devient un produit, où la collaboration se mesure en livrables.
REPRENDRE LA MAIN SUR LE TEMPS : DES ALTERNATIVES EXISTENT
Face à cette accélération constante, des scientifiques commencent à revendiquer un autre rapport au temps. Le mouvement de la slow science, apparu dans les années 2010, propose de ralentir volontairement la cadence. Il ne s’agit pas de travailler moins mais de travailler autrement : en prenant le temps de lire, d’échanger, de réfléchir, de faire des erreurs, de recommencer. En refusant l’immédiateté comme critère de valeur.
Ce mouvement rejoint des appels plus anciens à défendre une science « engagée », ancrée dans les collectifs, connectée aux réalités sociales. Une science qui n’est pas obsédée par la performance individuelle, mais qui valorise la coopération, la créativité, la rigueur sur le long terme. On pourrait croire que le concept de slow science ne trouve de sens que dans une partie des sciences sociales. Pourtant, comme le rappellent Petri Salo et Hannu Heikkinen, il a été inventé au sein des « sciences dures », de la médecine et des sciences de l’information.
Toutefois, la slow science a aussi ses limites. Elle peut être vue comme élitiste, réservée à celles et ceux qui ont déjà un poste stable, du temps, du capital. Et elle ne répond pas toujours à l’urgence de certaines situations : crise climatique, pandémies, urgences sociales.
De plus, là où la slow science appelle à ralentir, le crip time propose de désynchroniser. Ce n’est pas une morale du calme mais une politique de l’adaptation collective et de la pluralité temporelle.
D’autres concepts émergent et répondent mieux à cette attente. Le sociologue Filip Vostal, par exemple, propose une idée intéressante : celle du temps « non pressé ». Il ne s’agit plus seulement de ralentir mais de reprendre le contrôle sur son temps. Avancer à son propre rythme, selon ses besoins, ses capacités, ses engagements. Ce modèle reconnaît que certaines phases du travail peuvent nécessiter de l’intensité et d’autres, au contraire, du relâchement. Il propose une flexibilité réelle, une autonomie temporelle.
Ce n’est donc pas une lubie de chercheurs et chercheuses confortablement installé-es. C’est une condition pour que la recherche publique soit à la fois rigoureuse, inventive et accessible. C’est aussi une responsabilité collective.
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
Les chercheurs et chercheuses en poste stable, les membres de comités d’évaluation, les responsables d’unité ont un rôle à jouer : en valorisant des profils qui n’entrent pas dans les cases classiques, en reconnaissant des formes d’excellence qui ne se mesurent pas en nombre de publications ou de mobilités internationales. Recruter une personne qui a moins publié mais qui a produit un résultat original ou animé un collectif scientifique solide, c’est aussi faire un choix d’excellence.
Le défi, évidemment, est institutionnel. Il ne suffit pas que quelques personnes ralentissent dans leur coin. Il faut que les structures de recrutement, d’évaluation, de financement reconnaissent des rythmes différents. Il faut qu’un dossier moins dense en publications mais riche en engagements collectifs ou en innovations méthodologiques puisse être considéré comme excellent.
Cela suppose de revoir les grilles d’évaluation mais aussi les formations des jurys, les critères de concours, les politiques d’accompagnement. Comme le dit Vincent, un des chercheurs interrogés, « il faut arrêter de faire comme si tout le monde pouvait faire carrière dans les mêmes conditions ». De la même manière qu’on a fini par reconnaître les effets des congés maternité dans les carrières des femmes, il faut intégrer pleinement les effets des situations handicapantes dans les parcours scientifiques.
POUR UNE SCIENCE QUI ACCEPTE LA PLURALITÉ DES TEMPS
Dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), les chercheurs et chercheuses que je rencontre sont handicapé-es, non par une altération visuelle ou auditive : ils et elles sont
handicapé-es parce que les nouvelles politiques publiques n’ont rendu effectif qu’un seul critère d’évaluation de l’excellence scientifique, la performance ; alors même qu’il en existe deux autres, l’innovation et la collégialité. Christophe Granger affirme que l’un des enjeux de l’ESR, « ce n’est pas que les précaires ne sont pas encore devenus des titulaires, c’est que les titulaires ne sont pas encore devenus des précaires ». J’affirmerais que l’enjeu, ce n’est pas que des titulaires soient en situation de handicap dans le monde de l’ESR, mais c’est que l’ESR n’a pas encore handicapé tous les chercheurs et chercheuses titulaires.
S’assurer que l’ESR recrute et promeuve des chercheurs et chercheuses handicapé-es, c’est la garantie des conditions nécessaires à l’excellence scientifique. Car pour des avancées scientifiques, il faut du temps : du temps pour mener des collaborations fructueuses, du temps pour tenter des méthodes originales, du temps pour approfondir une idée, une expérimentation, pour suivre les pistes de recherches nouvelles.
Ce faisant, les scientifiques handicapé-es ne sont pas les marges de la recherche : elles et ils en sont l’avenir. Car une science qui refuse la pluralité des temps, refuse la possibilité même de découvrir.
Postface personnelle
Étant moi-même malvoyante, je rejoins ainsi les conclusions de Maria Elena Cepeda* : « le fait d’être un-e universitaire titulaire s’accompagne d’une responsabilité, d’une “obligation morale”, de divulguer la manière dont nous, en tant qu’universitaires handicapé-es, ressentons les institutions universitaires comme étant encore plus handicapantes » (p. 312). Les situations handicapantes que vivent ces scientifiques ne sont que des loupes grossissantes. Elles constituent un aperçu de ce que va vivre l’ensemble de la communauté scientifique, qui va se retrouver également handicapée par des enjeux temporels incommensurables.
Cet article est tiré du n°443 de notre revue La Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéros dans notre rubrique VRS.