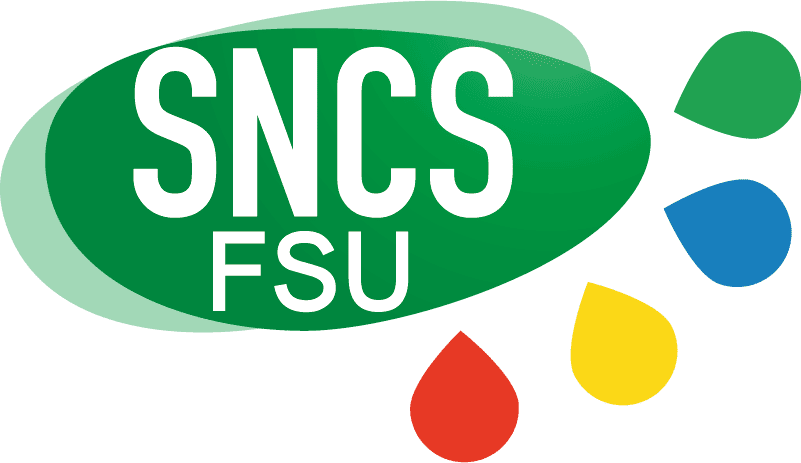Discréditer la parole et contraindre à la neutralité : les atteintes aux libertés des universitaires et des universités
Ces dernières années, des ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche ont critiqué l’« engagement » des universitaires et tenté de leur imposer un devoir de « neutralité » omettant de préciser que les universitaires ne sont soumis·e·s ni au devoir de neutralité, ni au devoir de réserve des agents de la fonction publique. Dans cet article, qui est un développement de celui du dossier du mensuel Le Snesup (à paraître en mai 2025), l’auteur oppose cette injonction à la neutralité à l’engagement des universitaires dans le cadre de leur liberté académique et de leur indépendance.
Jean-Michel Minovez
Membre du bureau national du SNESUP-FSU
Dans un contexte de tensions politiques et sociales, voire de crise, nationale et internationale, les débats sociétaux exposent de plus en plus les scientifiques – et leurs institutions –, les menaçant dans l’exercice de leur « liberté académique ». Les productions des chercheurs sont mises en question et la liberté d’expression scientifique assimilée à la formulation d’une opinion. L’« engagement » des professeurs est critiqué. Le ministère de tutelle tente de leur imposer un devoir de « neutralité », alors qu’ils ne relèvent pas du droit commun de la fonction publique. En oubliant que les enseignant·e·s-chercheur·e·s ne sont soumis·e·s ni au devoir de neutralité, ni au devoir de réserve, c’est « l’indépendance » des universitaires, pourtant protégée constitutionnellement, qui est attaquée.
L’« ENGAGEMENT» SÉCULAIRE DES UNIVERSITAIRES
La figure moderne de l’intellectuel est née avec l’affaire Dreyfus provoquant l’opposition radicale entre deux mondes : l’un fondant ses positions sur la raison et la recherche de vérité en exerçant l’esprit critique, l’autre – niant ces valeurs et ces principes – défenseur de l’autorité et de l’ordre au mépris de la justice et des droits de l’Homme.
C’est donc le rôle original joué par les dreyfusards qui donna naissance, dans l’entre-deux-guerres, à la notion de « l’engagement ». Si tous les intellectuels ne sont pas des universitaires et si tous les universitaires ne sont pas des intellectuels – au sens de l’engagement –, la deuxième moitié du XXe siècle a mis en lumière des professeurs de premier plan, pleinement engagés, revendiquant une forme particulière que Michel Foucault a pu définir « d’intellectuel spécifique ». Suite à un échange avec Gilles Deleuze, portant sur « les intellectuels et le pouvoir », Foucault construit une réflexion sur le statut et le rôle de l’intellectuel engagé en relation avec l’expérience des mobilisations de mai 1968 et des grands combats politiques des années 1970 ouvrant, selon Mathieu Potte-Bonneville, le temps des experts et des lanceurs d’alerte à la parole davantage située. C’est ainsi que Pierre Bourdieu ne voyait « aucune restriction à l’autonomie et aux contraintes propres des champs, au contraire, mais la volonté de sortir de son champ, par moments, pour agir dans l’espace public ».
En suivant ce qu’écrit Frédéric Lebaron, remarquons avec quelle force Bourdieu mobilisait alors toute la puissance académique dont il pouvait disposer pour aller dans ce sens. C’est ainsi qu’il pouvait s’appuyer sur les Actes de la recherche en sciences sociales – revue scientifique publiée avec le concours du Centre de sociologie européenne (UMR/Paris 1-EHESS-CNRS), du Collège de France, de la Fondation Maison des sciences de l’homme (MSH) et du CNRS – qui pouvait faire des incursions ponctuelles dans « l’actualité ».
La position des antidreyfusards est consubstantielle de la naissance, en 1898, de la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, connue ensuite sous son nom abrégé de Ligue des droits de l’Homme (LDH). Parmi les figures de dreyfusards remarquables, on compte Émile Duclaux, professeur à la Sorbonne et vice-président de la LDH ou Gabriel Monod, professeur à l’École pratique des hautes études (EPHE), puis à la Sorbonne et au Collège de France, cofondateur de la LDH. Citons encore et tout particulièrement, Victor Basch, professeur à l’université de Rennes au moment de l’affaire, qui fut président de la LDH ; son investissement de toute une vie s’arrêta en 1944 lorsqu’il fut assassiné par les nazis.
NEUTRALITÉ AXIOLOGIQUE
L’engagement pose alors la question de la place du chercheur universitaire entre maîtrise d’un savoir scientifique et expression de positions qui peuvent être taxées d’opinions personnelles. De là naît le débat autour de la notion forgée par Max Weber au début du XXe siècle et traduite en français sous la forme de « neutralité axiologique ». À tort ou à raison, surtout du fait d’une lecture trop rapide, on en retient qu’elle définit ce que doit être un scientifique libre « de passions partisanes » et de « jugements de valeurs ». Le sujet n’est pas neuf et les philosophes du XVIIe siècle en discutaient déjà.
Il est aujourd’hui trivial d’observer que les scientifiques n’hésitent pas à se saisir des enjeux sociétaux ; c’est ainsi que les sociologues ont pleinement investi les rapports de genre ou les sujets religieux, tout en étant plus frileux quand il s’agit de traiter des politiques économiques, des dispositifs d’action publique ou des relations internationales, comme le souligne Frédéric Lebaron. Force est de constater que nombre d’universitaires engagés dans ces recherches sociétales le sont en raison de leur propre histoire qui influence choix et champ de recherche ainsi que les questions spécifiques jugées pertinentes à élucider. Ils rejoignent ainsi, nous dit Foucault, « les intellectuels [qui] ont pris l’habitude de travailler non pas dans l’universel, l’exemplaire, le juste-et-le-vrai-pour-tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis où les situaient soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions de vie. »
Le chercheur doit alors être conscient qu’il est toujours sujet à des biais et à des partis pris dans le contexte socio-politique de production de son savoir. Il doit aussi faire connaître sa position, la réflexivité allant de pair avec la scientificité. L’engagement éthique et politique du chercheur se vérifie d’ailleurs par l’intégration au dispositif d’enquête. Aussi peut-on émettre l’hypothèse, comme le soutient Christian Minko Mi-Bie, qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre neutralité axiologique et engagement du chercheur dans le cadre de l’activité scientifique. Qu’en outre, les partis pris, voire l’engagement du chercheur, peuvent même être particulièrement salutaires dans les contextes de conflits et de crise. En cela, la réédition, en 2022, de l’ouvrage Interventions de Pierre Bourdieu en représente une lumineuse démonstration.
«NEUTRALITÉ » CONTRE «LIBERTÉ ACADÉMIQUE »
Les chercheurs qui investissent ces champs s’exposent à des critiques, voire à des attaques, contre leurs motivations, les institutions qui les hébergent et les lieux et supports de leur expression ; les années 2020 sont marquées par la montée des pratiques contribuant à discréditer la production de science et la parole des scientifiques dans leur domaine d’expertise. Les résultats exposés par les scientifiques subissent des tentatives de déconsidération en ramenant les conclusions des chercheurs, bien que validées par les pairs, à une opinion. De là découlent les attaques contre les universitaires, accusés de militantisme ou vilipendés sur la place publique.
En ce qui concerne les sciences de l’homme et de la société (SHS), les critiques virulentes accusant l’université de propager une « théorie du genre » ou encore les débats identitaires – sur fond d’événements terroristes – sont aussi des moments marquants. Ces éléments repérés par les chercheurs en sciences sociales les poussent à se questionner à nouveaux frais sur l’engagement des scientifiques et les résistances que cela engendre – comme lors de la table ronde organisée à l’IDHES en 2022.
Les syndicalistes s’interrogent aussi, observant la volonté de prise en main et de cadrage d’institutions agissant en position surplombante ou d’extériorité, réagissant à l’évolution des collaborations avec des universités israéliennes dans le contexte de la guerre de Gaza et du Liban. Ainsi, l’ex-ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), Sylvie Retailleau, dans sa prise de parole à l’occasion du conseil d’administration de France Universités du jeudi 2 mai 2024 à laquelle elle « souhaite conférer […] une solennité particulière », déclare que « pour accomplir sa mission, l’Université a besoin d’un cadre apaisé, de pouvoir fonctionner sereinement et donc de démocratie, de pluralité et de neutralité ». Ce discours officiel et publié sur le site du ministère de l’ESR, s’inscrit dans les nombreuses interventions de la ministre centrées sur le thème de la neutralité, comme son audition au Sénat, ses interventions sur les ondes de radios – notamment à Radio France.
Pour asseoir sa position, la ministre a saisi le Collège de déontologie et obtenu qu’il souligne, le 19 juin 2024, le « principe de neutralité, rappelé à l’article L.121-2 du code général de la fonction publique, qui a notamment pour conséquence qu’un établissement public ne saurait faire sienne la revendication d’opinions politiques ». Afin de cadrer « la libre expression des enseignants-chercheurs », le « Collège encourage les différents établissements d’enseignement supérieur à élaborer une charte » qui y est relative. En fixant des droits et devoirs, on mesure – comme l’écrit Olivier Beaud – « le risque pris de réduire à néant la liberté académique en la mettant en balance avec les devoirs ».
DÉFENDRE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET LE RESPECT DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES
Cette volonté de neutraliser la parole des individus et des institutions crée des chaînes susceptibles d’entraver, demain, les universités et les universitaires qui devraient s’opposer à des régimes autoritaires au sein de leur communauté académique. L’expérience vécue aux États-Unis – comme l’écrit l’historienne, mondialement connue, Joan W. Scott (voir article dans ce dossier) – le démontre. Alors que la répression des mobilisations étudiantes en solidarité avec Gaza s’intensifie aux États-Unis, les critiques de la politique menée par l’État d’Israël – et non contre les juifs en tant que groupe –, sont taxées d’antisémitisme dans les universités. Pour ces motifs, le Département de la justice a lancé une enquête contre cinq universités.
La « neutralisation » prend alors le pas sur la liberté d’expression et le pluralisme. C’est ce que Frédéric Rolin, en professeur de droit public attentif et nuancé, note concernant le processus à l’œuvre en France. Il relève que cela ne va pas jusqu’à remettre en cause l’indépendance des universitaires puisque la ministre « a pris soin de ne pas poser la troisième question qui a émergé dans le débat public, celle de la liberté d’expression des enseignants chercheurs pris individuellement, et le collège de déontologie a également pris soin de ne pas y répondre, fut-ce indirectement ». En effet, poser la question et en attendre une réponse aurait créé une difficulté importante en plaçant le comité sur le terrain d’un droit intangible : celui de l’indépendance constitutionnelle des universitaires. C’est d’ailleurs bien pour cela que France Universités, tout en déclarant le devoir de l’université « d’incarner une neutralité » réaffirme « son attachement aux franchises universitaires et à la liberté académique ». Finalement, le cadrage ministériel – discutable – se limite, pour l’instant, à la neutralité exigée des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, parallèlement à la réassurance de l’indépendance des enseignants-chercheurs de statut universitaire.
Le processus à l’œuvre aux États-Unis nous conduit à insister sur la nécessité de défendre avec force la liberté académique et le respect des franchises universitaires. Pour cela, il convient de s’appuyer sur les textes législatifs existants pour dénoncer l’injonction de neutralité en contradiction avec le droit intangible. Aussi, pour terminer, nous rappellerons les textes qui encadrent la « liberté académique » ; ils forment le corpus du droit protecteur à rappeler, autant de fois qu’il est nécessaire, aux contempteurs de ces principes pourtant indissociablement liés au statut des universitaires. En effet, le Conseil constitutionnel a pris soin, par sa décision du 20 janvier 1984, de préciser que :
« Les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables. »
En outre, la loi en vigueur depuis le 27 décembre 2020 et l’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. »
Seuls les magistrats judiciaires – du siège – possèdent le même niveau d’indépendance en lien avec la séparation des pouvoirs qui fondent les constitutions des démocraties. Les libertés et droits fondamentaux ainsi consacrés sont à la source de l’identité et de la protection du monde universitaire français. À nous de savoir les défendre dans un contexte international d’attaques et de régressions de la liberté académique.
Cet article est tiré du n°440 de notre revue la Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéro dans notre rubrique VRS.