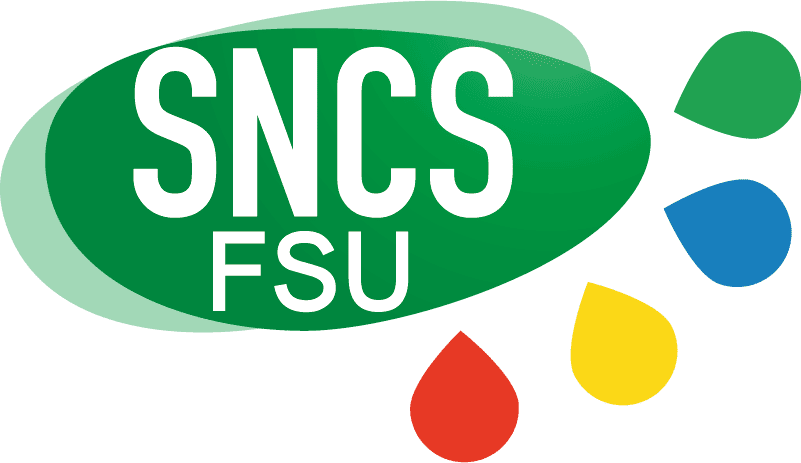Bilan du 49è Congrès du SNCS-FSU
Le 49è Congrès du SNCS-FSU s’est déroulé les 17, 18 et 19 juin 2024 en mode hybride à la fois sur le campus CNRS de Villejuif et en ligne. Il a rassemblé 89 délégués élus par 34 sections locales, nationales et scientifiques. Les débats ont été marqués dans l’ordre par
- L’annonce des résultats des votes précédents le congrès auprès de l’ensemble des 1231 adhérentes et adhérents à jour de cotisation :
- Rapport d’activité : pour 393, contre 16, abstentions 28, refus de prendre part au vote 3 ;
- Textes d’orientation : Ensemble 362, Front Unique 40, abstention 34, refus de prendre par au vote 4.
- Un vote d’approbation des procès verbaux des assemblées générales de section ayant désigné les déléguées et délégués au congrès : pour 51, contre 3.
- Un vote pour élire le bureau du congrès composé de Julien Diaz, Maude Le Gall, Dimitri Peaucelle (la tendance Front Unique a refusé de participer au Bureau) : pour 51, contre 2, abstention 3.
- L’adoption de l’ordre du jour : pour 54, cotre 1, abstention 1
- L’adoption de la motion « Le 49è Congrès du SNCS-FSU approuve une dérogation valable jusqu’au prochain congrès ordinaire, pour que le secrétaire général et le trésorier puissent effectuer des mandats qui pourraient aller au delà de quatre années consécutives. » : pour 48, contre 4, abstention 5.
- Intervention du secrétaire général sortant, Boris Gralak et débat général
- Intervention des invités
- Caroline Mauriat, Co-secrétaire générale du SNESUP-FSU
- Julie Robert, Co-secrétaire générale du SNASUB-FSU
- Yannick Bourlès et Isabelle Cohen, Co-secrétaires généraux du SGEN-CFDT Recherche EPST
- Xavier Duchemin, Secrétaire national du SNPTES-UNSA
- Travail en commission sur les 3 thèmes du congrès
- Présentation des comptes du SNCS – Vote du quitus du trésorier : pour 63, abstention 1.
- Approbation du texte relatif au thème 1 « Conditions de travail » : pour 52, contre 5, abstention 2
- Approbation du texte relatif au thème 2 « Structuration de la recherche en France » : pour 53, contre 5, abstention 1
- Approbation du texte relatif au thème 3 « Recherche et transition socio-écologique » : pour 38, contre 5, abstention 1, refus de prendre part au vote 2
- Approbation de la liste des sections locales, nationales et scientifiques : pour 51, contre 4, abstention 1
- Élection des commissaires aux comptes internes Florence Audier, Michel Cohen-Solal, Bernard Veyssière : pour 54, abstention 1
- Approbation de la composition de la Commission administrative : pour 57, abstention 1
- Élection du Secrétaire général Boris Gralak par la Commission administrative : pour 33, contre 3
- Élection du Trésorier Dimitri Peaucelle par la Commission administrative : pour 33, contre 2, abstention 1
- Élection du Bureau national par la Commission administrative : pour 31, contre 3, abstention 1
- Intervention des invités Benoit Teste Secrétaire général de la FSU, Josiane Tack et Patrick Boumier, co-secrétaires généraux du SNTRS-CGT
- Adoption de la résolution générale du congrès : pour 31, contre 7, abstention 8, refus de prendre part au vote 1
- Adoption de la motion intitulée « Les personnels des organismes de recherche ne doivent pas subir les inconséquences de la désorganisation provoquée par les changements incessants et la mise en concurrence généralisée. Les employeurs sont responsables. » : pour 47, abstention 1
- Adoption de la motion intitulée « Au CNRS, voter une insuffisance professionnelle équivaut à voter un licenciement. » : pour 50, contre 1, abstention 1
- Adoption de la motion intitulée « Pour la reconnaissance du travail des représentants du personnel » : pour 42, contre 4, abstention 6
- Adoption de la motion intitulée « Reconnaissance des années blanches » : pour 47
- Adoption de la motion intitulée « Pour une amélioration décisive de la politique handicap dans les établissements de recherche » : pour 50
- Adoption de la motion intitulée « Le SNCS-FSU appelle à voter pour les candidates et candidats qui s’engagent pour le programme du Nouveau Front populaire » : pour 39, contre 1, abstention 10
- Vote sur la motion « Pas une voix pour RN, Reconquête, LR et Macron, au 1er comme au 2nd tour » : pour 7, contre 21, abstention 16, refus de prendre part au vote 2
- Vote sur la motion « Pour un gouvernement au service des intérêts des travailleurs et de la jeunesse » : pour 7, contre 24, abstention 9, refus de prendre part au vote 1
- Vote sur la motion « En défense du peuple Palestinien, arrêt immédiat de la guerre génocidaire » : pour 12, contre 18, abstention 13
- Vote sur la motion « Front Uni contre la criminalisation de la solidarité avec les Palestiniens. Rétablissement des libertés académiques et de la libre expression dans l’ESR. » : pour 7, contre 18, abstention 10
- Vote sur la motion « Retrait pur et simple du plan d’« Acte II de l’autonomie ». Arrêt immédiat de toutes les expérimentations » : pour 7, contre 17, abstention 13.
Les motions adoptées par le Congrès sont disponibles en bas de page.
Résolution générale
Bureau national du SNCS-FSU élu le 19 juin 2024
- Boris Gralak – Secrétaire général
- Julien Diaz – Secrétaire général adjoint
- Maud Leriche – Secrétaire générale adjointe
- Dimitri Peaucelle – Trésorier
- Sylvie Babajko
- Christophe Blondel
- Daniel Brunstein
- Pierre Gilliot
- Christophe Hecquet
- Maude Le Gall
- Sandra Lippert
- Luke Mac Aleese
- Patrick Monfort
- Philippe Mussi
- Chantal Pacteau
- Aline Tribollet
Commission administrative élue le 19 juin 2024
La répartition des sièges au titre des tendances est le résultat des votes sur les textes d’orientation. Sur 24 sièges, 22 sont attribués à la tendance « Ensemble », 2 à la tendance « Front Unique ». La répartition des sièges au titres des sections tient compte des effectifs des sections.
Au titre du texte d’orientation « Ensemble »
- Boris Gralak, suppléant Jacques Fossey
- Maud Leriche, suppléante Christine Assaiante
- Dimitri Peaucelle, suppléant Olivier Coutard
- Maude Le Gall, suppléante Nathalie Dejucq-Rainsford
- Julien Diaz, suppléant Guillaume Favreau
- Sylvie Babajko, suppléante Ghislaine Guillemin
- Matthieu Cassin, suppléant Ivan Guermeur
- Sandra Lippert, suppléante Elodie Attia
- Luke Mac Aleese, suppléant Claude Mirodatos
- Liliana Cucu, suppléante Chantal Pacteau
- Christophe Blondel, suppléant Damien Vandembrouck
- Aline Tribollet, suppléante Anne Lefebvre-Schuhl
- Christophe Hecquet, suppléant Hervé Jourdan
- Mireille Ansaldi, suppléante Claire Lemercier
- Yaël Grosjean, suppléant Emmanuel Tétaud
- Corinne Bardot, suppléante Caroline Zimmer
- Patrick Monfort, suppléant Philippe Buettgen
- Dorothée Berthomieu, suppléant Gilles Verpraet
- Pierre Gilliot, suppléant Fabien Jobard
- Anne Chauchereau, suppléant Etienne Deloule
- Philippe Mussi, suppléant Jean-Luc Mazet
- Sophie Pochic, suppléante Maud Simonet
Au titre du texte d’orientation « Front Unique »
- Marie-Claire Saint Lager, suppléante Hélène MacLeod
- Jean-Marc Tonnerre, suppléant Youri Timsit
Au titre des sections
- Nicolas Belorgey, Sciences Humaines et Sociales – Suppléant·e à élire, Sciences Humaines et Sociales
- François Tronche, Biologie-Santé – Suppléant Julien Savatier, Ingénieur·e·s et technicien·ne·s
- Véronique Alphand, Aix-Marseille – Suppléant Gilles Kaczmarek, Aix-Marseille
- Pierre Illien, Sciences Physique – Suppléant Etienne Petit, Metz Nancy
- Claude Didry, Paris Centre – Suppléant Nicolas Tiercelin, Lille Hauts-de-France
- Hélène Moné Languedoc-Roussillon – Suppléant Rémi Grodzki, ANR
- Oana Ivanovici, Informatique, Systèmes et Mathématiques – Suppléant Frédéric Thibault-Starzyk, Chimie
- Simon Tricard, Occitanie Ouest – Suppléante Marion Ink, Handicap
- Mohamed Amara, Lyon Saint-Etienne Clermont – Suppléante Emmanuelle Bignon, Metz Nancy
- Serge Simoens, Sciences de l’Ingénieur – Suppléante Anne-Sophie Bonnet Ben Dhia, Sciences de l’Ingénieur
- Anne-Magali Seydoux Sciences de l’Univers – Suppléant Kevin Belkacem, Sciences de l’Univers
- Jean-Marie Maillard, Paris Sciences Jussieu – Suppléant Michel Quaggetto, Paris Sciences Jussieu
- Christine Eisenbeis, Inria – Suppléante Katia Le Barbu-Debus, Orsay Plateau
- Patricia Krief, Paris Biologie Santé – Suppléant Philippe Borsa, IRD
- Daniel Brunstein, Ingénieur·e·s et technicien·ne·s – Suppléante Fatima Kourourou, Ingénieur·e·s et technicien·ne·s
- Isabelle Mus-Veteau, Nice-Sophia – Suppléant Nicolas Blondeau, Nice-Sophia
Textes thématiques
En amont du Congrès les syndiqués étaient invités à participer, débattre et élaborer en commun des textes sur 3 thèmes. Tous ces textes ont été validés par le Congrès :
- Thème 1 : Conditions de travail
- Thème 2 : Structuration de la recherche en France
- Thème 3 : Recherche et transition socio-écologique
Motions
Les personnels des organismes de recherche ne doivent pas subir les inconséquences de la désorganisation provoquée par les changements incessants et la mise en concurrence généralisée. Les employeurs sont responsables.
Le SNCS-FSU alerte : La CAP chercheurs du CNRS a été convoquée à de nombreuses reprises ces deux dernières années pour des situations dites d’insuffisance professionnelle et celle de l’Inserm pour sanctionner des responsables intermédiaires, notamment des femmes. De nombreux agent·e·s, contractuel·le·s comme titulaires, sont victimes de mesures de rétorsion, telle des non titularisations, des non renouvellements arbitraires de contrat ou de fonction, ou des licenciements précipités, certain·e·s pour avoir seulement osé interroger l’organisation ou des décisions de la hiérarchie. Dans ces situations, les directions générales ne suivent pas toujours les avis des instances concernées, voire ignorent les mises en demeure des tribunaux administratifs. Pourtant dans le même temps, des situations de harcèlement sont également dénoncées auprès des cellules de signalement, comité médical, etc. et régulièrement sanctionnées à juste titre en CAP, voire au tribunal. En revanche, dans d’autres EPST comme l’IRD, les signalements débouchent rarement sur des CAP, au contraire, les victimes ont la double peine le plus souvent tandis que les harceleuses et harceleurs sont protégé·e·s.
Dans tous ces cas, les mises en cause sont individuelles et déconnectées de l’analyse des conditions et de l’environnement de travail : politiques de recherche, moyens des laboratoires, chasse aux contrats pour obtenir les moyens de travailler, rotation (turn-over) des personnels et perte de l’expérience dans tous les métiers, aussi bien scientifique qu’administratif. Les conséquences sont la mise en concurrence de tous et toutes, la pression insupportable, l’isolement, l’empêchement de travailler qui peuvent conduire à ces situations « d’insuffisance professionnelle ».
Ceci est notamment dû à la déconnexion entre évaluation individuelle et l’environnement de travail ; par exemple, le fait que l’évaluation des laboratoires ait été retirée au comité national et affectée à l’HCERES pour la partie scientifique et les FS-SSCT pour les conditions de travail.
Les employeurs sont responsables légalement de ces situations (*,**) mais préfèrent accuser les individus plutôt que d’assumer leurs responsabilités.
Ainsi le PDG du CNRS a mis en cause la pertinence du travail du conseil scientifique lors de son élaboration d’un livre blanc sur les entraves à la recherche alors qu’il aurait dû reconnaître sa responsabilité et mettre en oeuvre des mesures d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels.
Le SNCS-FSU demande que les employeurs soient formés à leurs responsabilités en termes de conditions de travail et santé au travail et arrêtent d’accuser les individus victimes de leur organisation délétère.
Le SNCS-FSU incite les collègues à user de leurs droits en matière de santé au travail, à commencer par le dépôt de congés maladie, le recours à la médecine du travail, l’inscription des incidents dans les registres SST (santé et sécurité au travail), la déclaration des accidents du travail (***) et des maladies professionnelles : les chercheurs, chercheuses, ingénieur·e·s et techniciennes, techniciens ont aussi des corps, sur lesquels le métier lui-même et plus encore les réorganisations permanentes et la culture du projet pèsent, et le rôle du syndicat est aussi de les défendre sur ces questions.
Le SNCS-FSU créera un espace ou secteur ou réseau pour venir en aide aux situations individuelles et s’auto-former pour l’aide aux collègues et la prise en charge collective et politique de ces situations notamment en faisant des enquêtes reliant les situations individuelles aux transformations politiques. Les agents et leurs représentant·es et élu·es syndicaux dans les instances CAP, FS-SSCT, Comité National, CSA doivent pouvoir y trouver un espace de lutte collective et d’aide individuelle.
(*) L4121 du Code du travail : obligations de l’employeur
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178066/#LEGISCTA000006178066
(**) L133-2 du Code général de la fonction publique
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
(***) orientations stratégiques ministérielles (OSM) 2024 : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/orientations-strategiques-ministerielles-en-matiere-de-politique-de-prevention-des-risques-45834
[..] Les situations de travail à risque seront prises en compte dans le Duerp, et tout fait de VDHAS [violence, discrimination, harcèlement, agissement sexiste] sera déclaré en tant qu’accident de service. Dans ce cadre une enquête de la formation spécialisée compétences pourra être diligentée. Le cas échéant le référent ou la référente VDHAS de la formation spécialisée seront membre de la délégation d’enquête. [..]
Au CNRS, voter une insuffisance professionnelle équivaut à voter un licenciement
À notre connaissance, les membres des sections du Comité National ont peu conscience que voter une insuffisance professionnelle (IP) équivaut, en pratique et dans la quasi-totalité des cas, à voter un licenciement.
Ainsi, au printemps 2024, après qu’une insuffisance professionnelle a été votée en section du Comité National, le président du CNRS a pris la décision de prononcer un licenciement contre lequel 11 votants sur 12 membres de la CAP s’étaient exprimés (c’est-à-dire que l’ensemble des représentant·e·s de l’administration avaient voté contre, sauf le représentant du PDG lui-même). Ce n’est pas la première fois qu’un tel évènement se produit, avec un licenciement prononcé malgré un avis quasi-unanime de la CAP contre le licenciement. Il y a ainsi eu 10 licenciements pour IP au CNRS entre 2015 et 2022.
La CAP n’est pas compétente en matière d’évaluation des chercheuses et chercheurs et ses avis ne sont pas un désaveu du jugement scientifique des pairs. En revanche, les questions de santé et d’environnement de travail sont rarement connues des évaluateurs et évaluatrices du Comité National et donc peu abordées en section, alors qu’elles sont très fréquemment au cœur des débats de la CAP et donnent un éclairage nuancé et complexe des dossiers qui lui sont soumis.
La CAP a accès et s’intéresse à d’autres aspects professionnels ou personnels des collègues pouvant conduire à des situations problématiques et impacter négativement leur travail. Le licenciement apparaît ainsi le plus souvent comme une sanction individuelle inappropriée et injustifiée qui passe sous silence la défaillance d’un système.
La CAP a toute légitimité pour s’exprimer sur un licenciement même après un vote d’IP en section.
Ainsi, le caractère consultatif de la CAP ne rend pas acceptable l’ignorance quasi-systématique de ses avis.
Nous alertons donc les membres élu·es du comité national : voter l’insuffisance professionnelle, c’est, de fait, licencier le ou la collègue. Au contraire, en présence d’un·e collègue en difficulté scientifique, il est important – en lien bien sûr avec les services RH, les syndiqué·es sur place, les autres instances de l’établissement, etc. – de comprendre les causes, presque toujours extra-scientifiques, de ces difficultés, afin de travailler collectivement à éviter ces licenciements.
Tous et toutes syndiquées : contre la professionnalisation des représentants du personnel
La démocratie fonctionne bien quand les citoyens s’investissent. Il est patent que « la Recherche [n’est plus] une République » (pour prendre en compte l’évolution des pratiques depuis le titre de Michel Blay sur l’histoire du CNRS*) et les EPST, CNRS en tête, semblent lorgner vers un management autoritaire issu d’un fantasme entrepreneurial répandu parmi les élites dirigeantes. Malgré cela, nombre d’instances paritaires impliquent encore, et c’est heureux, des collègues représentants du personnel (RP) pour contrôler, tant au niveau du ministère que des établissements, les évolutions règlementaires (CSA), les pratiques en termes de prévention, de santé, de sécurité et de conditions de travail en général (F3/4SCT), les conditions d’évaluation scientifique (sections scientifiques spécialisées ou sections du CoNRS) et disciplinaire (CAP), la mise en œuvre de l’action sociale et de la formation permanente (CNDP/S, CAES…), etc. C’est heureux parce que, sans elles et eux, et quelles que soient les bonnes intentions des « managers », l’arbitraire managérial règnerait en maître. Chacune et chacun des personnels de la recherche publique peut être reconnaissant à ces RP qui donnent de leur temps pour des tâches collectives. Mais ces activités, sans même compter l’écoute, l’accompagnement et le conseil auprès d’agents en difficulté, sont extrêmement chronophages. Or nous avons été recrutés pour nos qualités de travailleurs et travailleuses de la recherche publique : c’est le sens primordial de nos activités, c’est ce que nous aimons faire au quotidien et ce dont nous tirons toute notre reconnaissance professionnelle. Pour que les activités d’intérêt collectif continuent d’être menées à bien sérieusement sans mettre à mal nos carrières, pour que ça soit tenable, et parce que s’impliquer dans une OS ne doit pas être un sacerdoce ou un sacrifice, il faut que les taux de syndicalisation augmentent, il faut que davantage de collègues s’impliquent. Parmi les pistes d’action, il semble impératif de lutter contre les discours et pratiques responsables de la perception globalement catastrophique du syndicalisme dans l’imaginaire collectif : nous demandons que notre syndicat, avec sa fédération FSU et si possible l’ensemble des organisations syndicales fassent pression pour impliquer l’Etat employeur, mais aussi les directions d’EPST et jusqu’au directions des laboratoires, dans la reconnaissance du rôle positif et fondamental des OS dans le fonctionnement quotidien de l’ESR. Pour cela, il faut l’engagement de rendre le travail collectif et les négociations sociales effectives, ouvertes et reconnues à toutes les échelles et en particulier au plus proche des personnels : dans les laboratoires. Par ailleurs, il conviendrait de morceler les tâches collectives pour les alléger et les distribuer au plus grand nombre au lieu de tout agréger en mandats de plus en plus lourds selon la tendance observée (cf. regroupement des CORAS et CRFP en une seule CNDPS, doubles mandats CSA et F3SCT, etc.). Enfin, il est nécessaire (i) de libérer du temps aux agents pour qu’ils puissent matériellement s’impliquer dans les tâches collectives, ce qui rejoint nos combats syndicaux pour notamment alléger la pression individualiste propre au fonctionnement généralisé par AAP, et (ii) de prendre en compte cet investissement au niveau des évaluations individuelles de tous les personnels pour que le travail syndical ne soit pas pénalisant.
*Quand la Recherche était une République (La recherche scientifique à la Libération), Michel Blay, Armand Colin / Comité pour l’histoire du CNRS
Reconnaissance des années blanches
Le congrès demande à ce que le SNCS-FSU œuvre auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la reconnaissance des « années blanches ». Ces années de travail réalisées pendant la thèse ou post-thèse, notamment à l’étranger, n’ayant pas donné droit à des cotisations sociales en France mais considérées nécessaires pour obtenir un poste, doivent être reconnues tant pour la reconstitution de carrière des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et des ingénieurs, que dans le calcul des retraites. Nous souhaitons être soutenus par la FSU dans cette démarche.
Depuis le milieu des années 80, l’âge des recrutements qui était au plus proche de la thèse, quand ce n’était pas la même année que la soutenance de thèse, a dérivé rapidement pour s’en éloigner conduisant à des recrutements de plus en plus tardifs au-delà de l’âge de 30 ans. En ont découlé des années de travail temporaire sur des statuts très divers, précaires, sortant souvent du cadre réglementaire. Aujourd’hui ces personnes recrutées tardivement sont obligées de partir à la retraite à 67 ans alors qu’elles n’ont pas le nombre d’annuités nécessaires pour percevoir une pension à la hauteur de leur travail. Le cumul de ces années blanches pénalise énormément ces personnels de la recherche dans le calcul de leur pension de retraite. Cette injustice est devenue encore plus sensible depuis la réforme des retraites, et accentue la disparité de traitement entre les personnels de la recherche. Elle touche encore davantage les femmes qui ont eu des enfants pendant cette période, ceux-ci n’étant pas comptabilisés. La reconnaissance des années blanches comme des années travaillées a été accordée aux travailleurs ayant effectué des Travaux d’Utilité Collective (TUC) recrutés dans les années 1980 pour faire valoir aujourd’hui leurs droits à la retraite. De la même façon, il faut que cette reconnaissance soit accordée aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux ingénieurs.
Pour une amélioration décisive de la politique handicap dans les établissements de recherche
La question du handicap a une vocation universelle. Elle peut concerner tout le monde, et permet de proche en proche une amélioration des conditions de travail pour toutes et tous.
La politique d’aide au recrutement et à la carrière des personnes en situation de handicap est parfaitement compatible avec les exigences scientifiques d’institutions de renommée mondiale. Elle compense une conséquence majeure du handicap : la perte de temps.
La politique handicap du CNRS est actuellement à un tournant important, avec l’élaboration du plan handicap pluriannuel 2025-2028. Le congrès du SNCS-FSU rappelle son attachement aux trois points suivants :
- la présence d’une mission « handicap et autonomie » au plus haut niveau dans l’organigramme du CNRS, qui orchestre la prise en charge transversale d’une « politique handicap intégrée » et soutienne des recherches scientifiques dans le domaine,
- une amélioration des modalités de recrutements spécifiques aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) avec, pour les chercheuses et chercheurs, une procédure au plus proche des concours ordinaires, c’est-à-dire des postes non fléchés examinés par les sections du comité national,
- pour tous les processus sélectifs (concours internes, concours DR2 en interne, promotions et primes), la mise en place de procédures spécifiques pour les agents BOE, et en particulier l’application immédiate de l’article 93 de la loi de 2019 qui rend accessible les changements de corps par dérogation.
Le congrès du SNCS-FSU mandate le secrétaire général, le bureau national, et tous les élus du SNCS dans les différentes instances à porter ces revendications au plus haut niveau de la hiérarchie du CNRS, dans le cadre d’une concertation intersyndicale, et de les étendre à tous les EPST où le syndicat est représenté.
Le SNCS-FSU appelle à voter pour les candidates et candidats qui s’engagent pour le programme du Nouveau Front populaire
Le SNCS-FSU rappelle solennellement son opposition aux idées d’extrême droite dont les valeurs et les idées constituent une menace pour les droits des travailleuses et travailleurs, les libertés démocratiques, syndicales et académiques. Les expériences internationales d’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir montrent qu’un des premiers secteurs attaqués est le savoir scientifique et le service public de l’enseignement supérieur et la recherche, qui est le lieu d’émancipation par les savoirs et de développement de l’esprit critique. Face à l’urgence de la crise écologique et climatique, l’extrême-droite est également une force réactionnaire, qui abandonne les engagements et politiques en faveur de la biodiversité et de la transition socio- écologique et criminalise les actions des militants écologistes. L’extrême droite est aussi l’ennemi de l’égalité entre les femmes et les hommes et prône une régression en matière de droits des femmes (avortement, contraception, violences de genre) et des personnes LGBTQ+. Le SNCS-FSU appelle à participer aux alertes féministes du 23 juin proposées par plus d’une centaine d’organisations féministes ainsi que plusieurs syndicats dont notre fédération la FSU. https://alertesfeministes.org/
Dans le contexte exceptionnel de ce risque majeur de l’arrivée au pouvoir dans deux semaines, en France, de l’extrême droite, le SNCS-FSU appelle solennellement ses adhérentes et adhérentes à se mobiliser pour faire échec à l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet.
La mobilisation de toutes les forces de gauche et des organisations syndicales est nécessaire pour porter un autre projet de société, fondé sur des valeurs d’égalité, de solidarité, d’émancipation et de progrès social.
Dans cette situation inédite, le SNCS-FSU appelle, en toute indépendance et conscient de ses responsabilités, à voter massivement dès le premier tour pour celles et ceux qui s’engagent pour le programme du Nouveau Front populaire dont les mesures résonnent comme autant de pistes de progrès et de justice sociale. Cet appel ne constitue pas un blanc-seing, car si un gouvernement de gauche arrivait au pouvoir, nous nous mobiliserions pour défendre la mise en œuvre de nos revendications.