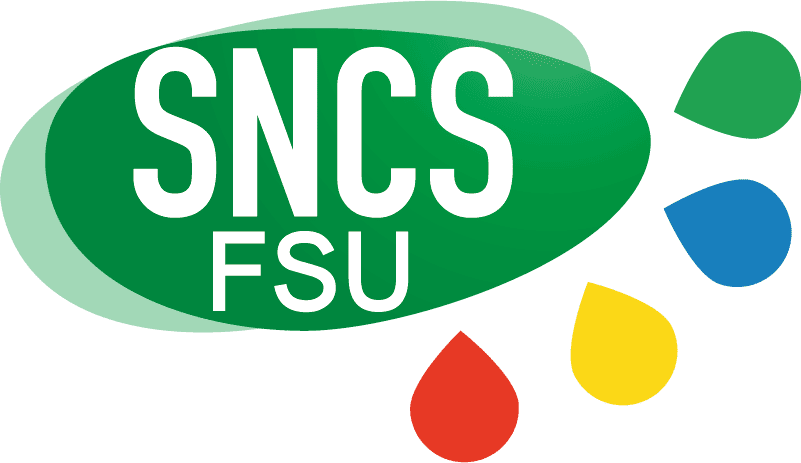Apprendre du handicap ?
Dans un contexte validiste, le handicap est envisagé a priori sous l’angle de la déficience et de l’anormalité. Pourtant, du fait de leur vécu, les personnes handicapées sont susceptibles d’offrir un nouveau regard sur notre commune vulnérabilité et de transmettre des savoirs expérientiels potentiellement utiles à tous dans le cadre d’une société du soin inclusive et humaniste.
Gaëlle Le Dref
Chargée de recherche au CNRS
Philosophe de la médecine et de la santé, Archives Henri-Poincaré – Philosophie et Recherche sur les Sciences et les technologies (CNRS – Université de Strasbourg, Université de Lorraine)
Les sociétés validistes tendent à naturaliser le handicap et à entretenir un système de domination et d’oppression vis-à-vis des personnes porteuses d’un handicap, ainsi que l’a théorisé notamment le sociologue Mike Oliver. Le regard validiste fait du handicap un stigmate, la marque manifeste d’une infériorité capacitaire, d’une déficience et d’un écart à la norme, au regard de ce qui est attendu d’un être humain en société, en particulier en termes de performance. De fait, les personnes handicapées rencontrent toujours des difficultés importantes pour aller à l’école, poursuivre des études à l’université ou trouver un travail, mais aussi pour se déplacer dans l’espace commun, emprunter les transports ou encore se rendre dans une salle de sport.
Dans un tel contexte, qui est celui d’une société validiste, se demander s’il est possible d’apprendre du handicap peut paraître absurde. En tant que personne elle-même porteuse d’un handicap, j’aimerais pourtant montrer dans cet article que nous pouvons tous, collectivement, apprendre des personnes porteuses d’un handicap, quelle que soit par ailleurs la nature de celui-ci. J’exposerai ainsi en quoi et dans quelle mesure les personnes porteuses d’un handicap peuvent être à l’origine d’apprentissages tant moraux que pratiques, à condition, toutefois, que les conditions de partage, de rencontre et d’échange avec les personnes porteuses d’un handicap soient effectivement réunies.
L’ÉCRAN DU HANDICAP : UN OBSTACLE À LA RELATION ET AU PARTAGE
Ces dernières années, les personnes porteuses d’un handicap sont devenues beaucoup plus visibles dans les médias, l’art et la littérature mais également dans les lieux publics. Malgré tout, la gêne et même le dégoût restent des émotions prédominantes lors de la rencontre avec une personne handicapée. À bien des égards, la personne porteuse d’un handicap, par son apparence, son comportement ou son inadéquation à l’idée que l’on se fait d’un être humain normal, est un monstre. Comme le souligne le philosophe Georges Canguilhem, la personne handicapée est un monstre car au-delà de la malformation ou de la non-conformation qu’elle donne à voir, elle rappelle aux êtres vivants que nous sommes, que la vie est incertaine, fragile, et que si la mort y met fin, la monstruosité ou le handicap en est la négation vivante. Le handicap a ainsi valeur de « repoussoir ».
Reprenant à son compte les analyses de Canguilhem, le philosophe Pierre Ancet affirme que la rencontre avec un « autre monstrueux », dont la personne porteuse d’un handicap est l’une des manifestations, est une violence. Le monstre suscite ainsi, de prime abord et de façon incontrôlée, l’effroi. Ce sentiment d’effroi tend à réduire la personne à son handicap, essentialisant celui-ci et faisant de la personne elle-même « un handicapé ». Or, il est difficile de communiquer avec « un handicapé », car il ne s’agit plus alors d’établir une relation avec une personne : c’est comme s’il fallait entrer en contact uniquement avec le handicap, cette caractéristique de la personne qui dérange et inquiète, et qui finit par dissimuler et même effacer la personne qui le porte. Le handicap, selon les termes de Ancet, fait ainsi « obstacle à la reconnaissance de l’autre », au point de susciter l’agressivité, la fuite ou le rejet. La personne porteuse d’un handicap a cette tragique faculté de manifester et rappeler ce que la vie humaine peut être. Comme un miroir, elle offre ainsi un reflet de soi angoissant, celui d’un autrui étrange dont on souhaiterait ignorer l’humanité et, par suite, ne pas apprendre à connaître.
Le handicap, par sa puissance d’angoisse, et parce qu’il tend à occulter aux yeux d’autrui la personne et son humanité, freine ou empêche l’amitié, c’est-à-dire la constitution de relations interpersonnelles fondées sur le respect et le partage, qu’il s’agisse du partage des émotions, des expériences vécues, des opinions ou des idées. Autrui, entendu comme personne amicale, est ainsi parfois quasi-inaccessible aux personnes porteuses d’un handicap, en dehors du cercle étroit de leurs proches et de leurs aidants. En lieu et place de l’amitié, la personne porteuse d’un handicap reçoit, au mieux, des manifestations de charité et, au pire, des manifestations d’apitoiement ou, au contraire, d’admiration ; manifestations qui toutes, aussi bien intentionnées soient-elles par ailleurs, la maintiennent à distance d’une véritable relation en l’enfermant dans une identité réduite au handicap. En d’autres termes, ce que le philosophe Bertrand Quentin nomme « l’empathie égocentrée », c’est-à-dire une empathie qui reste centrée sur une manière égotique et validiste de ressentir et de juger la vie, éloigne tout aussi sûrement d’autrui que peuvent le faire les comportements clairement et intentionnellement discriminatoires. La personne porteuse d’un handicap n’est en effet plus tant une personne qu’une tragédie vivante, naturellement vouée au malheur ou, à l’inverse, un héros, un être extraordinaire de vertus, qui a surmonté et même transcendé ses limites et ses souffrances.
La personne porteuse d’un handicap peut ainsi même être donnée en exemple aux valides, dans ce que la comédienne et journaliste Stella Young appelle la « pornographie de l’inspiration ». Ce procédé a plusieurs effets pervers : il fait oublier que le handicap est en bonne partie socialement construit et que les difficultés rencontrées sont loin de toujours relever de la responsabilité de la personne handicapée. Dans le même temps, elle produit une injonction à la performance potentiellement stigmatisante pour tous ceux qui peinent à faire avec leur handicap et enjoint les personnes à dissimuler ce que l’expérience du handicap peut avoir de profondément douloureux et négatif. Cette perspective validiste est empreinte de dolorisme, c’est-à-dire qu’elle suppose que l’endurance de la souffrance a un but et un sens, celui de conduire à un dépassement de soi moral et spirituel. Cette perspective n’est pas seulement absurde – la douleur n’apprend rien et ne signifie rien –, elle est aussi particulièrement violente pour tous ceux qui, comme le souligne Ruwen Ogien, ne possèdent pas les conditions matérielles de vie nécessaire pour faire face a minima.
Ainsi, dans un contexte valido-centré, si la personne porteuse d’un handicap est jugée admirable, notamment en accomplissant les activités les plus banales, telles que se faire à manger ou s’occuper de ses enfants, c’est parce qu’elle est supposée essentiellement et naturellement incapable. Et si elle est donnée en exemple, ce n’est donc que de manière superficielle : elle ne peut pas constituer véritablement une source d’inspiration pour une personne valide. Il n’est en réalité aucunement question d’apprendre de la personne porteuse d’un handicap et de son expérience de vie. De fait, sans véritable empathie et sans le désir de nouer une relation de type amical et d’échanger, apprendre d’une personne porteuse d’un handicap semble sinon impossible, du moins difficile. Pourtant, les personnes handicapées peuvent bel et bien être une source d’apprentissage, mais à condition de surmonter l’écran du handicap et d’entendre ce que le philosophe Paul Ricœur nomme « l’appel éthique ».
APPRENDRE LA SOLLICITUDE POUR LE BIEN DE TOUS
Selon Paul Ricœur, la souffrance ou la vulnérabilité « appelle » : elle impose la nécessité d’une réponse de la part d’autrui et constitue, pour qui veut l’entendre, une demande d’aide. Cette demande fonde potentiellement un rapport éthique. Ainsi est-il possible d’apprendre à développer une « empathie plus authentique », selon les termes de Bertrand Quentin, c’est-à-dire d’écouter davantage ce que les personnes handicapées ont à dire et à demander, précisément en les considérant comme des personnes et non plus des « handicapés ». À cette condition, aider et soulager les personnes en situation de handicap devient réalisable, c’est-à-dire sans leur faire violence, en les considérant comme des sujets à part entière dont l’autonomie doit être respectée. Lorsque cela est possible, il s’agit notamment de ne pas faire de la personne handicapée une personne absolument démunie et fragile, incapable de quoi que ce soit et à laquelle il faudrait éviter tout effort. Ce serait, encore une fois, la soustraire à la condition humaine, alors que, précisément, il s’agit de la restituer à cette condition que le validisme lui refuse.
À cet égard, la façon dont la philosophe Joan Tronto définit ce que devrait être le fait de « prendre soin » est particulièrement éclairante. Selon elle, et partant du principe que tout être humain est par définition vulnérable, il s’agit d’apprendre à développer certaines vertus nécessaires à la sollicitude que nous devons à autrui : le but est de prendre soin de façon appropriée et de telle manière que la personne conserve ou gagne en autodétermination. Tout un chacun est ainsi invité à s’exercer pour acquérir les dispositions nécessaires. Dans cette perspective, c’est en apprenant et en s’exerçant à la sollicitude, que tout un chacun peut prendre conscience du fait que le handicap est en partie relatif, car fonction de normes sociales qui mettent plus ou moins certaines personnes en situation de handicap. Se soucier de et se rendre relationnellement accessible aux personnes porteuses d’un handicap peut ainsi permettre de reconsidérer ce qu’est un handicap et ce qui lui donne son existence : la marginalisation et l’isolement ainsi que l’empêchement à agir et à se réaliser en fonction de ses aspirations. Or réaliser la relativité du handicap et sa composante sociale, c’est comprendre qu’être handicapé est en fait une injustice qui nous concerne potentiellement tous et qui peut être levée dès lors que nous modifions notre regard, que nous entrons dans une relation empathique et que nous œuvrons en faveur d’une politique inclusive et solidaire.
Rentrer en amitié avec une personne porteuse d’un handicap, à l’université, sur son lieu de travail ou encore à son club de sport, peut ainsi apprendre à œuvrer pour une société non invalidante, au moins à sa propre échelle, et, par suite, s’enrichir et enrichir l’espace commun de l’intelligence et de la personnalité de personnes qui en étaient jusqu’ici exclues, faute d’accueil. Selon Bertrand Quentin, la confrontation à la vulnérabilité à laquelle oblige la relation amicale et empathique avec la personne porteuse d’un handicap peut ainsi à la fois apporter quelque chose d’inédit à ceux qui l’entourent et les rendre meilleurs. Concrètement, prendre en compte les besoins des personnes porteuses d’un handicap, c’est aussi prendre en compte les besoins de tous, actuellement ou potentiellement – car à la suite d’un accident, d’une maladie, d’une grossesse ou de la vieillesse, nous sommes tous des personnes pouvant découvrir à nos dépens que nous sommes en situation de handicap. Ainsi, l’accessibilité des bâtiments et des transports est loin de ne rendre service qu’aux personnes handicapées, de même qu’un aménagement ergonomique du poste de travail ou du temps de travail. La perspective des personnes handicapées peut ainsi s’avérer très utile à tous.
DES SAVOIRS EXPÉRIENTIELS
En pratique, l’expérience de vie des personnes porteuses d’un handicap peut s’avérer particulièrement utile aux autres personnes handicapées ainsi qu’aux personnes malades, dépendantes ou se retrouvant provisoirement en situation d’incapacité. En effet, la personne porteuse d’un handicap, du fait des limites et des contraintes qui sont les siennes, et des adaptations qu’elle doit nécessairement mettre en œuvre au quotidien, est susceptible d’acquérir ce que l’on appelle des « savoirs expérientiels », c’est-à-dire des savoir-être et des savoir-faire, réfléchis et analysés comme tels, et pouvant être transmis à d’autres personnes vivant des situations comparables. Le handicap n’est en effet pas une caractéristique comme les autres : il implique une façon « d’être-au-monde », selon les termes de l’anthropologue Robert Murphy. D’une certaine façon, le handicap est toujours présent à soi et constitue comme un préalable incontournable dans la façon d’aborder l’environnement physique et social, d’élaborer des projets ou encore dans sa façon d’être avec autrui.
De fait, les personnes porteuses d’un handicap doivent de façon aiguë adapter et s’adapter à leur environnement physique et social, savoir demander et accepter de l’aide d’autrui, gagner et conserver leur autonomie et le respect d’elles-mêmes, pour, précisément, ne pas se laisser réduire au handicap. Concrètement, le handicap implique de s’adapter et de mobiliser attention et énergie en quasi-permanence, y compris pour les activités les plus simples de la vie, qui, pour la plupart des individus, ne présentent aucune difficulté, ne mobilise aucune réflexion et sont, par là-même, insignifiantes. Or pour les personnes porteuses d’un handicap, nombre de ces activités, comme se déplacer hors de chez soi, travailler, se faire à manger, s’habiller, etc., ne sont jamais insignifiantes : ces activités, simples en apparence, sont susceptibles de mobiliser des efforts conséquents. Là où pour la plupart des individus, il ne se passe rien, la personne porteuse d’un handicap est astreinte à l’action et à la planification, mobilisant ses ressources pour parvenir à effectuer les activités à la fois essentielles et banales du quotidien. Elle superforme en permanence.
L’expérience intime du handicap prend ainsi toutes les allures d’un « métier », selon la métaphore employée par Ruwen Ogien à propos de la maladie. Aussi, à l’instar du métier, le handicap nécessite un « apprentissage », celui de savoir faire et de savoir être avec le handicap. Les personnes porteuses d’un handicap acquièrent des facultés ou capacités qui font d’elles des personnes aux savoirs singuliers. Selon la sociologue Ève Gardien, les expériences des personnes handicapées peuvent ainsi profiter à tous, dès lors que ces expériences sont élaborées en savoirs expérientiels : elles peuvent être à l’origine d’enseignements et de conseils très concrets sur la façon de gérer les contraintes liées à la dépendance et d’améliorer sa qualité de vie, que ne sont pas toujours capables de prodiguer les professionnels des secteurs médical et social.
À l’instar de ce qui est déjà relativement développé dans le cadre de la psychiatrie, on peut imaginer que les personnes porteuses d’un handicap pourraient endosser la fonction de pair-aidant dans les institutions sanitaires et sociales que fréquentent les personnes handicapées et, offrir, en plus de leurs savoirs expérientiels, ce que Bertrand Quentin appelle une « empathie non égocentrée » et donc non stigmatisante. Les personnes handicapées peuvent ainsi devenir des aidants ou des soignants, aux côtés de ceux dont c’est la profession, au service d’autres personnes handicapées et, plus largement, en situation d’incapacité. Or, loin de n’être qu’un complément aux savoirs théoriques et scientifiques, la pair-aidance peut aussi transformer les perspectives des professionnels du soin et du social. Elle réinterroge les savoirs experts et, selon l’avis même des professionnels, elle réhumanise les pratiques et redonne du sens à leur métier. Du côté des « aidés », l’enjeu est celui du développement de l’autonomie et du pouvoir d’agir (l’empowerment), le pouvoir de se réapproprier sa vie et de lui donner la direction que l’on souhaite en fonction de ses aspirations propres.
La participation des personnes porteuses d’un handicap à la réflexion collective en santé publique et en promotion de la santé peut ainsi être bénéfique à tous, puisque tous, nous sommes vulnérables et, qui plus est, susceptibles d’être un jour en situation d’incapacité ou de dépendance. De la même façon que les patients sont de plus en plus souvent conviés à des recherches participatives en santé, les personnes handicapées pourraient également se joindre à ce type de recherche, où le savoir expérientiel est considéré, sinon au même titre que les savoirs experts, à tout le moins comme essentiel et de valeur. De plus, comme le souligne Bertrand Quentin, l’un des meilleurs moyens pour accueillir véritablement les personnes porteuses d’un handicap, est de ne pas parler à leur place et de les faire participer aux processus délibératifs et aux prises de décision qui les concernent directement. Dans un idéal de démocratie sanitaire, il est d’ailleurs légitime d’accorder aux personnes handicapées le moyen de faire part de leurs besoins et des meilleures façons d’y pourvoir – sans compter, comme nous l’avons vu, que les bénéfices qui en découleraient profiteraient à tous.
UNE SOCIÉTÉ HUMANISTE
Apprendre à reconnaître la personne malgré le handicap, et lui offrir amitié et sollicitude, est porteur d’un enrichissement mutuel qui est le propre des sociétés hospitalières fondées sur la reconnaissance, notamment – si l’on reprend l’analyse du philosophe Axel Honneth –, en permettant à chacun de se percevoir comme digne d’attention, de droits égaux et contributifs à la vie collective. Dès lors que nous soutenons les valeurs d’une république solidaire et fraternelle, il n’est pas possible de continuer à traiter des personnes de telle sorte qu’elles se retrouvent en situation de handicap et qu’elles constituent une communauté de personne minorées et marginalisées, alors même que cela pourrait être évité. D’une manière plus générale encore, il est essentiel de garder à l’esprit que nous sommes tous vulnérables et qu’une société humaniste et aussi une société du soin, comme le souligne la philosophe Cynthia Fleury, qui se doit de permettre à quiconque, quelles que soient ses fragilités propres, d’être autonome et en mesure de vivre une existence satisfaisante et non pas simplement de survivre dans ses marges.
Cet article est tiré du n°443 de notre revue La Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéros dans notre rubrique VRS.