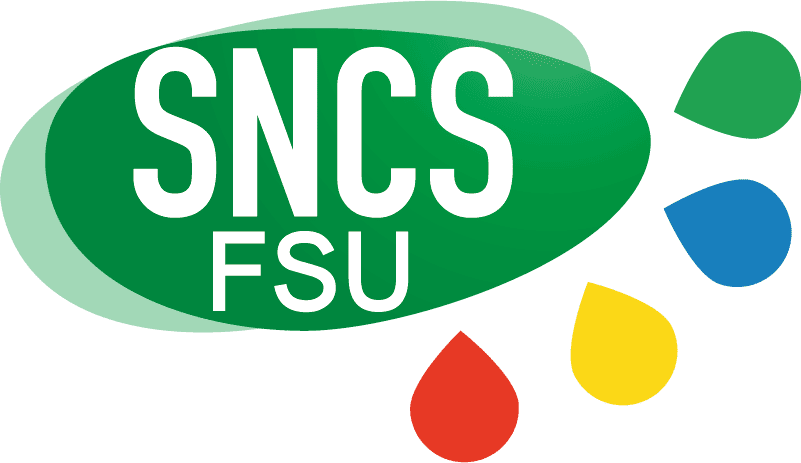Compte-rendu de l’assemblée générale de la section nationale handicap du SNCS du 17/06/2025
Compte-rendu de l’assemblée générale de la section nationale handicap du SNCS du 17/06/2025
L’AG s’est tenue le 17/06/2025 en visioconférence et a réuni 38 personnes.
La réunion a été préparée et animée par le bureau de la section handicap.
Secrétaires de la section : Marion Ink, Laurent Loty et Simon Tricard
Autres membres du bureau : Katia Le Barbu-Debus, Maud Leriche et Damya Souami
Une traduction en langue des signes française (LSF) a été proposée et a vocation à être pérennisée pour les AG à venir.
_________________________________________________________________________________
1. ACTUALITE
Promotions spécifiques handicap au CNRS
Divers rebondissements ont eu lieu ces six derniers mois au CNRS sur la mise en place de l’article 93 de la loi de 2019 pour les promotions spécifiques handicap.
La loi de 2005 est appliquée pour les recrutements spécifiques handicap, afin de rejoindre le taux légal de 6% de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). Le CNRS était à 5.3% en 2023. Or, rien n’avait été prévu par le législateur pour l’évolution de la carrière des personnes en situation de handicap. Quatorze ans après, l’article 93 de la loi de 2019 et son décret d’application de 2020 consistent à faciliter le changement de corps des BOE, par la création d’une voie de détachement suivi d’une intégration dans un corps supérieur. Cet article est expérimental, c’est-à-dire temporaire, mais a force de loi. Il doit s’arrêter en 2026.
Or la mise en œuvre de cette opportunité a été bloqué depuis cinq ans au CNRS pour les chercheurs et chercheuses, du fait d’une erreur juridique. La loi est construite sur un parallèle avec les concours internes, et il n’existe pas de concours DR avec la dénomination « interne ». L’erreur est de ne pas considérer le passage CR-DR comme tel, alors qu’il est de facto interne pour 95% des lauréats au concours DR. En outre, la DRH du CNRS a également bloqué la mise en œuvre de l’article 93 pour les ingénieurs, ingénieures, techniciens et techniciennes (IT), alors il n’y avait là, à leurs yeux, aucun obstacle. Grâce à la très forte mobilisation du SNCS à divers niveaux, la direction du CNRS avait enfin décidé de mettre cet article en application pour 2025, pour les chercheurs et les IT, avec l’aval du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Un retournement de situation a eu lieu fin mai. Le PDG du CNRS a reçu un courrier signé du ministre de l’ESR qui affirme que l’article 93 n’est pas applicable pour passer de CR à DR. Cela n’a pas été décidé au niveau du MESR, mais au niveau au dessus, à la direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP). Ce nouveau blocage repose sur une nouvelle erreur d’interprétation, une confusion grossière entre l’usage du mot supérieur pour désigner un corps supérieur à d’autres, et son usage pour désigner l’encadrement supérieur de l’État, comme les délégués ou secrétaires généraux de grandes institutions. Le syndicat continuera à défendre la mise en application du décret pour tous par tous les moyens. Différentes pistes sont envisagées, comprenant la saisie du tribunal administratif, du défenseur des droits, ou de la cour européenne des droits de l’homme.
Le projet d’application de l’article 93 reste valable pour les IT et va être présenté aux instances paritaires fin juin. Il comporte un calendrier extrêmement serré, se limitant à des « remontées de besoins » aux instituts, sans aucune publicité auprès des principales personnes intéressées. Les directeurs d’unité (DU) doivent donc remonter leur soutien aux personnels BOE dont ils ont la responsabilité à la DRH par l’intermédiaire des instituts. Le SNCS dénonce fermement cette procédure obscure et inégalitaire, à l’instar des recrutements spécifiques. 3 promotions de T vers AI, 2 d’AI vers IE, et 2 d’IE vers IR avaient été annoncés. La DRH avait oublié l’existence des adjoints techniques de la recherche (ATR) promouvables T, alors que près de 50% des ATR sont BOE au CNRS. Depuis, 1 promotion d’ATR vers T a été ajoutée. Le rattrapage des promotions spécifiques non mises en place entre 2020 et 2025 n’est pas à l’ordre du jour.
Dans tous les cas, il est primordial que le CNRS mette en œuvre les promotions spécifiques handicap décrites par l’article 93 de la loi de 2019, car au-delà de l’équité due aux collègues BOE, cela aura très certainement un effet d’entrainement pour les autres EPST qui ne l’ont pas mis en application à ce jour.
Action syndicale
L’action syndicale du SNCS sur les questions de la politique handicap est constante auprès des instances du CNRS, aussi bien au comité social d’administration (CSA), en commission nationale de développement professionnel (CNDP), qu’en formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), où les dysfonctionnements de la DRH sont régulièrement remontés. En particulier, quatre avis avec réponse obligatoire ont été émis par les élus au CSA du 27/05/2025 : 1/ les statistiques sur les avancements des personnes en situation de handicap ont été partagées avec les syndicats (hors concours internes et concours CR-DR) : un retard de carrière est clairement identifié pour les IT, avec plus de promouvables que de promus ; pour les chercheuses et chercheurs, c’est tout simplement le taux des BOE qui est faible (3% des CR, 1.5% des DR) ; il est donc demandé à la DRH la mise en place d’une politique volontariste ; 2/ le recrutement spécifique des chercheuses et chercheurs a été extrêmement mal organisé cette année, avec de nombreux dysfonctionnements de la prise en charge et des envois tardifs des convocations ; 3/ les outils de réservation des missions ne sont pas adaptés aux personnels handicapés, ce qui crée de réelles difficultés pour les missions ; 4/ l’effort sur la mise en place de l’article 93 doit être mené de manière conjointe entre la direction et les instances syndicales. À la F3SCT du 25/06/2025, les élus ont aussi déposé des avis avec réponse obligatoire, deux sur la prolongation de la convention avec le fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), et huit sur le plan handicap 2025-2028.
Par ailleurs, la section handicap du SNCS a participé aux réunions préliminaires au sein du groupe de travail handicap du MESR pour l’élaboration d’un plan handicap interministériel.
Annonces
La date limite pour saisir les demandes DIALOG, où les DU font remonter les demandes d’ouverture de recrutements spécifiques BOE, a été avancée au 26 juillet cette année, alors qu’elle est généralement fixée en septembre.
Suite au refus du ministère de la mise en place de l’article 93 pour les chercheuses et chercheurs, la direction du CNRS insiste sur la nécessité de faire figurer dans le rapport des jurys d’admissibilité, rapports qui sont transmis aux jurys d’admission pour décision définitive de nomination, tous les éléments qui permettent de prendre connaissance de la situation personnelle des candidats et candidates. Cette information a été diffusée en CPCN (Conférence des Présidents du Comité National). Cet exemple confirme que la bataille sur le handicap peut mener à des progrès pour tous. La prise en compte des circonstances personnelles particulières dépasse largement le handicap : enfants en bas âge, proches aidants, temps partiel, maladie, etc. Le fait de faire figurer toute circonstance personnelle particulière ayant un impact sur l’activité professionnelle dans les rapports des jurys serait une avancée majeure pour une évaluation juste. (Le jury d’admission, qui s’est tenu peu après cette assemblée générale, semble malheureusement ne pas avoir pris en compte de telles recommandations dans certaines situations spécifiques liées au handicap.)
Un dossier sur le handicap sera présent dans le numéro de la revue La Vie de la Recherche Scientifique (VRS) de décembre.
Stagiaire juriste au sein de la section handicap
Larissa Kanmogne est en stage de M2 en droit, encadrée par Amandine Sarrazin, Maud Leriche, et Damya Souami au SNCS. Son travail de stage consiste à réaliser des notes juridiques sur divers sujets liés au handicap (loi de 2005 ; marchés publics ; corps et catégories de fonctionnaires ; accessibilité ; loi de 2019), et à effectuer une veille juridique. Elle réalisera également un sondage qui sera diffusé dans toutes les EPST sur la réalité de terrain de la loi de 2005, et la reconnaissance administrative des personnels en situation de handicap. Ce sondage sera adressé à tous, handicapés ou pas, syndiqués ou pas. Larissa participera également à l’élaboration de dossiers pour le numéro spécial handicap de la VRS de décembre.
_________________________________________________________________________________
2. REFLEXIONS DE FOND
Bimensuel Faire Face
Valérie Di Chiappari, rédactrice en chef du bimestriel Faire Face, est intervenue pour présenter le magazine et le média en ligne édité avec l’association APF France handicap. Cette association, initialement dénommée Association des paralysés de France a été créée en 1933. Faire Face a pour objectif d’aider à mieux vivre le handicap, en donnant des informations pratiques sur la défense des droits, la santé, la vie sociale, les loisirs, le sport, la culture. Il rassemble également des dossiers thématiques comme par exemple dernièrement sur l’accès aux soins, ou l’intelligence artificielle et le handicap. Il accorde une grande importance à donner la parole aux personnes concernées. Des notices juridiques sont accessibles en ligne.
https://www.faire-face.fr/
Le validisme des institutions et de certains comportements
Le validisme ou capacitisme est un système de valeurs sociales faisant de la personne dite « valide », sans handicap, la norme sociale. Il est formé par analogie avec le terme anglophone « ableism ». Cette notion a été introduite en France par Zig Blanquer en 2004. Il consiste à porter un jugement envers une personne handicapée, face à une norme, à la considérer comme un être à part. Un parallèle peut être évoqué avec le racisme ou le sexisme, pour lesquels nous sommes plus sensibilisés. Par exemple, il arrive régulièrement que des formulaires demandent à des responsables : « accepteriez-vous une personne en situation de handicap dans votre équipe » ? L’effet est beaucoup plus saisissant si on remplace « personne en situation de handicap » par « personne noire » ou « femme ». Les tenants et aboutissants sont comparables. Le validisme peut partir d’une bonne intention, où les éloges peuvent paradoxalement être validistes : un « tu es hyper courageux » peut renvoyer le handicap de la personne en pleine face. Il est alors plus approprié de partir de ce que dit la personne pour exprimer son admiration, de poser des questions plutôt que de projeter. Les institutions sont aussi parfois dans une logique validiste, comme quand les recrutements BOE se font en CDD et non pas comme fonctionnaire stagiaire. Dans certains cas, la violence institutionnelle est plus difficile à vivre que le handicap lui-même. La différence pose des questions. Les stéréotypes sont inhérents à notre société. C’est pourquoi dans les sensibilisations et les formations liées au handicap, il est primordial d’insister sur l’antivalidisme, tout autant que sur le handicap en tant que tel. Cela rejoint un but à terme de ne plus avoir à cacher un handicap, de le banaliser. Un podcast de France culture donne des éléments d’intérêt sur le validisme :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/lutter-ensemble-contre-le-validisme-4967854
_________________________________________________________________________________
3. DISCUSSIONS
Correspondants handicap des sections
Il a été rappelé l’importance de désigner des correspondants handicap des sections du Comité National et d’afficher leurs coordonnées.
DRH du CNRS
Le turn-over des membres de la DRH est extrême, et le manque de personnel est criant. Cela explique les dysfonctionnements décrits plus haut, mais n’excuse pas le manque de considération de l’institution pour ses personnels BOE. Il est notable que la direction du CNRS agit de concert avec les organisations syndicales sur les questions du handicap, avec une prise de conscience récente. Cette volonté d’action ne mérite que d’être soutenue et consolidée.
Journée nouveaux entrants
Un témoignage a été partagé par rapport à la séparation des recrutements BOE et des concours classiques. Le nombre de recrutements CR est affiché par section. Lors de la journée des nouveaux entrants, la personne en question a été dans l’obligation de se justifier et d’indiquer qu’elle a été recrutée par la voie contractuelle pour expliquer sa présence « en plus ». Cette situation inconfortable mérite réflexion pour voir si une solution existe, l’invitation des recrues BOE aux journées des nouveaux entrants restant cependant un point important à maintenir.
Handicap psychique
Les handicaps psychiques sont éligibles à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), dont la demande se fait à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et peuvent mener à des adaptations de postes de travail spécifiques.
ESAT
La question de l’appel aux établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) a été abordée. Ce travail est en effet décompté pour le calcul du taux d’emploi BOE des institutions, sans que ce soient des postes pérennes de fonctionnaires.
INSERM
Une journée a été organisée par la mission insertion handicap (MIH) de l’INSERM sur la sensibilisation aux questions du handicap.