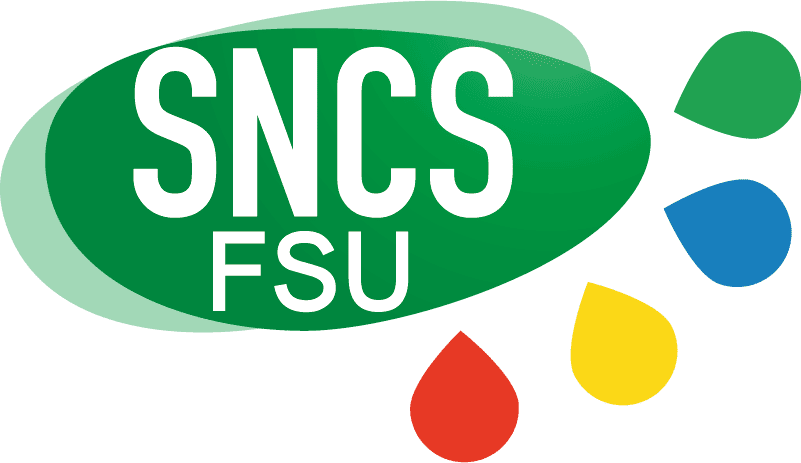Recherche : une ombre sur les lumières
Qu’est-ce que la démarche scientifique ?
Boris Gralak, secrétaire général du SNCS-FSU nous précise la nature et les menaces qui pèsent aujourd’hui sur la démarche scientifique.
Une démarche scientifique est globalement fondée sur une méthode accompagnée de protocoles, dont la nature dépend du type de sciences. On peut distinguer deux grands catégories, les sciences dites « de la nature » (aussi qualifiées de « dures » en France) ou logico déductives comme les mathématiques, l’informatique, la physique, la chimie ou encore la philosophie, et d’autre part les sciences dites « humaines et sociales », dont la démarche s’appuie sur des informations nécessairement partielles comme les enquêtes, la collecte de témoignages et l’observation des individus, des populations et des sociétés. Entre les deux, les sciences biologiques ou médicales recherchent des conclusions scientifiques fondées sur l’observation de patient·es, l’exploitation de tests en série qui permettent de dégager, avec une statistique suffisante, un effet ou une tendance. Le consensus scientifique nait du constat de la reproductibilité des résultats reposant sur des protocoles et des méthodes suffisamment rigoureux et décrits.
Dans les sciences sociales, comme la sociologie ou l’économie, il est possible que nous parvenions à une période charnière avec la généralisation du recours à l’Intelligence Artificielle. Les chercheur·es élaborent des hypothèses puis tentent de les valider, ou non, à travers des enquêtes, très difficiles à exploiter. Or avec l’IRA, dégager des tendances devient possible en traitant des masses considérables de données, que l’intelligence humaine ne serait pas capable de maîtriser.
L’élaboration scientifique des savoirs est aujourd’hui gravement menacée par diverses forces politiques, religieux ou économiques. L’industrie du tabac a ainsi pendant des décennies manipulé, financé des études dont elle a orienté les conclusions pour nier le caractère nocif des addictif de sa production. Les industriels du pétrole et de l’automobile en ont fait de même pour nier les conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique, avec à la clé des années de retard pour la véritable recherche scientifique.
L’administration Trump remet en cause l’existence du dérèglement climatique, après avoir nié les consensus scientifiques pendants la crise de la COVID-19 ; avec son complice Musk, il met au même niveau savoir scientifiques et opinions en récusant toute pratique de modération sur les réseaux sociaux. Ces méthodes sont communes aux régimes populistes et autoritaires dans le monde entier comme hier dans le Brésil de Bolsonaro et aujourd’hui dans l’Argentine de Milei et la Chine de Xi Jinping. Ainsi, la Russie de Poutine falsifie l’histoire pour justifier l’agression de l’Ukraine.
L’intégralité de la revue POUR n°264 est disponible sur le site fsu.fr.