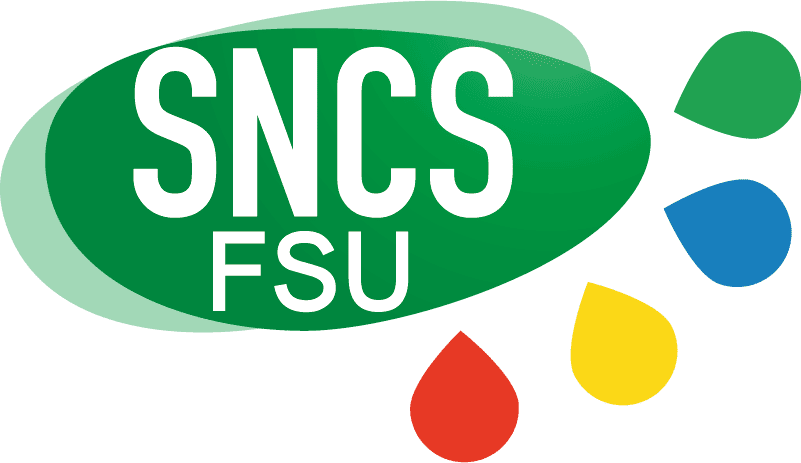Protéger l’autonomie scientifique en France et aux États-Unis
Pour faire face à des défis sociaux et environnementaux urgents, les démocraties contemporaines ont besoin d’experts scientifiques. Pourtant, ces experts sont de plus en plus confrontés à une classe politique qui met à mal leur autonomie et remet en question la légitimité de leurs savoirs. Dans un contexte de crise de l’expertise, les expériences des chercheurs français et étatsuniens nous enseignent l’importance de sensibiliser les universitaires à la réalité politique.
Michael Strambolis-Ruhstorfer
Sociologue et maître de conférences en études américaines à l’Université Toulouse – Jean Jaurès
Au bout du fil, un climatologue réputé, ayant participé aux travaux du GIEC, répondait parfois difficilement à mes questions. Fonctionnaire depuis de nombreuses années affecté à une agence fédérale étatsunienne, il m’expliquait qu’il n’était pas autorisé à discuter de sujets politiques. L’entretien portait sur ses conditions de travail, ses recherches et son avis sur la place que devrait occuper l’expertise scientifique dans la prise de décision en démocratie. Loin d’être un obstacle m’empêchant d’arriver au bout de ma longue liste de questions, sa crainte de franchir une ligne de démarcation symbolique entre science et politique, de ce qu’il avait le droit de me dire ou pas, nourrissait mon analyse. Son interprétation était riche d’enseignements sur son contexte et sur la position fragile et contestée des scientifiques dans la période actuelle.
Mener à bien des recherches et informer les décideurs en se fondant sur un savoir scientifique de bonne qualité a toujours été une mission difficile. Cela nécessite un système de recherche qui donne les moyens adéquats aux chercheurs, qui garantit leur autonomie vis-à-vis du champ politique et qui permet un travail transparent et collectif. Par ailleurs, dans une démocratie saine et fonctionnelle, une interaction science-société juste nécessite un débat de bonne foi sur la science comme bien public. Les citoyens doivent pouvoir discuter ouvertement de la place appropriée des experts dans la prise de décision afin de contrer toute manipulation démagogique ou technocratique de la parole scientifique. Aujourd’hui, cette mission est quasi impossible à accomplir.
SOUMETTRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
Quand j’ai posé mes questions au climatologue, nous étions en février 2020, quelques semaines avant que la pandémie de COVD-19 ne secoue l’ensemble des pays du globe et ne mette encore les scientifiques au centre d’un nouveau défi mondial. J’étais aux États-Unis pour mener la partie américaine d’une enquête transatlantique sur le rôle des experts dans les débats politiques controversés, dont celui sur le changement climatique. À cette époque, certains chercheurs en climatologie aux États-Unis m’avouaient en off qu’ils étaient embarrassés par l’attitude du gouvernement Trump. En particulier, les fonctionnaires travaillant pour des organismes publics fédéraux, tels que la NASA ou la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), étaient sous la coupe d’un ordre du président leur interdisant de s’exprimer sur des questions dites « politiques ». Ils et elles pouvaient m’expliquer l’état de la recherche sur l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, par exemple, mais ne pouvaient se prononcer sur la nécessité de les réduire. Contrairement aux agents fédéraux, leurs collègues travaillant dans des universités, publiques ou privées, jouissaient d’une liberté académique leur permettant de s’exprimer plus librement. Pour l’ensemble de ces experts, le contexte politique généralement hostile à leurs recherches représentait une certaine menace pour la production de savoirs scientifiques et, par conséquent, un frein à l’action contre le changement climatique. Quant aux chercheurs français, ils semblaient moins inquiets d’une éventuelle ingérence politique directe, mais déploraient le manque de moyens chronique, la dégradation de leurs conditions de travail et l’attitude sceptique d’une partie des élus et des médias à leur égard.
Plus de cinq ans après, la situation sur les deux rives de l’Atlantique s’est très largement dégradée. Aux États-Unis, le président Trump, fraîchement élu, à l’aide d’un Elon Musk et d’un parti républicain désireux d’en finir avec l’état de droit, ne se contente plus de restreindre la parole des agents fédéraux. J. D. Vance, le nouveau vice-président, a déclaré que les « universitaires sont l’ennemi » et le nouveau régime agit en conséquence, mettant en place des mesures illégales et anticonstitutionnelles. Il licencie en masse des scientifiques travaillant pour le gouvernement fédéral, réduit à néant des financements publics de la recherche, ferme ou détruit des agences essentielles à l’infrastructure de la recherche et mène des enquêtes à charge contre des universités tout en les menaçant de représailles administratives lourdes. Les conséquences sont immédiates et catastrophiques. Même en cas de retour à un régime non autoritaire aux États-Unis, les dégâts faits au système scientifique étatsunien – et par extension mondial – seront difficilement réparables.
Bien que moins spectaculaire, la situation en France n’est pas moins inquiétante. En France, les responsables politiques sont de plus en plus enclins à passer de la parole aux actes. Des ministres, avec l’aide d’éditorialistes alliés, prétextent une « gangrène idéologique wokiste », comme le font leurs homologues étatsuniens, pour justifier des coupes drastiques dans les crédits, une augmentation de la surveillance et de la sanction des universitaires, et une surenchère compétitive au profit du secteur privé à but lucratif.
Dans les deux cas, l’objectif est clair : réduire au maximum l’autonomie des chercheurs et des institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) afin de mieux contrôler la production du savoir scientifique et de diminuer la pensée critique. Les autocrates en devenir visent en premier lieu le personnel et les institutions de l’ESR, qu’ils perçoivent comme une source de résistance à leur prise de pouvoir. Or, si nous souhaitons préserver la démocratie et permettre aux experts scientifiques de participer à la décision politique de manière démocratique, la préservation de l’autonomie de l’ESR est fondamentale. Les expériences de celles et ceux qui ont participé à mon enquête le suggère.
CRISE DE L’EXPERTISE
Les attaques actuelles contre l’autonomie des scientifiques surviennent dans un contexte de « crise de l’expertise ». Selon des sociologues des sciences, des savoirs et de la technologie, cette crise se caractérise par une double tendance. D’un côté, les problèmes auxquels les sociétés contemporaines font face – le changement climatique, les dérives du capitalisme mondial financiarisé, la santé publique et tant d’autres – nécessitent la maîtrise d’un savoir technique précis. Les scientifiques et d’autres professionnels hautement qualifiés sont donc essentiels à l’élaboration de solutions à ces problèmes. D’autre part, des citoyens formulent des critiques, souvent légitimes et justifiées, envers une technocratie détachée de la volonté populaire. Ils insistent sur le fait que l’expertise ne doit pas usurper le débat politique. Cette critique se traduit parfois par une méfiance, voire une défiance, vis-à-vis des actions publiques informées par la science ; le climatoscepticisme et le rejet des vaccins sont, à cet égard, des exemples bien connus.
Les responsables politiques et les experts scientifiques qu’ils sollicitent pour guider l’action publique – tels que les membres du Haut Conseil pour le Climat ou les contributeurs aux rapports du GIEC –se retrouvent au centre des forces contradictoires de cette crise. Le danger pour les scientifiques que j’interroge dans le cadre de mon enquête se présente lorsqu’ils sont confrontés à des responsables politiques qui leur demandent de rendre un avis sur un choix politique.
Certains ont l’impression que les élus ne cherchent pas à s’informer sincèrement, ni à changer de cap si leur expertise va à l’encontre de l’action préconisée, mais qu’ils se servent des experts dans un jeu politique. Il y a une crainte manifeste d’une manipulation. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. La présence d’experts peut servir à justifier une décision déjà prise. Elle peut également servir de paratonnerre pour absorber le mécontentement d’une décision impopulaire : plutôt que d’assumer de devoir imposer une décision difficile (l’abandon des habitations face à l’érosion côtière ou le port du masque, par exemple), les élus peuvent faire porter la responsabilité par les experts. Enfin, des responsables politiques peuvent consulter des experts scientifiques en public, puis faire l’inverse de ce qu’ils préconisent. En défiant leur avis, ces politiques peuvent se donner une image populiste en disant qu’ils défendent le bon sens contre des scientifiques déconnectés de la vie quotidienne des gens ordinaires. C’était le cas lorsqu’Emmanuel Macron a explicitement refusé de suivre les avis du Conseil scientifique qu’il avait lui-même mis en place au début de la crise sanitaire du Covid-19. Chacune de ces possibilités porte atteinte à la crédibilité et à la légitimité des experts scientifiques.
UNE FORMATION POLITIQUE POUR LES SCIENTIFIQUES
Comment faire face à la crise de l’expertise et à l’ingérence des acteurs politiques dans le champ scientifique dans un contexte de montée en puissance des forces autoritaires ? Les réponses de mes enquêtés à cette question sont multiples et dépendent de leurs positions idéologiques, de leurs postures épistémologiques, de leurs orientations disciplinaires et de leurs perceptions de la situation politique. Certains estiment qu’un scientifique ne peut pas prendre d’engagement sur les questions qu’il ou elle étudie. Afin d’éviter tout risque de se faire taxer de militantisme et de perdre en légitimité, ils soutiennent qu’il est important de garder une neutralité axiologique. D’autres rejettent l’idée que la science puisse être neutre ou apolitique. Ils défendent une objectivité forte, proche d’une épistémologie féministe selon laquelle il faut reconnaître la part subjective et sociale dans le travail scientifique afin de produire un savoir plus complet. Cette position n’est pas incompatible avec un engagement politique ou un militantisme, à l’instar des Scientifiques en rébellion, par exemple. En s’accordant la possibilité de se dire à la fois scientifique et militant, ces experts sont mieux placés pour défendre vigoureusement l’autonomie du champ scientifique face à la répression politique.
Malgré leurs différences d’opinion sur la notion de neutralité, les experts scientifiques aux États-Unis et en France expriment toutefois un désir commun : mieux comprendre les rouages du système politique et judiciaire. Ils identifient correctement un manque de formation dont peu de gens se soucient.
En effet, il est fréquent d’entendre que le manque de culture scientifique des responsables politiques pose un problème majeur à la bonne mobilisation de la science par les décideurs. Mes enquêtés sont régulièrement confrontés à ce problème. Ils disent avoir du mal à être entendus par les décideurs. Alors qu’ils expliquent la nuance, le doute et les lacunes du savoir scientifique qui s’accumulent lentement sur un sujet précis, ils ont l’impression que les décideurs attendent d’eux une réponse rapide, tranchée et normative. Tout l’inverse du registre scientifique. Des efforts sont faits pour remédier à ce manque de culture scientifique dans le milieu politique. La formation obligatoire des hauts fonctionnaires français aux enjeux du changement climatique en est un bon exemple.
En revanche, on se pose beaucoup moins la question de la bonne compréhension du milieu politique par les scientifiques. Celles et ceux qui sont sollicités pour témoigner devant une commission parlementaire, rédiger un rapport d’expertise ou siéger dans un conseil scientifique sont généralement obligés d’apprendre sur le tas. Souvent, ils ne connaissent pas le fonctionnement des institutions législatives et judiciaires et sont donc dépassés par des logiques politiques et juridiques. On pourrait en dire de même de leur connaissance du fonctionnement des médias. Cette mécompréhension les rend vulnérables à la manipulation. Une meilleure connaissance des spécificités du monde politique et de ses règles pourrait les aider.
LA SOLIDARITÉ ET LE TRAVAIL COLLECTIF FACE À L’INGÉRENCE POLITIQUE
Cette formation pourrait être l’occasion de créer un rapport de force qui permettrait de renforcer l’autonomie des scientifiques vis-à-vis des pouvoirs politiques. Cela est d’autant plus urgent dans le contexte actuel. Cependant, pour cela, il faut que les scientifiques qui le souhaitent se forment de manière collective, solidaire et autogérée. De plus, pour comprendre les institutions politiques, les scientifiques doivent accepter une certaine forme d’auto-critique et se donner l’occasion d’analyser et de critiquer les aspects politiques du champ scientifique lui-même. En effet, le milieu universitaire est hiérarchique, exclusif et inégalitaire. Or, la compétitivité et la course à l’excellence, des valeurs qui sous-tendent le bon fonctionnement scientifique lors d’une évaluation par les pairs, par exemple, sont actuellement instrumentalisées par les pouvoirs politiques afin de saper la solidarité entre les scientifiques. Cela rend l’ESR vulnérable à sa reprise en main par des forces malveillantes, telles qu’un pouvoir politique autoritaire ou des intérêts privés.
La solidarité scientifique va de pair avec une lutte contre l’individualisation de l’expertise, que la starisation du travail scientifique encourage. La majorité des experts scientifiques que j’ai interrogés affirment que la bonne légitimité scientifique ne devrait pas se fonder sur la notoriété médiatique d’un ou d’une scientifique, mais sur la communication fiable de l’état de l’art dans un domaine spécifique. Enfin, la formation politique des scientifiques doit également intégrer une analyse lucide sur le recours aux experts par des adversaires des causes progressistes et de la lutte contre le changement climatique. Des sociétés de conseil et des organismes réactionnaires, tels que le think tank étatsunien la Heritage Foundation, responsable du projet 2025 déployé actuellement par le gouvernement Trump pour subjuguer la société civile, tissent des liens avec des universitaires alliés qui leur donnent un semblant de légitimité scientifique. Ironie du sort, ce sont souvent les mêmes qui qualifient leurs collègues de militants tout en participant activement à la diminution de l’autonomie scientifique au profit des pouvoirs malveillants. Ignorer ces alliances ou pire, refuser de les reconnaître sous prétexte qu’il faut rester neutre, ne peut que conduire à l’exacerbation de la délégitimation de la science.
Cet article est tiré du n°440 de notre revue la Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéro dans notre rubrique VRS.