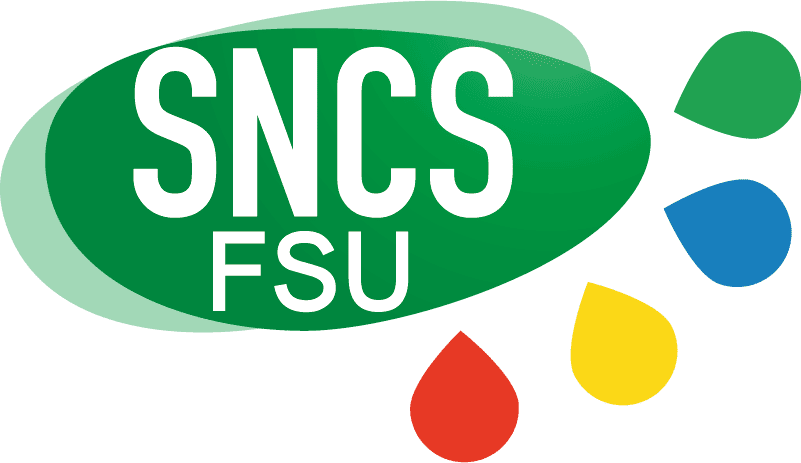La résistance universitaire au trumpisme
Dans cet entretien du 31 janvier 2025, Pascal Marichalar recueille l’avis de Joan Scott sur les dix premiers jours de la deuxième administration Trump. Publié dans Mouvements1, nous reproduisons de larges extraits de cet entretien avec l’aimable autorisation de ses auteurs et de la revue.
Joan W. Scott
Historienne, professeure émérite à l’Institute for Advanced Study de Princeton (New Jersey, USA)
Membre du « Comité A » de l’Association of American University Professors (AAUP), dédié à la question de la titularisation (« tenure ») et des libertés académiques
Entretien réalisé par Pascal Marichalar
Sociologue et historien au CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (unité mixte de recherche EHESS, CNRS, Inserm et Université Sorbonne Paris Nord)
Pascal Marichalar : L’administration Trump a immédiatement commencé à attaquer la recherche et les universités.
Joan Scott : Je pense que le secteur de l’éducation est trop crucial par rapport à l’esprit général du pays pour qu’ils le laissent tranquille. La Floride est le modèle de ce qu’ils veulent faire. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vient de prendre le contrôle de University of West Florida, après avoir pris le contrôle de New College il y a quelques mois. Il vient de nommer à sa tête un certain Scott Yenor. Dans un article du Guardian, ce type a déclaré que les femmes ne devraient pas recevoir d’éducation supérieure ou avoir un emploi, qu’elles feraient mieux de rester à la maison pour élever des enfants. C’est d’une misogynie inimaginable. Donc le remplacement des universitaires et des administrateurs d’universités par de fidèles partisans de Trump est en train d’avoir lieu, à l’heure où nous parlons, et la Floride n’est pas le seul endroit concerné. Chaque jour amène de nouveaux assauts contre l’enseignement supérieur, au prétexte de s’attaquer à ce qui est dépeint comme de l’antisémitisme, alors qu’il s’agit de critiques de la politique menée par l’État d’Israël et pas contre les juifs en tant que groupe. Le Département de la justice a lancé une enquête contre cinq universités pour ces motifs. L’administration Trump est également en train de couper les fonds pour la recherche scientifique et la menace plane de supprimer le Département fédéral de l’éducation, ce qui laisserait les questions scolaires aux gouvernements locaux.
P. M : Dans votre article de novembre (encadré), vous évoquiez ce que cette reprise en main réactionnaire de l’enseignement supérieur doit à un personnage comme Christopher Rufo.
J. S : Christopher Rufo se définit lui-même comme un guerrier. Il travaille pour le Manhattan Institute, un think tank conservateur basé à New York. C’est lui qui a eu l’idée de prendre la critical race theory comme prétexte pour une attaque générale contre l’enseignement supérieur. La critical race theory, c’est cet ensemble de travaux élaborés par des universitaires noirs à partir des années 1980 pour tenter de revenir aux origines du racisme qui perdure encore aujourd’hui aux États-Unis. Rufo s’en est emparé pour qualifier d’endoctrinement tous ces travaux extraordinaires qui ont été réalisés au cours des dernières décennies, et tout ce qui est enseigné dans les écoles et les universités sur l’histoire de l’esclavage et l’héritage actuel de ce passé terrible. Il dit que les étudiants blancs, à qui on enseigne cette histoire, sont sommés d’avoir honte d’être blancs, par exemple. Mais cet effort remonte à plus loin. J’ai l’impression, d’après mes lectures, que c’est la décision de la Cour suprême Brown vs. Board of Education en 1954, contre la ségrégation des écoles, qui a marqué le début d’un effort déterminé de la droite pour freiner la position critique que l’enseignement supérieur a toujours eue, dans ce pays du moins. Il y a un merveilleux livre de Nancy MacLean, intitulé Democracy in Chains. Elle y retrace de manière très intéressante le chemin parcouru depuis la décision de 1954 jusqu’à aujourd’hui, au moment où George Mason University en Virginie a décidé d’ouvrir une école de droit nommée Antonin Scalia [un juge conservateur de la Cour suprême, décédé en 2016]. Cette université publique est devenue une enclave de la pensée conservatrice, surtout en droit et en économie.
Quelques jours après la deuxième élection de Donald Trump en novembre 2024, Joan Scott a publié un article dans le Chronicle of Higher Education, une revue très lue par les universitaires aux États-Unis, intitulé We will have to resist *, Nous devrons résister. Elle y détaille le fait que la prétendue « neutralité institutionnelle » des universités ne sera pas de mise face au projet trumpiste de « convertir l’enseignement supérieur en une usine de production de patriotes loyaux envers le régime au pouvoir ». Elle est également l’une des rédactrices du communiqué de l’AAUP publié début février 2025 sous le titre Against Anticipatory Obedience **, Contre l’obéissance par anticipation.
P. M : Il y a actuellement des tests de loyauté et des purges dans l’ensemble de l’administration fédérale.
J. S : Oui, Elon Musk vient d’envoyer un message à des milliers d’employés fédéraux, des fonctionnaires au sens français, leur demandant de démissionner avant le 6 février et leur disant qu’ils seraient payés jusqu’en septembre. S’ils le font, et si cela tient devant les tribunaux, alors ils embaucheront peut-être les anciens émeutiers du 6 janvier 2021 que Trump a graciés pour diriger les agences gouvernementales. Son idée est de créer une fonction publique loyale pour mener à bien tout ce qu’il veut faire et, en ce qui concerne l’éducation, de procéder à un endoctrinement, véritable celui-là, dans toutes les écoles et établissements publics du pays.
P. M : En parallèle, l’administration Trump poursuit et intensifie la répression des mobilisations étudiantes en solidarité avec Gaza.
J. S : Hier, Trump a annoncé que les étudiants non citoyens américains qui ont participé à des manifestations contre ce que fait Israël à Gaza seraient expulsés. Les autorités doivent s’employer à retrouver ces jeunes pour les expulser. Dans certains cas, les universités sont complices en donnant aux autorités les noms de ces étudiants, qu’elles avaient sanctionnés ou mis sous surveillance pour avoir participé à des manifestations contre les crimes de l’armée israélienne à Gaza, et dont elles savaient qu’ils et elles étaient expulsables. Cette attitude que nous voyons partout fait écho à la notion d’obéissance anticipée (anticipatory obedience) popularisée par Timothy Snyder. Il est particulièrement affligeant de constater que la grande majorité des dirigeants d’université se sont volontairement conformés aux nouveaux décrets présidentiels, au lieu de défendre ce que nous avons longtemps pensé être la mission de l’université et son engagement en faveur des libertés académiques.
P. M : Avec l’AAUP, vous avez suivi le cas de Katherine Franke, une enseignante qui a été récemment renvoyée de l’université Columbia de New York.
J. S : Katherine Franke est professeure de droit à Columbia. Elle a soutenu les manifestations étudiantes en solidarité avec la Palestine. Elle ne les a pas organisées, elle n’y a pas participé. Elle était conseillère juridique pour les étudiants qui avaient installé les campements au printemps dernier. Or, Columbia a un programme d’échange avec Israël dans le cadre duquel elle accueille comme étudiants d’anciens membres des forces de défense israéliennes, l’armée. Dans plusieurs cas avérés, certains d’entre eux ont attaqué des étudiants palestiniens ou d’autres étudiants juifs qui manifestaient ou qu’ils percevaient comme étant en train de manifester. Lors du campement organisé à Columbia, ce sont certains de ces étudiants et anciens étudiants de l’armée israélienne qui ont jeté un gaz non identifié sur d’autres étudiants, et qui ont été physiquement les plus agressifs. Katherine Franke a participé à une émission de radio où elle a dit : « nous avons un problème à Columbia avec certains de ces étudiants de l’armée israélienne, qui ont été en première ligne des attaques contre les étudiants, et pas seulement maintenant sur le campement ». Suite à cela, certains étudiants ont affirmé qu’elle était antisémite et que ses prises de position dans les médias étaient antisémites ; ils ont dit qu’ils se sentaient « menacés » par sa présence sur le campus. Lorsque la présidente de Columbia a comparu devant la commission d’enquête du Congrès, la députée républicaine Elise Stefanik lui a demandé ce qu’il en était de Katherine Franke, et lui a prêté des propos qu’elle n’avait pas tenus. La présidente de Columbia n’a pas rectifié les propos ni défendu la professeure, elle a juste confirmé que c’était une attitude inacceptable et qu’il y aurait certainement des actions contre Franke. Donc on a vu une présidente d’université qui a, pour ainsi dire, jeté l’une de ses professeures en pâture, sans autre forme de procès, sans enquête. Toute cette histoire a exposé Katherine Franke à une vague de haine inimaginable, à des menaces de mort, des gens la traquaient, à un point tel qu’il lui est devenu presque impossible de faire son travail. Plus tard, il y a eu une commission d’enquête de l’université, un rapport a été publié et a déclaré qu’elle était coupable d’antisémitisme. L’université a dit avoir conclu un accord avec elle et a annoncé son départ à la retraite. Franke a alors déclaré que non, elle n’avait pas décidé de prendre sa retraite, et qu’on l’avait forcée à démissionner. Elle poursuit l’université en justice.
P. M : Il y a quelques mois, vous écriviez dans un article des phrases qui résonnent avec ce que vous venez de raconter. Je cite : « La ligne séparant la politique du savoir (entendue comme les luttes autour du sens et du pouvoir) et l’engagement politique n’a jamais été clairement définie. Il en est ainsi parce qu’il existe une tension inhérente à la production de savoir, qui ne peut être résolue par des lois, des décisions administratives ou des discours académiques. Les libertés académiques servent de médiation dans cette tension, mais ne la résolvent pas, car la production de savoir est intrinsèquement critique à l’égard des normes en vigueur (que ce soit dans le domaine des sciences, des sciences sociales ou des sciences humaines), dont les partisans défendent l’intégrité et la véracité. La tension entre politique du savoir et engagement politique est l’horizon de l’enseignement supérieur démocratique aux Etats-Unis. »
J. S : Voilà. Et j’ajouterais une autre dimension, qui est que certains groupes ont confondu, à dessein, le concept delibertés académiques avec la liberté d’expression individuelle (free speech), et ceci a eu pour effet d’affaiblir considérablement les libertés académiques. On fait désormais comme s’il s’agissait de droits individuels, plutôt que d’un droit collectif inhérent à une faculté autonome, à l’autorégulation entre pairs, etc.
P. M : Cette dimension collective et institutionnelle des libertés académiques, est-ce par exemple celle portée par une institution telle que la « tenure » (titularisation) ?
J. S : Oui, mais pas seulement. C’est aussi l’idée générale que l’espace de l’université est un espace libre, un espace d’autonomie collective. Ainsi, certains diraient qu’on a dénié à Katherine Franke sa liberté d’expression, mais il y a plus grave encore : elle se trouve aussi désormais dans un lieu où la liberté académique, au sens collectif et institutionnel, n’existe plus pour la protéger, ni elle, ni ses collègues. En confondant la liberté d’expression et les libertés académiques, nous ne pensons qu’à son expérience individuelle, et non au climat général dans lequel désormais tout le monde doit travailler à Columbia. Son cas sert d’exemple de ce qui vous arrivera si vous franchissez certaines lignes politiques.
P. M : Les libertés académiques sont aussi attaquées à travers la question des financements. Soit en les conditionnant à la censure de certains thèmes, soit en les supprimant purement et simplement.
J. S : Oui, et cette remise en cause du statut de l’enseignement supérieur va même plus loin. En réalité, depuis Reagan, le retrait des financements publics, qu’il s’agisse des fonds fédéraux ou des financements par les États, a transféré la question du financement des universités des institutions publiques vers les étudiants, et donc vers la dette étudiante. Cette dette est non seulement un fardeau que doivent supporter celles et ceux qui sont là pour suivre des cours et recevoir un diplôme, mais elle devient aussi l’un des motifs de leur ressentiment contre l’enseignement supérieur. L’affaiblissement de l’enseignement supérieur est lié à ce transfert du financement vers la dette étudiante, qui est devenue ce dont tout le monde a des raisons légitimes de se plaindre : « Je paye pour recevoir des cours, je suis endetté·e à vie, et cela ne me garantit même pas un bon emploi ». C’est ainsi que l’endettement devient en soi un moyen de saper les institutions de l’enseignement supérieur. Si on y ajoute les accusations d’élitisme et de favoritisme des universités envers les familles de donateurs, cela signifie qu’une notion comme le respect ou non des libertés académiques perd de sa force politique. On ne peut plus dénoncer aussi facilement une université qui ne les respecterait pas.
P. M : Vous voulez dire que le fait de porter atteinte aux libertés académiques n’est plus aussi mal vu qu’auparavant ?
J. S : Cette référence est toujours importante mais, lorsque j’ai commencé à travailler avec l’AAUP il y a une trentaine d’années, si on pointait du doigt une université pour violation des libertés académiques, elle en pâtissait gravement, sa réputation en souffrait ! Les gens réfléchissaient à deux fois avant d’accepter un emploi dans cette université ou avant d’y envoyer leurs enfants. Ce n’était pas toujours aussi flagrant, mais on avait quand même l’impression que cette notion avait du poids. Maintenant, les tout petits établissements penseront encore qu’ils ont intérêt à se débarrasser de ce stigmate, que ce sera meilleur pour leur réputation et pour leur marque, mais cet argument n’a plus le pouvoir qu’il avait. Et s’il en est ainsi, c’est en partie parce que le statut de l’enseignement supérieur lui-même a été remis en question. On vous dira : « qu’est-ce que vous protégez lorsque vous invoquez la liberté académique ? Est-ce que c’est le droit privilégié des membres d’une élite de ne pas être licenciés au nom d’un principe abstrait ? » Les termes du débat ont changé de telle sorte que la résistance est plus difficile à élaborer. Où mettre le doigt pour avoir un certain impact ? Je n’abandonne pas les libertés académiques en tant que devise ou principe à invoquer, mais j’ai l’impression que c’est un instrument qui est devenu beaucoup moins puissant que par le passé.
P. M : Dans votre article de novembre, vous revenez sur un moment important de la définition des libertés académiques aux États-Unis, le rapport Kalven de 1967 à l’Université de Chicago.
J. S : L’AAUP vient justement de publier une déclaration sur la neutralité institutionnelle. Dans un rapport à paraître dans les tout prochains jours, nous pointons du doigt le fait que de nombreuses universités utilisent aujourd’hui la notion de neutralité institutionnelle pour refuser de prendre position sur la politique, sur l’élection de Trump, et sur certaines des choses qui se produisent actuellement. Or, suivant le principe de neutralité institutionnelle, l’institution devrait certes s’abstenir de toute déclaration qui semblerait politique mais pour mieux protéger l’expression politique et critique de ses professeurs. Le rapport Kalven de 1967 est le grand document qui a articulé ce principe. J’étais à l’Université de Chicago dans ces années-là. Le rapport a été publié dans le sillage des protestations étudiantes contre la guerre du Vietnam, dans un contexte où les étudiants se mobilisaient sur trois points, contre la politique d’apartheid en Afrique du Sud, contre la guerre du Vietnam et les investissements de l’université dans des domaines tels que la production de guerre, le napalm, etc., et aussi contre la complicité immédiate de l’université qui transmettait les relevés de notes des étudiants aux comités de conscription de l’armée.
P. M : Vous voulez dire que l’étudiant avec un bon dossier pouvait échapper à la conscription, mais celui avec de mauvaises notes était envoyé au Vietnam ?
J. S : Oui, en gros, un étudiant bien vu ou méritant pouvait éviter la mobilisation ou avait moins de chances d’être appelé sous les drapeaux. En revanche, pour ceux qui n’avaient pas de bonnes appréciations, avaient été renvoyés ou avaient abandonné leurs études, le statut d’étudiant ne protégeait que jusqu’à un certain point. L’université fournissait toutes les informations à l’armée, qui déterminait si le statut d’étudiant protégeait ou non de l’enrôlement. Et donc, il y a eu le rapport Kalven, nommé d’après Harry Kalven qui était à la tête de la commission. Le rapport final a déclaré que l’université, en tant qu’université, devait rester neutre. En d’autres termes, elle ne devait faire aucune déclaration publique de nature politique, car c’est précisément cette neutralité qui permettrait au corps enseignant et aux étudiants d’utiliser leur liberté critique. Il y a une phrase qui dit : « la neutralité de l’institution a comme complément la liberté la plus totale pour ses employés et étudiants en tant qu’individus de participer à des actions politiques et des mobilisations sociales ». Cependant, il y avait aussi quelques personnes au sein du comité qui s’inquiétaient de ce qui s’était passé dans les universités allemandes dans les années 1930, ou des serments de loyauté anticommunistes qui avaient été exigés aux États-Unis à partir des années 1950. C’est pour cela que le rapport précise également que, si la mission de l’université elle-même est menacée, alors une exception à la neutralité prévaut : « parfois des événements peuvent survenir qui font que la société, ou des segments de la société, menacent la mission même de l’université et ses valeurs de liberté de pensée et de recherche. Dans de telles crises, il devient le devoir de l’université en tant qu’institution de s’opposer à de telles mesures et de défendre activement ses intérêts et ses valeurs ».
P. M : Vous soulignez l’ambiguïté de la notion de neutralité institutionnelle.
J. S : Depuis les années 1960, l’élément déclencheur de ces réflexions a toujours été la question des réponses à apporter, et des limites à poser, aux mobilisations étudiantes. La neutralité institutionnelle a signifié beaucoup de choses différentes au cours de l’histoire et en fonction des situations. Elle a pu signifier que l’université publiait des déclarations en son nom, ou au contraire que l’université refusait de publier des déclarations en son nom, ou encore que l’université refusait d’autoriser les départements à publier des déclarations de quelque nature que ce soit. Certaines universités mobilisent la notion de neutralité institutionnelle pour signifier que les manifestations étudiantes sapent l’espace neutre de l’université, et ainsi de suite. Ce n’est pas juste un principe abstrait, l’invocation et l’application de ce principe s’insèrent toujours dans des considérations d’ordre stratégiques. Aujourd’hui, c’est encore au nom de la neutralité institutionnelle que certains affirment qu’une université ne doit pas soutenir les politiques de DEI (diversité, égalité, inclusion), la discrimination positive, etc., ou que l’université ne prendra pas de position en contradiction avec ce que l’administration Trump exige – même si cela affecte, au fond, la mission de l’université… Mon sentiment est que lorsqu’on voit quelqu’un invoquer la neutralité institutionnelle, il faut d’abord se demander comment et dans quel but elle est appliquée.
P. M : Diriez-vous que le moment présent peut être comparé à la période du McCarthysme ?
J. S : À l’époque, les attaques nous visaient plus personnellement. C’étaient les années du Smith Act, lorsque les dirigeants communistes étaient en prison ou en fuite, dans la clandestinité. Les téléphones étaient sur écoute. (…) Aujourd’hui, j’ai un mauvais pressentiment que le piège se referme, mais je ne me sens pas visée de manière aussi personnelle. Du moins, pas encore !
P. M : Le piège se referme…
J. S : Dans ma vie, j’ai beaucoup lu les membres de l’École de Francfort, mais toujours pour les ressources théoriques qu’ils offraient. Je ne m’étais jamais vraiment rendu compte du sentiment de désespoir avec lequel ils devaient composer. (…) Vous savez, toutes les choses que nous critiquions à propos de la démocratie libérale, ses limites, ses problèmes, et là soudain, voir ces institutions simplement balayées d’un revers de la main… Non pas que nos critiques étaient fausses, mais quelque part, nous prenions pour acquis que certaines structures étaient en place pour toujours. Les voir ainsi violées, renversées et ignorées, c’est extrêmement déstabilisant. (…) Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous, les universitaires, sommes déprimés. Il y a un niveau de dépression qui n’est pas formulé, mais qui affecte profondément la façon dont nous continuons à travailler. Et c’est quelque chose que, dans ma longue vie, je n’ai jamais connu auparavant.
P. M : Comment garder de l’espoir et de la combativité en ces temps obscurs ?
J. S : Une amie, historienne de la Russie, m’a dit que l’une des choses qui a sauvé les gens pendant les pires régimes communistes était ce qu’elle appelle la sociabilité de la table de la cuisine, c’est-à-dire, lorsque des personnes partageant les mêmes idées se retrouvaient en famille ou entre amis, s’asseyaient simplement autour d’une table, étaient avec les autres et s’accrochaient à ce en quoi ils et elles croyaient, et qui était important à leurs yeux. Juste après qu’elle m’a parlé de cela, on a reçu des universitaires argentins à l’Institute. Et on parlait ensemble de la menace de Trump, c’était juste avant l’élection, et à quel point c’était terrible. Et l’une d’entre ces collègues s’est penchée vers moi, m’a touché le bras, et elle m’a dit : « Mais tu sais, c’est ce qu’on a actuellement en Argentine avec Milei. Maintenant, certains d’entre nous prennent des anti-dépresseurs. Et d’autres boivent beaucoup plus qu’avant. Mais la chose la plus importante, c’est les dîners que nous organisons ! [Joan Scott rit] Et on partage notre malheur, tu sais. Et on sait qu’on sera là les uns pour les autres. »
Cet article est tiré du n°440 de notre revue la Vie de la Recherche Scientifique (VRS). Retrouvez l’ensemble des numéro dans notre rubrique VRS.