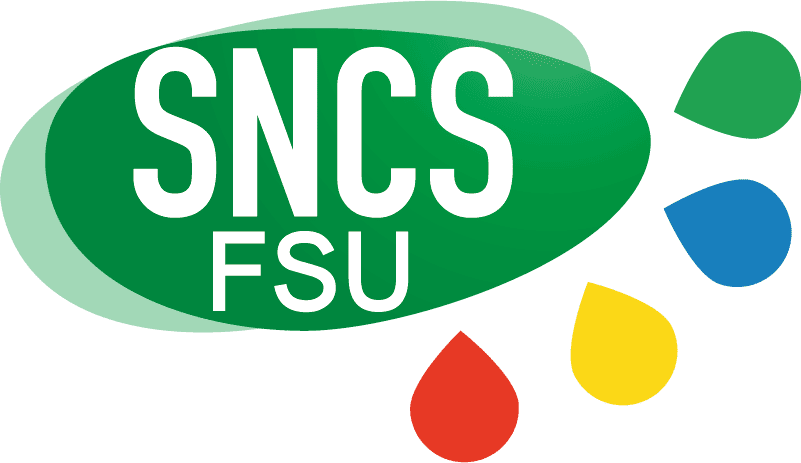Compte rendu du CS INSIS du 25 février 2013
Résumé de la réunion :
Ouverture de la séance par Anne-Sophie Bonnet et discussion générale
Discussion au sujet de CEA Tech.
Discussion au sujet de la mécanique à l’INSIS
Information sur le budget
Discussion sur le projet de loi sur l’ESR
Propositions de jurys d’admission
Organic electronics
Approbation du CR du CSI INSIS du 13 décembre 2012
Exposé sur le thème de l’énergie à l’INSIS
Discussion autours des concours de chercheurs
Projet d’ouvrage sur le développement durable : « Le développement durable à découvert »
Ouverture de la séance par Anne-Sophie Bonnet et discussion générale.
Un tour de table est organisé pour présenter les membres du CSI à Jean-Yves Marzin, nouveau directeur scientifique de l’INSIS.
Dominique GOBIN, nouveau membre élu (en remplacement de Jacques Magnaudet) : laboratoire EM2C (UMR CNRS-Ecole Centrale Paris), affecté à 50% à l’ANR, programme Blanc.
Jean-Yves Marzin (JYM) est entré au CNRS en 1996, après 16 ans à France Télécom R&D. JYM a contribué à créer le Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (LPN, UPR20 du CNRS) et a dirigé le LPN. JYM a contribué à construire le projet Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) puis a été en charge de ce projet avec la réunion des deux plateformes technologiques du LPN et de l’IEF (Institut d’Electronique Fondamentale). JYM a également exercé des responsabilités dans les programmes SIMI10 (nanosciences du programme Blanc) et PNANO/P3N/P2N de l’ANR.
JYM considère qu’il est un peu tôt pour effectuer une grande déclaration stratégique de l’INSIS. JYM ne connaît pas de façon approfondie toutes les composantes de l’INSIS. JYM va continuer à travailler avec l’équipe mise en place par Claudine Schmidt-Lainé. JYM note que sa prise de fonction s’est faite très rapidement – 6 semaines – après la démission de Claudine Schmidt-Lainé.
Discussion au sujet de CEA Tech.
Michel Sardin propose de donner un témoignage sur l’arrivée de CEA Tech en Lorraine. La région s’est engagée et souhaite que CEA Tech s’implante en Lorraine. Il y a donc une prospection de CEA Tech en Lorraine à la demande de la région. Le CEA est venu visiter avec une certaine modestie et a montré une volonté de se diversifier. Le CEA veut compléter (on ne dit pas concurrencer) l’approche Université-CNRS, il y a eu un accord entre le CNRS et le CEA. Georges Hadziioannou ajoute qu’il y a également la volonté de la région Aquitaine de faire venir CEA Tech en Aquitaine. JYM précise qu’il y une volonté gouvernementale, avec dans un premier temps une expérimentation pour 2 ans. Le CNRS a décidé d’accompagner ce processus car il peut y avoir une valeur ajoutée. JYM indique qu’il ne faut pas avoir de crainte existentielle : l’INSIS n’est pas soluble dans CEA Tech car l’INSIS représente 14 000 personnels (avec les enseignants-chercheurs et les doctorants). Le CEA n’a pas vocation à faire le lien entre une recherche amont menée au CNRS et l’industrie. Cela ne correspond pas à la réalité qui n’est pas si linéaire. Aujourd’hui, le CNRS accompagne, essaie d’identifier les opportunités, les thèmes, et les projets de forte valeur ajoutée. Dimitri Peaucelle remarque que le CEA Tech se positionne là où il y a des Instituts de Recherche Technologique (IRT). JYM ajoute qu’il y a aussi les Sociétés d’Accélération du Transfert et de technologie (SATT) puisque la valorisation devra passer par ces structures. Christophe Fonte indique que les IRT ont un statut de droit privé. Jean Chazelas invite à être très vigilant pour que la position du CEA ne soit pas entre le CNRS et l’industrie : Thales préfère avoir un contact direct avec le CNRS, et préfère ne pas avoir d’intermédiaire. Il faut être vigilant car le CEA a un budget conséquent. JYM est d’accord avec l’idée d’être vigilant pour que le CEA ne devienne pas le tampon entre le CNRS et l’industrie. Georges Hadziioannou souhaite également que le CEA ne devienne pas l’intermédiaire entre le CNRS et l’industrie, et invite de plus à être vigilant pour que les recherches d’Aquitaine par exemple ne soient pas aspirées vers Grenoble : il faut garder un équilibre entre régions. JYM indique qu’il faut un partenariat équilibré, et qu’il faut être prudent avec le ressourcement : la notion importante est l’équilibre entre partie amont et partie en partenariat industriel. Anne-Sophie Bonnet pointe un danger si les sources de financement passent par le CEA. Christophe Fonte soutient qu’il est préférable de donner des financements directement aux laboratoires plutôt que de financer les IRT. JYM répond que le financement des IRT est issu des investissements d’avenir, ces financements vont profiter aux laboratoires à la fin. Le CNRS est impliqué dans les IRT car cela est positif pour les laboratoires. Michèle Basseville (présidente de la section 7) précise que le CNRS n’est pas présent dans tous les IRT, par exemple à Rennes. L’IRT demande une implication de 1 jour par semaine. Dimitri Peaucelle ajoute que tous ces investissements d’avenir ont en commun le problème d’être rattachés au commissariat aux investissements d’avenir auprès du premier ministre. Tout se passe comme si il y avait deux tutelles avec d’une part le ministère de l’ESR et d’autre part le premier ministre et Louis Gallois.
Discussion au sujet de la mécanique à l’INSIS (sections 9 et 10).
Anne-Sophie Bonnet exprime une inquiétude quant à la perception qu’a la direction du CNRS des thématiques des sections 9 et 10. Il y a un soutien clair pour les « nano » et la section 8. Cependant, il y aurait une incompréhension avec la mécanique : manque-t-il un maillon avec la mécanique ? Est-ce parce que la mécanique peut être considérée comme une science « ancienne » et « établie » ? Michel Sardin indique que, concernant la mécanique, il règne le sentiment que les directeurs scientifiques de l’INSIS avaient plus d’affinité avec les sections 7 et 8, puis un peu moins avec la section 9 et encore moins avec la section 10. Aujourd’hui, il y a un gros travail au niveau du recyclage, de l’environnement, il faut bien connaître les matériaux pour la géoscience. JYM répond qu’il n’a pas entendu ce discours, et invite à faire le lien entre la mécanique et l’acoustique, à établir des priorités : par exemple dans l’environnement, l’énergie… Pascal Laugier ajoute que la mécanique et l’acoustique sont très interdisciplinaires. Ce sentiment est peut être le résultat d’un problème d’image qui peut paraître un peu désuète. La société française d’acoustique a publié « le livre blanc de l’acoustique en France en 2010 ». Claude Verdier informe qu’il y a des recrutements en biomécanique, plutôt « à la mode ». Mais les collègues de la section 9 revendiquent des postes sur leur coeur de métier, ce qui ne donne peut être pas une très bonne image. Dominique Habault estime qu’il y a peut être un problème d’image, « le bruit, on a beaucoup donné » : il y a pourtant plein d’aspects à mettre en avant, par exemple le handicap avec le bruit. JYM conclut en remarquant qu’il y a peut être aussi un problème d’affichage et constate que toutes les UMI sont plutôt dans les thématiques de la section 8 (c’est plus équilibré pour les LIA).
Information sur le budget (Jean-Yves Marzin).
Le budget 2013 de l’INSIS est de 16.91 millions d’euros, ce qui est constant par rapport à 2012. 14,13 millions d’euros de FEI (fonctionnement, équipement, investissement) seront distribués aux unités, soit 12,3% de plus qu’en 2012. Les postes : 16 CR2, 5 CR1 et 23 DR2, soit 21 postes de CR en 2013 (25 postes de CR en 2012). Le remplacement des départs à la retraite est effectif. Michèle Basseville (présidente de la section 7) précise que, pour l’INS2I, chaque départ en retraite est remplacé par 1,8 poste de CR. JYM continue avec les postes d’IT : il a 30 affichages de postes parmi lesquels 25 devraient être pourvus. Enfin, les accueils en délégation se font par site, et ensuite cela remontera aux instituts.
Discussion sur le projet de loi sur l’ESR.
Au sujet de la notion de « transfert » qui est introduite dans la loi, il ressort de la discussion que cette notion de transfert est réductrice car cela sous-entend une relation déséquilibrée, dans un seul sens : en réalité, le processus est équilibré, il existe un véritable échange entre monde académique et partenaires industriels. La montée en puissance des régions dans l’ESR n’est pas perçue de façon positive parmi les membres du CSI INSIS : il ne faut pas faire passer les financements par ce canal ; les acteurs locaux n’ont pas les moyens d’évaluer ou de comprendre l’évaluation, ce qui risque de réduire l’évaluation des laboratoires à une note qui peut être directement exploitée. Enfin, au sujet de l’AERES, certains membres du CSI INSIS rapportent des exemples où l’évaluation s’est plutôt bien passée : il faut cependant se poser la question de la plus value que l’AERES a apportée.
Propositions de jurys d’admission.
Approuvé à l’unanimité (18 votants).
Présentation de Georges Hadziioannou, Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques : Organic electronics.
Les longues chaînes de polymères sont des semi-conducteurs : un gap apparaît quand la longueur de la chaîne devient infinie (dans ce cas la chaîne devient une structure périodique). En comparaison avec la technologie « silicium », l’électronique organique présente les intérêts d’être plus léger et d’accéder à 15 décades une fois dopé (contre 5 décades avec le silicium). Les applications sont les écrans, le photovoltaïque. A noter qu’il y a l’équivalent de la loi de Moore avec la luminescence.
Georges Hadziioannou interroge sur la dispersion des moyens sur cette thématique. JYM répond que l’INSIS devra réfléchir avec les sections à ne pas disperser l’affectation des chercheurs, surtout avec la tendance actuelle où il y a peu de recrutements.
Approbation du CR du CSI INSIS du 13 décembre 2012.
Approuvé à l’unanimité (18 votants).
Exposé sur le thème de l’énergie à l’INSIS, Gilles Flamand.
Le contexte général est l’objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, sachant que ces émissions pourraient être multipliées par 2 si rien ne change. Le thème de l’énergie comprend les quatre domaines de recherche suivants.
1) Réduction de la consommation, efficacité : combustion (90% de l’énergie consommée dans le monde), aérodynamique, bâtiment, industrie, contrôle.
2) Energies classiques : ressources (combustion fossile et stockage du CO2), fission nucléaire et fusion.
3) Energies renouvelables : éolien, énergie des mers, biomasse, solaire (photovoltaïque et thermique).
4) Composants pour les systèmes énergétiques.
Thématiques en rapport avec l’énergie dans les sections de l’INSIS.
Section 08 : électrotechnique et nanomatériaux.
Section 09 : matériaux (endommagement, structure, interaction fluide/structure… ).
Section 10 : combustion, aérodynamique, transferts, chimie et plasmas.
Forces : industrie française de niveau mondiale, collaboration recherche publique/industrie, R&D sur toutes les filières et tous les aspects (intégrations verticales et horizontales), recherche amont et technologique.
Faiblesses : recherche technologique mal valorisée, dispersion des équipes au CNRS, concurrence entre acteurs, nécessité de créer des plateformes mutualisées.
Discussion.
JYM demande quelles sont les forces au CNRS sur l’énergie. Gilles Flamand répond que l’énergie représente entre 200 et 300 chercheurs au CNRS, et environ 2000 personnels avec les enseignants-chercheurs. La thématique de la thermique est un point fort. Au niveau de l’industrie, c’est très inégal, en particulier avec des retards dans l’éolien et les énergies renouvelables. Michèle Basseville et Dimitri Peaucelle font remarquer que la section 7 est impliquée dans la thématique de l’énergie avec l’automatique et la gestion des réseaux de transport. Alain Dollet rappelle le rôle intégrateur de l’INSIS dans le thème de l’énergie, et le rôle de représentation du CNRS au sein de l’alliance ANCRE. L’INSIS a également un rôle structurant au sein de GDR ou fédérations (ITER, …). Enfin, Alain Dollet informe qu’un dossier spécial sur le stockage de l’énergie va paraître dans le prochain journal du CNRS. G.eorges Hadziioannou demande quel poids représente le thème de l’énergie au CNRS face au CEA. Gilles Flamand répond que le CNRS est présent dans l’alliance ANCRE (CEA, CNRS, CPU, …). Il y a des sujets où il y a collaboration entre le CNRS et le CEA, d’autres où il y a des concurrences et le travail ne se fait pas ensemble. Dans le nucléaire, le CEA est hors d’atteinte. Les 2000 personnels (chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs) sont plus nombreux que les effectifs du CEA hors nucléaire. Le budget du CNRS dans le thème de l’énergie est d’environ 300 millions d’euros, ce qui est comparable à celui du CEA hors nucléaire. Jacques Magnaudet conclut que la disparition des PID (programmes interdisciplinaires) a été très dommageable à la thématique de l’énergie.
Discussion autours des concours de chercheurs.
Section 7, Michèle Basseville : 10 sélectionnés sur 33 candidats en CR1, 2 sélectionnés pour 1 poste fléché UMI JRL au Japon, 57 sélectionnés sur 117 candidats pour 4 postes CR2, 4 sélectionnés sur 29 pour le poste INSMI, 7 sélectionnés sur 17 pour le poste INSHS, 7 sélectionnés sur 23 candidats pour le poste INSIS (en imagerie et robotique médicale, microrobotique ou mécatronique).
Section 9, Claude Verdier : 67 sélectionnés sur 110 candidats en CR2, 17 sélectionnés sur 25 candidats pour le poste CR1.
Section 10, Jacques Magnaudet : 52 sélectionnés sur 85 candidats pour 24 postes CR2, 13 sélectionnés sur 21 candidats pour 1 poste CR1. La « tradition » en section 10, qui est l’absence d’audition pour le concours DR2, a été débattue puis reconduite. Cette audition peut être mal perçue pour les candidats qui passent le concours un grand nombre de fois (5-7 fois).
Section 28, Daniel Sherman : pas de sous jury en CR2 et CR1, 30 minutes par audition (15 minutes d’exposé + 15 minutes de questions). Les auditions ont duré 6 jours (CR+DR), auxquels se sont ajoutés 3 jours de délibérations.
CID 54, Pascal Laugier : la discussion au sein de la CID 54 n’a pas permis de dégager de réponse définitive et d’accord sur des critères de présélection en raison de la trop grande hétérogénéité ; 7 sélectionnés sur 28 pour 2 postes CR1, et 44 sélectionnés sur 90 pour 4 postes de CR2.
A la suite de ces présentations, une discussion sur l’intérêt ou non de la mobilité dans les critères de sélection montre que les avis sont partagés au sein du CSI INSIS.
JYM rappelle que le recrutement est très important. Le recrutement est la rencontre d’un candidat, d’un projet et d’une structure de recherche. Un critère évident est celui de la qualité scientifique des candidats et des projets. Ensuite, il faut prendre en compte la cohérence du projet sur une échelle locale et nationale : par exemple, un recrutement peut être déstructurant si le sujet est déjà développé dans un autre laboratoire. JYM conclut en indiquant que, dans le processus du recrutement, le risque induit par l’effet sous jury peut être plus important que celui induit par l’effet présélection.
Projet d’ouvrage sur le développement durable : « Le développement durable à découvert ». Présentation par Michel Sardin.
Le sommaire général de cet ouvrage comprend 6 parties, 140 auteurs ont été sollicités pour des contributions de 2 pages. Les thématiques concernant l’INSIS ont été identifiées, Michel Sardin a proposé des noms de collègues pour les contributions correspondant à ces thématiques.
Conclusion de la séance.
JYM souhaite que le CSI INSIS réalise un état des lieux sur les recherches à l’INSIS qui concerne les 2 « flagships » de l’Europe sur le GRAPHENE et les réseaux de neurones (Human Brain Project).