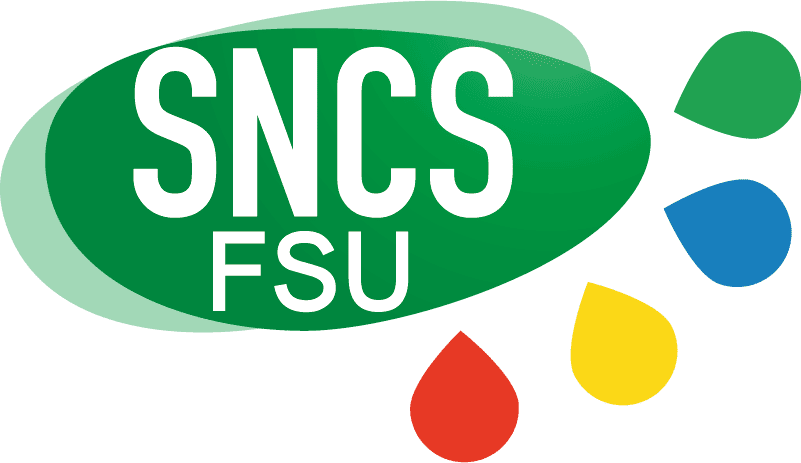CSD ST2I du 26 mars 2009
Tandis que les manifestants occupent le CNRS, le CSD ne discute pas de éventualité d’un dixième institut.
Compte-rendu du CSD ST2I du 26 Mars 2009
Ordre du jour initial :
1- Approbation des relevés de conclusions du 22 janvier 2009.
2- Point sur l’évolution des discussions au CNRS sur l’éventualité de la création d’un dixième institut
3- Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) par Dominique Wolton
4- Eventualité de la création d’un dixième institut au CNRS, présentation du point de vue de Jean Therme, directeur de la recherche technologique- CEA Grenoble
5- Poursuite de la discussion sur l’éventualité de la création d’un dixième institut
Déroulé de la journée :
1- Approbation des relevés de conclusions et du compte-rendu.
2- Point sur l’évolution des discussions au CNRS sur l’éventualité de la création d’un dixième institut.
3- Présentation des travaux de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) par Dominique Wolton.
4- Le point sur les recrutements et promotions des sections 7, 8, 9, 10.
5- Discussions sur le fonctionnement du CSD.
1- Approbation des relevés de conclusion et du compte-rendu
Ils sont approuvés.
2- Eventualité du dixième institut
Le CSD prend acte de la création de la commission présidée par Antoine Petit chargée de proposer et comparer différents scénarii concernant l’organisation des sciences et technologies de l’information au CNRS. Cette commission comprend des personnalités issues de la section 7 mais aussi d’autres domaines de ST2I. Elle comprend des membres du CSD ST2I. Un rapport préliminaire est attendu pour le 4 mai et le rapport définitif est prévu pour le 20 mai. Un CS du CNRS devrait se tenir le 26 mai avec ce point à l’ordre du jour. Le CSD propose donc de se réunir le 25 mai pour donner un avis sur cette question.
En raison de l’occupation du siège du CNRS par des manifestants et du blocage des accès par les forces de l’ordre, Jean Therme n’est pas intervenu.
3- ISCC – présentation par D. Wolton
D. Wolton Directeur de l’ISCC (www.iscc.cnrs.fr), accompagné de directeurs adjoints scientifiques, présente les activités de l’institut et encourage à y participer.
Comme pour SPI et STIC en leur temps, ou plus récemment les Sciences de l’Environnement, les Sciences de la Communication ont dû prendre le temps de convaincre pour avoir une place reconnue dans la communauté. Cela s’est passé par la création de l’ISCC au sein du CNRS. Les sciences de la Communication se distinguent des sciences de l’Information en se focalisant non pas sur les techniques de transmission de données, mais sur la nécessité de s’accorder entre émetteur et récepteur, de négocier pour se comprendre. Les sciences de la communication s’intéressent donc par exemple à l’étude des interactions entre sciences, techniques et leur utilisation par l’homme : sujet qui concerne bien évidemment ST2I. Les sciences de la communication ont pour enjeu scientifique de comprendre comment les sciences de l’information et la communication influencent tous les domaines scientifiques. L’ISCC se propose de mener une étude d’épistémologie comparée des disciplines pour comprendre ces effets. L’enjeu est également économique car il est primordial de comprendre comment les connaissances créées par les scientifiques sont réutilisées, revendues. La science se développe ainsi en négociation, en interaction, en communication avec la société. Les chercheurs de ST2I sont partie prenante de cette négociation et sont donc appelés à travailler avec l’ISCC : voir les appels d’offre sur www.iscc.cnrs.fr.
Cinq axes structurent actuellement l’ISCC
Langage et communication
Communication politique, espace public et société
Mondialisation et diversité culturelle
Information scientifique et technique – en lien avec l’Inist
Sciences, techniques et sociétés
Un lieu commun pour mener les recherches sur ces axes est envisagé sous la forme probable d’un hôtel à projet. L’institut ST2I est actif dans le financement de l’ISCC.
Le CSD propose de lancer un travail d’épistémologie comparée de nos sciences en lien avec l’ISCC. Une réunion de bureau élargie du CSD ST2I est envisagée pour lancer ce travail. Jean-Pierre Ternaux responsable de l’axe Information scientifique et technique serait l’interlocuteur pour mener cette étude. Elle pourrait aboutir sur un livre édité par la collection Hermes.
4- Le point sur les recrutements et promotions
Section 7 :
Bruno Durand, président de section fait le bilan des admissibilités DR.
14 postes dont 1 extérieur. 84 candidats dont 64 internes. Le nombre de postes est en augmentation en anticipation de l’augmentation à venir du nombre de candidats (effet des forts recrutements passés de CR). Les candidats étaient auditionnés et sont globalement satisfaits de cela. Sans doute que l’audition provoque des formes d’autocensure et réduit le nombre de candidats. Le recrutement d’un DR extérieur est une occasion pour recruter des étrangers. Pour qu’il y ait de bonnes candidatures, il est préférable que cet affichage soit maintenu, que ce soit une politique de long terme. Les candidats Maîtres de Conférences sont systématiquement éliminés s’ils candidatent dans leur laboratoire d’origine. Pas de tendance forte sur les catégories de promus (équilibre managers/chercheurs, 61ème/27ème, jeunes(33 ans)/plus âgés(61ans)) si ce n’est qu’ils ont tous un élément particulièrement exceptionnel dans leur dossier. On constate que certains gros laboratoires sont très attractifs.
Section 8 : P. Guillon dit quelques éléments qu’il a eu sur le concours DR.
Il y aurait peu de candidats parmi les CR de plus de 45 ans alors qu’il y a eu un doublement des candidatures de CR de 40 ans. Cela indique un découragement rapide des candidats.
Section 9 : Djimédo Kondo, président de section fait le bilan des admissibilités DR.
5 DR2, 6 CR2 et 1 CR1. Sur les 6 postes CR2, 2 sont fléchés.
Sur les 5 postes DR2, 27 candidats, dont quelques étrangers et 1 MdC. L’âge des retenus
varie de 39 à 50 ans.
Observation : la tendance a été à une plus grande ouverture vers la Physique. Il y a eu
des difficultés avec les postes fléchés (CR2). Sur l’un, le proposé était candidat
seulement en second choix sur le laboratoire fléché. Sur l’autre (poste en échange avec
les sciences de la terre et fléché sur un laboratoire) il n’y avait que 4 candidats (dont de
très bons heureusement).
Section 10 : Gilles Flamand, président de section fait le bilan des admissibilités DR et CR.
8 postes CR2 dont 4 fléchés un coloré, 1 poste CR1, 13 postes DR dont un fléché. Un poste CR2 fléché pour l’interface 9-10 est non pourvu par manque de candidats répondant aux critères. Sur un autre poste fléché, il n’y avait qu’un candidat, heureusement excellent. Le concours fléché avec les Mathématiques s’est très bien déroulé. Forte pression sur les postes du concours général.
Discussions :
P. Guillon s’interroge pourquoi il y a moins de candidats sur les postes fléchés. Il n’y a par exemple pas eu de candidats du tout sur un poste en CID 42 « intelligence ambiante ». Une explication est que probablement les candidats pensent que le poste est « pour » un candidat local. Une autre est que les candidats avaient 2 semaines pour faire leurs dossiers et il est difficile de préparer un dossier spécifique pour le concours fléché en si peu de temps.
P. Guillon estime que les fléchages permettent un politique scientifique ainsi que les affectations des chercheurs. Il souhaiterait que les dossiers de candidature soient plus adaptés à ces choix d’affectation.
P. Guillon s’interroge sur les nombres de postes à mettre au concours CR, DR ou IR dont les proportions respectives peuvent être différentes suivant les sections. Par exemple, il considère qu’il conviendrait de faire un effort de recrutement d’IR en section 7, à condition que les laboratoires fassent remonter des demandes. B. Durand exprime que, pour la section 7, il est probable que les laboratoires fassent de l’autocensure du fait des difficultés passées à recruter des IR. D’autant, qu’il est parfois difficile de les retenir dans les laboratoires et qu’il y a peu de candidats. Concernant le nombre de postes de DR, il estime que 14 à 15 par an serait approprié avec 1 à 2 externes. En CR2, le nombre de postes devrait être proche de celui de l’année 2009 si on y ajoute les Chaires. Gilles Flamand estime que les besoins de la section 10 porteraient plutôt sur une augmentation du nombre de CR1 pour tenir compte des parcours en Post-Doc de plus en plus long. Mais le blocage principal vient des difficultés de passage DR2-DR1.
Concernant les délégations d’enseignants chercheurs au CNRS il y en a 9 en section 10, 10 en 9, 8 en 8 et 40 en section 7 (c’est là qu’il y a le plus de demandes). Elles concernent des directeurs de laboratoire, des MdC préparant une HdR et des mobilités thématiques.
5- Discussions sur le fonctionnement du CSD
Groupes d’experts :
ST2I a par le passé mis en place des groupes d’experts dont récement sur l’intelligence ambiante, ITER, la Photonique. P. Guillon incite le CSD a proposer des groupes d’experts. Le CSD rappelle son souhait d’être plus informé sur ces groupes d’experts, par exemple en proposant un membre du CSD dans ces groupes.
Relations avec les Industriels :
Le CSD rappelle son souhait de consacrer une réunion à cette question. P. Guillon souhaite que ce soit une occasion pour repenser la vision ST2I des liens entre les laboratoires et l’industrie.
Politique régionale :
P. Guillon rappelle la politique de ST2I de collégiums. Le CSD propose d’auditionner les collégiums qui se mettent en place.
Politique scientifiques des laboratoires et ANR :
Le CSD pourrait faire l’analyse des dossiers ANR déposés et confronter cela avec les prospectives. Ce dossier peut être l’occasion de s’intéresser à l’articulation entre les politiques scientifiques des laboratoires et les demandes ANR.