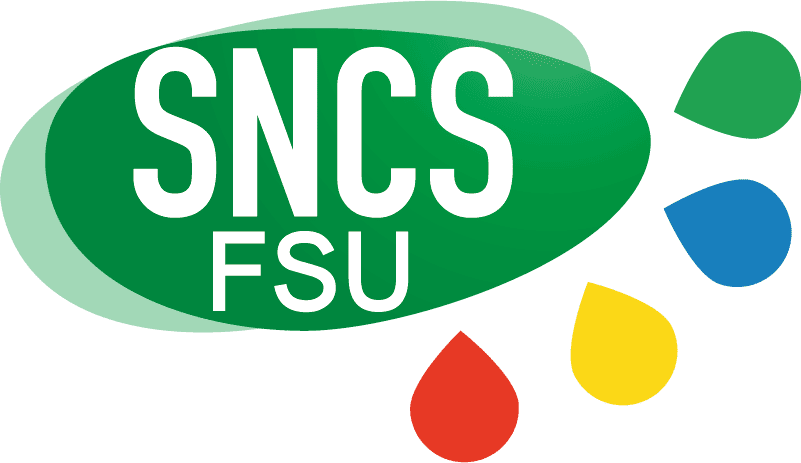Compte rendu officiel du CSD-ST2I du 13 février 2007
Compte-rendu adopté à l’unanimité lors du CSD du 18 juin 2007
Rappel de l’Ordre du Jour
1. Approbation du Compte rendu du CSD du 21 novembre 2006
2. Vote des motions sur la mise en place de l’AERES et sur la situation des
Sciences du vivant au CNRS
3. Avis sur la composition des jurys d’admission des Chargés de
recherches aux concours 2007 (sections et CID)
4. Contours des sections du Comité national de la recherche scientifique
5. Interfaces du département ; cas des CID
6. Intervention de Philippe REGNIER, Président du Conseil scientifique du
département Sciences Humaines et Sociales
7. Finalisation du document « plan stratégique du département ST2I »
8. Analyse du document CNRS « plan stratégique »
9. Questions diverses
1- Approbation CR réunion précédente : OK 14/14
Le compte rendu est approuvé par 14 voix pour sur 14 présents.
2- Votes motions
* Au sujet de l’AERES
« Le conseil scientifique du département ST2I a lu avec attention les motions votées par les sections sur le rôle futur de l’AERES et s’associe aux inquiétudes qu’elles expriment, en particulier quant à la séparation de l’évaluation entre les unités et leurs personnels. Il demande à la direction de cette agence d’utiliser largement la possibilité offerte par les textes de s’appuyer sur les évaluations que les sections du Comité National de la Recherche Scientifique réalisent chaque année. Il demande à la gouvernance du CNRS de relayer ce souhait auprès de l’AERES. »
Motion adoptée par 13 voix pour sur 13 présents.
* Au sujet de la place des SdV au CNRS
« Le conseil scientifique du département ST2I constate les nombreux projets qui ont été et sont menés en collaboration avec des chercheurs, des équipes et des laboratoires du département SDV. La poursuite de ces collaborations ouvre des perspectives susceptibles de conduire à des avancées notables tant sur le plan de la connaissance que sur celui des retombées économiques. En conséquence, le Conseil Scientifique du département ST2I demande à ce que la direction du CNRS fasse le nécessaire pour un développement équilibré de toutes les disciplines. Cet équilibre indispensable à la conduite de projets en partenariat entre les départements est une des forces de l’organisme. »
Motion adoptée par 12 voix pour, 1 abstention sur 13 présents.
3- Avis sur les jurys d’admission
Le jury d’admission pour les concours des chargés de recherche relevant du département ST2I est composé de membres nommés par le Directeur Général du CNRS :
Membres titulaires : S. Allano (DSA pour la section 8), Ph. Bompard (DSA, sec. 9 et 30), V. Donzeau Gouge (DSA sec.7), Y. Segui (Président CSD ST2I), M. Trinite (DSA sec. 4 et 10).
Membres suppléants : H. Abou Kandil (CSD ST2I), N. Bidoit (sec. 07), D. Courjon (sec. 08)
et de membres nommés par le Directeur Général du CNRS après consultation du CSD :
Membres titulaires proposés par le département : P. Beauvillain, J. Bertrand, A. Combescure, F. Pierrot, P. Sommer (respectivement présidents des sections 8, 10, 9, 7 et 30).
Membres suppléants proposés par le département : A. Cappy (sec. 8), J.J.M. Desrues (sec. 9), L. Pitchford (sec. 10).
Le CSD approuve le choix des présidents de section en tant que membres titulaires qui pourront ainsi rendre compte des débats des sections ayant motivé le classement d’admissibilité. P. Sommer indique qu’il ne pourra pas être présent lors du jury d’admission. Le CSD propose que M.C. Ho Ba Tho, membre de la section 30, soit nommée titulaire à sa place. Le CSD estime qu’un suppléant pour la section 7 serait indispensable et propose d’ajouter Ph. Baptiste à la liste des suppléants. Les listes modifiées sont approuvées par 14 voix pour sur 14 votants.
Le jury d’admission pour les concours des chargés de recherche relevant des CID est composé de membres issus des différents départements. Une partie est nommée par le Directeur Général du CNRS :
Membre titulaire : P. Guillon (DS ST2I)
Membre représentant : J.C. Gauthier (DSA Pluridisciplinaire)
Une partie est nommée par le Directeur Général du CNRS après consultation du CSD :
Membre titulaire : A. Touboul (sec. 8 et CID 43)
Membre suppléant : J.C. Andre (CID 46)
Le CSD approuve ces propositions qui concernent des personnes de ST2I et permettent une représentation des CID au jury d’admission assurant ainsi une transmission des débats du CID. Le CSD demande au Directeur Général de procéder aux nominations en permettant une représentation de tous les CID dans ce jury d’admission.
4- Contours des sections
À la demande du Directeur Général, le CSD discute des contours des sections et de leurs mots clés.
Globalement, aucun redécoupage n’est proposé, seuls des changements de mots clés sont envisagés. Les représentants du département indiquent qu’ils contacteront les présidents de sections pour en discuter avec eux. Un grand nombre des points soulevés montrent l’intérêt d’avoir regroupé SPI et STIC. Les discussions et la coordination faites par le CSD et le département permettront de mieux faire vivre les interfaces et les domaines situés à cheval entre sections.
Les mots clés qui reviennent pour toutes les sections et qui pourraient donc caractériser le département sont : modélisation, simulation, validation.
Robotique : Elle apparaît dans la section 7 (« Robotique, Systèmes de production et machines communicantes ») mais est également présente en section 9 sous l’intitulé « Dynamique des systèmes, contrôle actif ». Il n’est pas envisagé de remettre cela en cause car il est pertinent que la robotique soit à la fois en 7 et 9.
Aéro-acoustique : C’est un thème à cheval entre sections 9-10 et est aussi présent par les capteurs en section 8. Ce thème pour lequel le CNRS est reconnu doit être présent dans les mots clés.
Plasmas : Historiquement ce sujet est séparé entre sections 4 (plasmas chauds) et 10 (plasmas froids) mais se trouve aussi dans les activités de la 8 (écrans plasma…). Une coordination est nécessaire en particulier du fait du projet ITER cependant aucune difficulté n’est soulevée dans le fonctionnement actuel.
Bio-Informatique : Cette thématique est très dispersée entre sections 7, 16, 21, 30 et la CID 44. Elle n’apparaît pas explicitement en sections 7, 21 et 30 et il peut y avoir des difficultés pour les jeunes chercheurs de la section 7 recrutés pour des laboratoires de la 16 ou 21. Les problèmes viennent en partie des points de vue divers entre « trouver par l’informatique des solutions aux problèmes biologiques » et « s’inspirer de la biologie pour résoudre des problèmes STIC ». L’évaluation de cette thématique est à revoir.
Section 30 : Au-delà de la thématique Bio-Informatique, c’est la place de la section 30 qui est posée. Elle est en contact avec les sections 16 (plutôt orientée Chimie) et 21 (plutôt SdV) mais a une spécificité en termes de transfert. Après discussion, l’avis est de mieux préciser les spécificités de la section et marquer plus fortement les liens avec les sections 7, 8, 9, par exemple, sur la question de l’imagerie ou de la nano-thérapie, nano-pharmacologie. Le CSD suggère d’étudier un changement de nom de la section et propose « thérapeutique, pharmacologie, ingénierie pour le vivant ».
Rattachements annexes des sections : Il est suggéré que la section 7 soit rattachée au département SHS (voir le point 6 du compte-rendu) et que la section 9 soit rattachée au département Chimie.
Section 8 et 4-6 : Outre les liens avec les sections 7 (architectures des circuits et systèmes), 9 (aéro-acoustique), 10 (plasmas) les liens sont de plus en plus forts avec les sections 4 et 6. Il semble que les laboratoires ont trouvé un bon équilibre et tous les bons candidats trouvent leur place suivant qu’ils soient plus orientés vers l’élaboration de connaissances sur les matériaux ou vers la conception d’objets et de dispositifs. Il est important que les sections de ST2I n’aient pas le sentiment de servir de deuxième choix par rapport à celles de MPPU.
5- Interfaces du département, cas des CID
À la demande du Directeur Général, le CSD discute des contours des CID et de leur continuation. Les CID ont été créées pour explorer des champs nouveaux. Sont-elles devenues des sections à part entière ? Ont-elles démontré leur pertinence ?
Globalement, le CSD estime qu’il faudrait élaborer un mécanisme pour que les CID puissent participer aux évaluations des chercheurs recrutés par la CID. Cela permettrait aux CID d’enrichir leurs connaissances du domaine et éviter des problèmes d’évaluation des personnels. Sans modifier l’évaluation actuelle qui a l’avantage d’une évaluation disciplinaire lisible, le CSD propose que la CID soit sollicitée pour avis. En l’absence d’une forme de suivi des personnes recrutées, les CID se contentent d’exposer leur fonctionnement lors des recrutements.
Les CID font remarquer que les concours ne devraient pas comporter de fléchage fort car l’intitulé des CID constitue un fléchage en soi. Des contraintes supplémentaires conduisent à réduire les possibilités de recrutement de bons candidats.
CID 45 : « Cognition, langage, traitement de l’information, systèmes naturels et artificiels »
La CID est présentée par L. Garnero, membre du bureau de la CID.
Le bilan est globalement positif. La CID fonctionne sur la base d’une communauté préexistante à cheval sur les sections 7 (STIC), 27 (SdV) et 34 (SHS). C’est un domaine pluridisciplinaire pour lequel existent des formations universitaires spécifiques (cognition, ergonomie…) et des laboratoires s’y rattachent explicitement.
En comparaison des autres CID, la 45 a eu un nombre de postes convenable et il y a beaucoup de candidats. Les candidats recrutés ne sont pas moins bons que ceux qui sont recrutés par des sections. Ils ont des profils différents avec des connaissances sur plusieurs domaines. Parmi les candidats non retenus, un grand nombre sont issus de la section 7 et montrent peu d’ouverture interdisciplinaire. D’un autre côté, il est noté que la section 7 se montre ouverte à l’interdisciplinaire dans ces recrutements et beaucoup de chercheurs du domaine sont dans des laboratoires de la 7.
Concernant les thèmes de la CID, il est suggéré d’agrandir le champ en incluant « modélisation ».
L. Garnero n’a pas d’opposition à ce que la CID devienne une section à part entière et estime qu’il faut tout au moins prolonger la CID. Le CSD ST2I émet un avis favorable à la continuation de la CID.
CID 44 « Modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique »
La CID est présentée par B. Prum, Président de la CID.
Les candidats retenus montrent de très grandes qualités dans leur domaine d’origine (le plus souvent Math-Physique) avec une ouverture Interdisciplinaire (le plus souvent marquée par une application en Biologie). Un tiers des recrutés sont en Bio-informatique au sens de l’Informatique au service des problèmes de Biologie. Les candidats issus de laboratoires de Biologie ont en général une pratique interdisciplinaire plus ancienne. Elle concerne de plus en plus des questions de modélisation. Une moitié des recrutés ne l’auraient probablement pas été dans leur section d’origine qui les aurait jugés trop tournés vers des applications. A contrario, le classement de certains candidats sur liste complémentaire de la CID a pu aider leur recrutement dans leur section d’origine. Aucun candidat n’a pu masquer les faiblesses de sa candidature arguant d’Interdisciplinarité. Il est important d’informer les futurs candidats des pratiques de la CID. Une démarche rétroactive sur les recrutements passés peut inciter les doctorants à plus d’Interdisciplinarité. C’est dans la durée que l’expérience de la CID est pleinement enrichissante.
B. Prum demande que la CID soit prolongée. Le CSD ST2I émet un avis favorable à la continuation de la CID.
CID 43 « Impacts sociaux et développement des nanotechnologies »
Aucun représentant du bureau de la CID n’était présent. P. Beauvillain qui en est membre est intervenu en son nom propre.
Les avis sur cette CID sont mitigés du fait d’une faible interaction avec les domaines relevant de ST2I. Les recrutements sont Interdisciplinaires, mais principalement entre thématiques SHS. L’orientation serait principalement à l’analyse de la dangerosité des nanotechnologies, peu de travaux sur les effets positifs possibles en Chimie ou SdV. Cependant, le faible nombre de postes au concours pour la CID au regard de l’importance du sujet traité relativise les critiques. La thématique semble plus relever d’un programme interdisciplinaire que d’une CID.
Le CSC ST2I émet un avis mitigé sur la continuation de la CID dans sa forme actuelle.
6- Intervention de Ph. Regnier, Président du CSD SHS
Suite aux discussions sur les prospectives ST2I au sein du CSD et à des échanges au Conseil Scientifique, Y. Segui a proposé à Philippe Regnier de venir discuter des liens entre SHS et ST2I.
Ph. Regnier accueille cette première interaction comme une façon de faire connaissance et de se mettre d’accord sur les bases de raisonnement. Dans ce but, il expose quelle a été la réaction du CSD SHS au document préliminaire « CNRS – vision 2020 ». La réaction a été très négative en particulier sur la représentation positiviste et utilitariste de la science. Même si les thématiques relevant des SHS sont présentes dans ce document, la formulation est totalement à revoir et le Directeur Général aurait accepté de remettre à plat le document.
Le CSD SHS se propose d’organiser un colloque sur l’interdisciplinarité. En effet, cette notion doit être affinée et confrontée à des usages, des façons de faire. Une grande partie des actions interdisciplinaires est utilitariste. Elles instrumentalisent une discipline en faveur d’une autre. Des exemples : en archéologie des physiciens sont sollicités pour dater un os ; les « sciences dures » sollicitent des sociologues pour valider après coup l’acceptabilité sociale d’une technologie. L’interdisciplinarité devrait au contraire être une co-construction de thématiques faisant évoluer les connaissances de chacun. Cela suppose autre chose que le recrutement d’un jeune chercheur spécialiste d’un domaine pour un laboratoire d’une autre discipline. L’évolution et la création de concepts conjointement entre disciplines se fera par des actions à la base, en construisant des cultures communes, en harmonisant les modes de fonctionnement, en instaurant des outils de dialogue. Ceci n’est pas spécifique au rapport SHS-ST2I et est pertinent au sein même des départements.
La discussion dégage également des actions communes existantes et des orientations à développer plus amplement. Ainsi, la documentation numérique et le traitement de données en langue naturelle, sont des sujets interdisciplinaires existants fonctionnant bien. D’autres actions, comme les musées virtuels, sont des projets en cours de développement. L’institut des sciences de la communication crée en 2006 est un autre exemple. Ph. Regnier indique que cependant les interactions entre SHS et ST2I devraient être d’une plus grande ampleur. L’arrivée des TIC a eu un impact sur les SHS au point d’en modifier les usages, et au delà, les façons de penser les questions scientifiques. La conséquence est qu’il faut investir fortement dans des outils informatiques pour les SHS, concevoir les bases de données comme faisant partie intégrante de la recherche au même titre que les publications, avoir des chercheurs avec une double culture en informatique et SHS. Des connaissances nouvelles sont à développer rapidement pour pouvoir pleinement répondre à des enjeux comme les bibliothèques numériques, les nouvelles formes d’édition… Un dialogue entre ST2I et SHS serait potentiellement très fructueux du fait d’une culture commune de sciences construites au service ou à partir de l’activité humaine. Un enjeu pourrait être d’accompagner l’ingénieur aussi bien techniquement qu’humainement.
7- Prospectives de ST2I
Nous avons rediscuté du document de prospectives en cours de rédaction depuis la première réunion du 11 octobre 2006. Même si ce document n’est plus demandé par la direction du CNRS nous souhaitons le finaliser pour la fin mars. Il servira ainsi de base pour des discussions futures par exemple pour des recommandations de coloriage de postes. Des rédacteurs ont été proposés pour chaque paragraphe. Y. Segui se charge de rassembler des contributions. Le plan du document et les coordinateurs sont précisés ci-dessous. Toute contribution à ces questions sont à communiquer aux coordinateurs.
Préambule – Y. Segui
I – Enjeux transversaux au département ST2I
I.0 Introduction – Y. Segui
I.1 Acquisition, traitement et restitution des perceptions » – H. Abou Kandil
I.2 Modèles mathématiques incertains, outils de communication entre scientifiques – D. Peaucelle
I.3 Simulation, modèles, calcul intensif – O. Allix
I.4 Des matériaux aux structures : fonctionnalités et leur évolutions dans le temps – T. Bretheau
I.5 Des matériaux aux systèmes – P. Beauvillain
I.6 Optimisation et contrôle des flux – Y. Segui
I.7 Flux de données et accès à l’information – M.-Ch. Rousset
I.8 Systèmes embarqués et informatique ambiante – M. Bafleur
II – Les recherches en ST2I en réponse aux préoccupations économiques et sociétales :
II.0 Introduction – Y. Segui
II.1 Ingénierie pour le vivant, de l’imagerie à la robotique médicale et au geste médical assisté – C. Verdier
II.2 Nano-bio-technologies – M. Bafleur
II.3 Impacts sociaux des objets technologiques, acceptabilité et éthique – D. Peaucelle
II.4 Eco-conception et systèmes durables – Y. Segui
II.5 Energie : génération, stockage, distribution – S. Candel
III – Politique du département pour répondre à ces enjeux – Y. Segui
III-1 Politique de ressources humaines
III-2 Politique logicielle
III-3 Plateformes technologiques et logicielles
III-4 Réseaux scientifiques ouverture européenne et internationale :
8- Avis sur « le CNRS – vision 2020 »
Le Directeur Général demande au CSD de se prononcer sur le document provisoire intitulé « le CNRS – vision 2020 » qui préfigure la prospective de l’organisme pour les années à venir.
L’avis du CSD est globalement négatif :
Le document est à un niveau de généralité qui ne justifie pas sa longueur. Il devrait être plus concis ou bien devrait préciser les actions envisagées.
La tonalité générale est telle que le CNRS se montre très peu ambitieux et semble subir la situation de la recherche actuelle. Plus qu’une vision à 20 ans, c’est une description de la situation en 2007, marquée par le vote du « Pacte pour la Recherche ».
Le document présente le CNRS à la traîne des industriels. Il n’envisage les relations avec les industriels qu’en termes quantitatifs. Il devrait définir sa place dans le développement économique comme celle un acteur au rôle distinct capable d’une véritable indépendance.
Les rédacteurs semblent très éloignés des réalités de terrain en ce qui concerne la place du CNRS. Il est présenté comme un organisme alors qu’il fonctionne bien plus comme une structure de partenariat entre divers acteurs. Le succès du CNRS est de savoir vivre en symbiose nationalement et internationalement avec les autres structures de recherche et d’enseignement supérieur. Le CNRS apporte dans cette relation complexe sa capacité d’organiser des réseaux et son travail d’évaluation.
Le document ne propose pas de réflexion claire sur les briques de base où se réalise la recherche. Le laboratoire est tantôt présenté comme porteur d’une école de pensée ou comme une structure administrative en charge de la gestion des personnels. Il devrait y avoir une analyse du rôle, de la taille, des laboratoires ainsi que de leur découpage en équipes.
Le chercheur, et les personnels en général, sont quasiment ignorés. Il faudrait une réflexion sur les métiers de la recherche, sur comment elle se fait, sur la base sociale de la recherche. En s’appuyant sur cette analyse, la gestion des ressources humaines doit à la fois permettre la créativité, l’originalité, et aider l’organisation de collectifs. Elle doit renforcer l’attractivité des métiers.
Y. Segui se dit prêt à rassembler les réactions et contributions de chacun sur ce document et les transmettre aux rédacteurs.
9- Questions diverses
9-a Démission de Rainer Friedrich (membre nommé)
R. Friedrich fait savoir qu’il aurait participé avec plaisir au CSD mais ne peut pas dégager suffisamment de temps pour le faire. Sa thématique (sec 10) est déjà bien représentée au sein du CSD. Pour cette raison, après discussion avec Y. Segui, P. Guillon propose de nommer une personnalité apportant un regard sur la Bio-informatique qui manque à l’heure actuelle.
9-b ITER
Le CNRS a créé une structure fédérative « fusion magnétique ITER » pour permettre une coordination des laboratoires CNRS intervenant sur le projet. Cette fédération est un succès et le CEA a décidé de la rejoindre. La fédération reste ouverte à d’autres intervenants, en particulier les Universités, et à d’autres thématiques, par exemple l’optique. Toutes les sections du département seront concernées par le projet.
9-c « Jeudis ST2I »
P. Beauvillain propose que le département organise une fois par mois un séminaire destiné à exposer des projets en cours de soumission. La proposition est retenue dans son principe par P. Guillon.
9-d Crédits d’intervention pour l’interdisciplinarité
Le Département a décidé d’utiliser une partie de ses crédits d’intervention pour inciter des projets interdisciplinaires. Il s’agit des Projets Exploratoires Pluridisciplinaires (PEPS) dont l’appel a été lancé fin février 2007 et dont la clôture est le 23 mars.