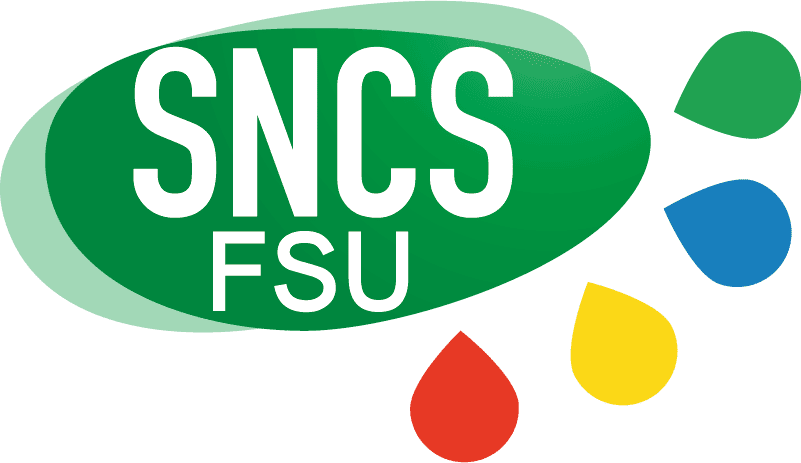Recrutement des chercheurs CNRS : les AOC nouveaux sont arrivés. À consommer sans modération !
Après le beaujolais nouveau, en novembre, arrivent rituellement, en décembre, les arrêtés d’ouverture des concours (AOC) de recrutement de chercheurs.
Ceux du CNRS sont parus au Journal officiel du 27 novembre. Nous savions, dès l’examen du budget général (cf. Hebdo n°6), que les établissements publics de recherche seraient tout juste maintenus la tête hors de l’eau.
On ne sera donc pas surpris par le nombre de postes ouverts au recrutement : 286 postes de chargés de recherche (CR) au lieu de 288 l’an dernier. C’est juste ce qu’il faut pour que l’effectif de chercheurs du Centre se maintienne … au même niveau qu’à la fin des années 1980. Grâce à la puissante vision que le gouvernement a de l’avenir du pays, nous avançons dans le XXIe siècle à reculons !
Ces 286 postes (auxquels s’ajouteront 11 postes de DR, 2 accueils en détachement et 8 CDD « handicap », pour un total de 307) restent toutefois une chance de faire entrer dans la carrière un nouveau contingent de jeunes chercheurs. Les jurys d’admissibilité travailleront avec le plus grand soin à classer les candidats en examinant tous leurs mérites. C’est pourquoi les candidats ne doivent pas se laisser intimider par des instructions exogènes. Un rappel peut être nécessaire de ce que doivent être l’esprit et le déroulement des concours.
Bureau national du SNCS-FSU
Un certain trouble vient en effet d’être jeté dans les esprits par le directeur de l’institut de physique du CNRS (INP), qui a écrit aux directeurs de ses unités, le 22 novembre : « la direction de l’INP a demandé aux sections qui en dépendent de proposer pour chaque candidat CR déclaré admissible un minimum de deux affectations. L’objectif est de décorréler la sélection des meilleurs candidats d’une volonté d’équilibre géographique. Il vous revient de prévenir les candidats qui pourraient vous contacter de bien vouloir préciser dans leurs dossiers au minimum deux affectations souhaitées pour leur insertion éventuelle au CNRS. ». Cette circulaire étonnante méconnaît plusieurs règles essentielles du fonctionnement des concours et appelle une mise au point.
Premièrement, les règles des concours étant posées, nul, parmi les exécutants de la procédure de recrutement n’a le droit d’en inventer ou d’en ajouter d’autres. L’AOC ne formulant aucune exigence en matière de voeux d’affectation, l’expression de deux souhaits ne peut pas être présentée comme obligatoire pour concourir.
Deuxièmement, « demander aux sections » de proposer des affectations peut sembler une bonne idée : ce sont les sections qui connaissent le mieux le terrain. Le hic c’est qu’au moment des concours les sections ne sont pas réunies ! Les jurys d’admissibilité, qui ne comportent que dix-huit des vingt-et-un membres de chaque section, ne peuvent pas, en l’absence des élus C, donner sur les affectations l’avis prévu par l’article 24 du décret n°83-1260. Le rôle des élus C au sein du Comité national, est essentiel pour la connaissance des contextes de travail. Il ne faut pas confondre les jurys d’admissibilité et les sections !
Troisièmement « décorréler la sélection des meilleurs candidats d’une volonté d’équilibre géographique » ne peut vouloir dire qu’une chose : que le directeur de l’INP a l’intention de laisser les jurys recruter, hors-sol, les meilleurs, puis de s’asseoir sur les souhaits d’affectation des lauréats pour les redistribuer au gré d’une absconse politique « géographique » (dont on peut craindre qu’elle ne fasse, en plus, qu’obéir à l’air du temps) ! Cette prétention est inadmissible, d’une part en raison du respect dû aux chercheurs concernés – à qui nous devrions surtout savoir gré de vouloir nous rejoindre malgré les difficultés toujours croissantes d’exercice du métier – d’autre part parce qu’elle ignore le vrai travail des jurys d’admissibilité.
La sélection des candidats s’opère en effet non seulement sur l’exposé de leurs travaux passés et sur les mérites que ces travaux révèlent, mais aussi sur leur projet, qui est indissociable d’un lieu d’exercice approprié. Bien sûr, dans les disciplines ou sur les sujets qui s’y prêtent, un candidat peut présenter plusieurs projets et, corrélativement, plusieurs affectations possibles. Le tour de force que cela représente, en un oral de vingt minutes (plus ou moins selon les sections) est un défi passionnant ! Mais ce défi, que peu en pratique sont en situation de pouvoir relever, ne saurait en aucun cas devenir une obligation.
C’est pourquoi, nonobstant le fait que c’est seulement, comme nous l’avons évoqué, la section au complet qui peut, à l’automne, donner formellement un avis sur les affectations, les jurys d’admissibilité sont, d’entrée, sensibles à la pertinence des voeux d’affectation. C’est une description grossièrement simplifiée de leur travail que de les décrire comme de simples jurys de sélection « décorrélée » des meilleurs – comme s’ils faisaient juste plancher les candidats sur le même exercice de maths ou de latin – qu’il reviendrait ensuite au directeur de l’institut d’expédier, comme en terrain vierge, ici ou là. Le jury d’admissibilité juge un tout : le projet et le terrain sur lequel celui-ci est censé se développer. Envoyer le lauréat cultiver le premier loin du second est un projet aussi absurde que de vouloir faire pousser des cactus en Islande ou des nénuphars au Sahara. Bien sûr la prérogative ultime que confère au directeur général de l’établissement l’article 24 déjà cité, de décider in fine l’affectation des chercheurs recrutés, demeure. Mais cette prérogative ne doit conduire, par rapport à la logique d’affectation entérinée par les jurys d’admissibilité et d’admission, qu’à des corrections très ponctuelles et justifiées.
Le jury d’admissibilité aura bien, déjà, pris la mesure de tous les équilibres qu’il est nécessaire de respecter, non seulement entre les régions, mais aussi entre les sous-disciplines, les genres, la variété des parcours professionnels, etc. Effaroucher les candidats par des menaces de limogeage dès après le recrutement est contreproductif et inhumain. Nous avons besoin que de jeunes chercheurs continuent à se présenter devant nos jurys avec confiance, avec des projets originaux et audacieux. Leur liberté est notre chance. Qu’elle ne soit pas gâchée !